Articles
Relations internationales / droit international
SYNTHESE
- Articles dans International Politics ; Critique internationale ; International Affairs ; Revue française de science politique ; Journal of Strategic Studies ; Raisons politiques ; Journal of Eastern African Studies ; Global Governance ; Ethics and International Affairs ; The Washington Quarterly ; War on the Rocks ; Le Rubicon ; Le Grand Continent ; Revue de science criminelle et de droit pénal comparé (RSC) ; Peace Review : A Journal of Social Justice ; Cités ; Annuaire Français de Relations Internationales ; Etudes internationales ; McGill Law Journal ; Philosophiques ; Etudes ; Commentaire ; Politique étrangère ; Politique internationale ; Revue Défense Nationale ; Les Champs de Mars ; Berlin Policy Journal ; Internationale Politik ; Just Security ; Revue des deux mondes ; La revue internationale et stratégique ; Política Externa ; Les Cahiers de la justice : revue trimestrielle de l’Ecole Nationale de la Magistrature ; Questions internationales ; Sciences humaines ; Défense & Sécurité Internationale (DSI) ; La vie des idées, etc.
- chapitres de livres publiés chez Routledge, Georgetown University Press, Presses universitaires de France (PUF), Presses de Sciences Po, CNRS Editions, Pedone, Presses universitaires de Rennes (PUR), Odile Jacob, Passés/Composés, Presses universitaires de Lyon (PUL), Brill / Nijhoff, Editions Thémis, Editions Berger-Levrault, etc.
- Tribunes dans la presse : Le Monde, Le Figaro, Libération, Frankfurter Allgemeine Zeitung, La Croix, L’OBS, Ouest France, Le Devoir, La Presse, The Conversation, La Tribune, Le Temps, Rue89, etc.
"La norme en relations internationales : distinction entre normes éthiques et juridiques", in Moussa Thioye et Leslie Vandeputte (dir.), La norme, Presses de l’Université Toulouse Capitole, Février 2026
"Not So Remote Drone Warfare", in James Rogers and James Hutto (eds.), Rethinking Remote Warfare, Palgrave Macmillan, p. 229-258, Janvier 2026
"France, a power in the Indo-Pacific (interview)", Politique internationale, n°185, Fall 2024.
"La France, puissance de l’Indopacifique" (entretien)", Politique internationale, n°185, Automne 2024.

"Understanding the Caledonian crisis : A response from the French Ambassador", Vanuatu Daily Post, 26 juin 2024

"Mettre de l’éthique dans les relations internationales", Sciences Humaines, Grands Dossiers N° 74 - Mars-avril-mai 2024, p. 67

"Support Ukraine in the face of Russian aggression", Vanuatu Daily Post, 24 février 2024
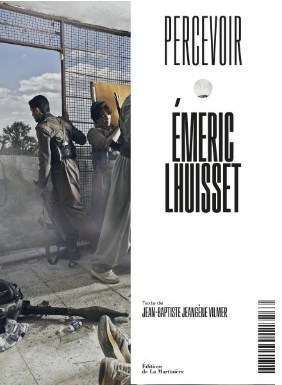
"Texte sur les mutations de la confictualité", in Emeric Lhuisset, Percevoir, Paris, Editions de la Martinière, 9 juin 2023
Texte en accompagnement des photographies de l’artiste Emeric Lhuisset qui travaille sur les images de guerre.
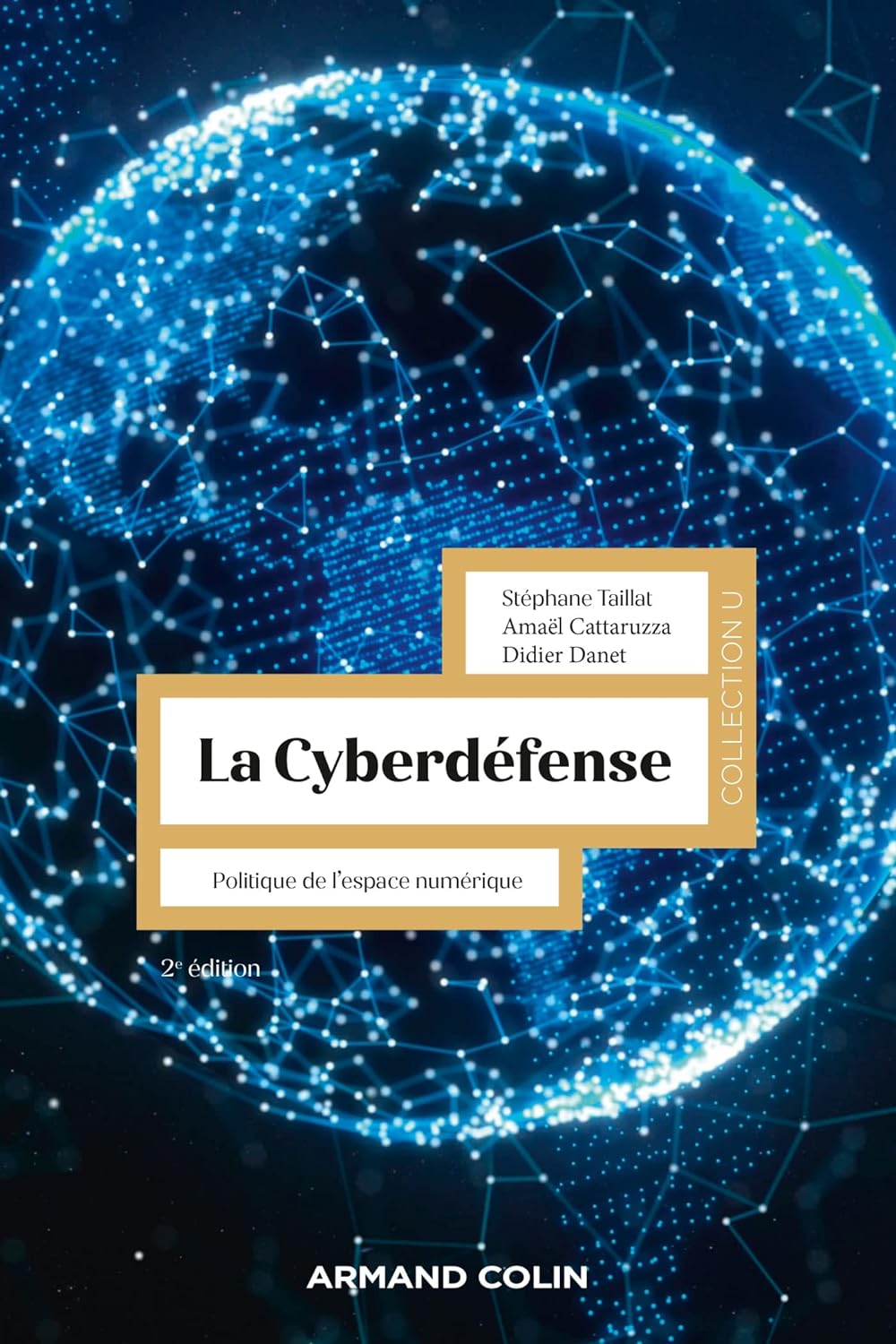
"Les démocraties face aux manipulations de l’information : vulnérabilités et résilience", in Stéphane Taillat, Amaël Cattaruzza et Didier Danet (dir.), La Cyberdéfense. Politique de l’espace numérique, Armand Colin, 2e édition, 2023, p. 225-231.
"War in Ukraine : ’Those who persist in ignoring moral issues should not be called realists, but simply cynics’", Le Monde, July 13, 2022
The war in Ukraine has accentuated the already persistent tendency to caricature what "realism" is in foreign policy. Many analysts claim this label when they call for moderation in the face of Russian aggression. Criticism over a "lack of realism" relates as much to the alleged origins of the conflict as to its conduct and the prospects for an exit.
"Guerre en Ukraine : « Etre réaliste, c’est croire au rapport de force et à la dissuasion »", Le Monde, 10 juillet 2022
La guerre en Ukraine a accentué la tendance déjà tenace à caricaturer ce qu’est le « réalisme » en politique étrangère. Nombreux sont les analystes qui revendiquent ce label pour appeler à la modération face à l’agression russe. Le procès en « manque de réalisme » vise tant les origines prétendues du conflit que sa conduite et les perspectives de sortie.

"Ethique et diplomatie des armes autonomes", in Louise Matz et Camille Trotoux (dir.), Ethique de la puissance aérienne et de la maîtrise du domaine spatial, Paris, La Documentation Française, 2022, p. 91-98.
"La haute intensité : limites du concept et implications pour la France ", Le Rubicon, 30 juin 2022
Ce concept désormais répandu reste toutefois problématique non seulement parce qu’il n’est pas certain que cette définition soit bien connue de la plupart de ceux qui l’utilisent, mais aussi pour des raisons que cet article se propose d’exposer. C’est, pour le dire en une formule, un mauvais concept qui pose de bonnes questions, et qui a pour la France des implications importantes puisqu’il s’agit au fond de savoir de quel modèle d’armée nous avons besoin pour faire face aux menaces en cours et à venir.
"Comment gagner la guerre en Ukraine sans la faire", Le Monde, 15 mars 2022
(avec Julian Fernandez) - Dans cette zone grise entre la guerre et la paix, la belligérance et l’indifférence, la question est de maximiser notre soutien tout en restant en-deçà du seuil de l’engagement direct dans le conflit armé. Comment ? En augmentant son coût d’un côté, tout en ménageant une voie de sortie de l’autre.
"Putin Loses No Matter How This Plays Out, But We Might Too", War on the Rocks, 2 mars 2022
No matter how the war in Ukraine plays out, Putin loses. Even if Russian forces prevail on the ground and in the air, he loses. Even if he takes Kyiv tomorrow, he loses. Russia lacks the forces (and perhaps the will) to occupy Ukraine in the face of a restive civil society and guerrilla movement. And that would be on top of having already reinforced NATO, awakened Europe, isolated his country, ruined its economy, and alienated many Russians, including his “friends.” What happens next depends less on the military outcome of the conflict than on other factors he has already put in motion and that will further affect him.
It might seem presumptuous in the first week of a war to predict its outcome and second-order effects for Ukraine, Russia, and the West, but it seems Putin’s defeat is the likely product of five factors : the heavy price of a prospective military victory, the quagmire of an occupation, the strengthening of NATO and European defense, the international isolation of Russia, and the internal contestation which may lead to Putin’s fall. So Putin lost, but it does not mean we win. He knows that he cornered himself and this is precisely where it gets dangerous because he may think that the only way out for him is to escalate.

"Pourquoi Poutine a déjà perdu la guerre", Le Grand Continent, 27 février 2022
Le 24 février 2022, au premier jour de l’offensive russe contre l’Ukraine, j’écrivais : « Quelle que soit l’issue de la guerre, Poutine l’a déjà perdue. En plus de pousser vers l’Ouest ce qui restera de l’Ukraine, elle va renforcer voire agrandir l’OTAN, isoler et affaiblir la Russie qui deviendra paria, et menacer son propre pouvoir à Moscou. Le début de la fin. » Il peut paraître présomptueux au premier jour d’une guerre d’en prédire l’issue, et contre-intuitif – ou optimiste – d’envisager que celle-ci ne soit pas favorable au plus puissant des deux belligérants. Il me semblait toutefois que ce dénouement s’imposait comme la conclusion logique du raisonnement suivant, en cinq étapes.
Egalement publié en espagnol (https://legrandcontinent.eu/es/2022...), italien (https://legrandcontinent.eu/it/2022...) et allemand (https://legrandcontinent.eu/de/2022...).
"Une guerre majeure toujours possible et moins improbable", Le Rubicon, 27 janvier 2022
À l’heure où la pression militaire russe autour de l’Ukraine fait craindre une offensive imminente, la formule que Raymond Aron utilisait en 1948 pour décrire l’équilibre nucléaire de la guerre froide – « Paix impossible, guerre improbable » – est-elle encore valable ? « Paix toujours impossible, guerre un peu moins improbable » pourrait-on lui répondre aujourd’hui. Dans un cas comme dans l’autre, la guerre dont on parle n’est pas n’importe quel affrontement armé, mais une guerre dite « majeure », entre grandes puissances.
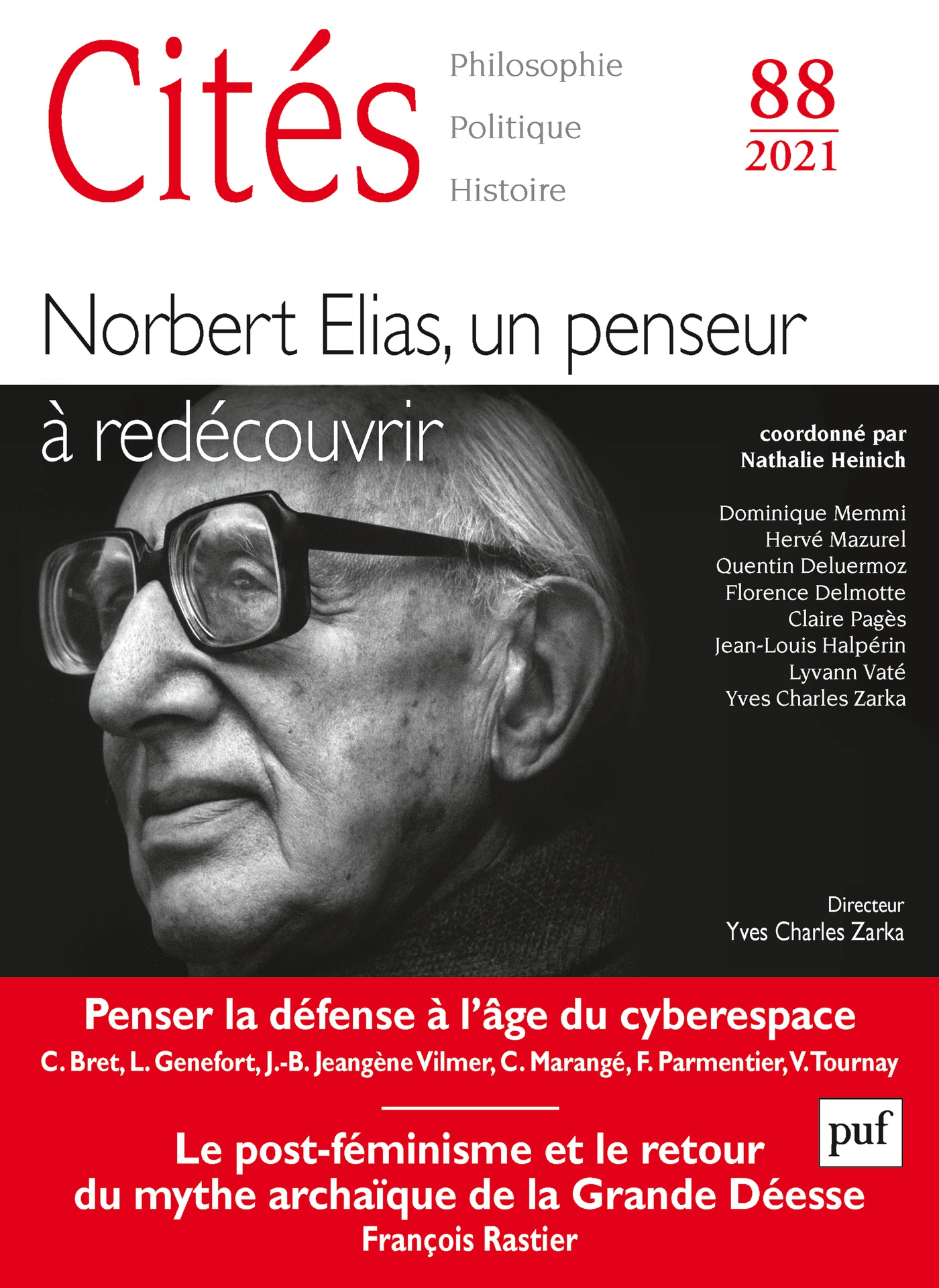
"’La violence clandestine et dispersée’ : penser la dilution de la guerre", Cités, n°88, 2021/4, décembre 2021, p. 139-145.
Si la guerre ne change pas de nature – elle reste « un acte de violence destiné à contraindre l’adversaire à exécuter notre volonté » comme l’écrivait Clausewitz –, sa forme évolue constamment. Depuis 1945, cette évolution va dans le sens d’une dilution, d’une « déspécification », c’est-à-dire d’une réduction croissante de l’écart entre guerre et paix, qui ne sont pas deux états clairement délimités mais les pôles théoriques d’un continuum. La dilution de la guerre est visible dans au moins trois dimensions : les acteurs (sommes-nous face à un combattant, un civil, un terroriste, un criminel ?), l’espace (l’urbanisation, la déterritorialisation et l’extension de l’espace de la conflictualité) et le temps (le début et la fin des interventions, la notion de victoire). La conséquence directe de cette extension de la zone grise entre la guerre et la paix est l’essor des menaces dites hybrides, définies comme l’engagement combiné d’actions cinétiques et non cinétiques visant à générer de l’ambiguïté afin de déstabiliser l’adversaire. Cette dilution de l’objet « guerre » a (ou devrait avoir) des conséquences sur la façon de l’étudier : il faut davantage travailler sur ce qu’Aron appelait « les espaces où sévit la violence clandestine et dispersée », c’est-à-dire ces interstices, ces zones grises entre la guerre et la paix, cet en-deçà de la guerre qui n’est pas pour autant la paix.

"L’influence chinoise au Canada", La Presse, 12 décembre 2021
Un volumineux rapport sur les opérations d’influence chinoises récemment publié par deux chercheurs de l’Institut de recherche stratégique de l’École militaire (IRSEM), en France, consacre un chapitre au cas canadien. Cet article en présente les principales conclusions.
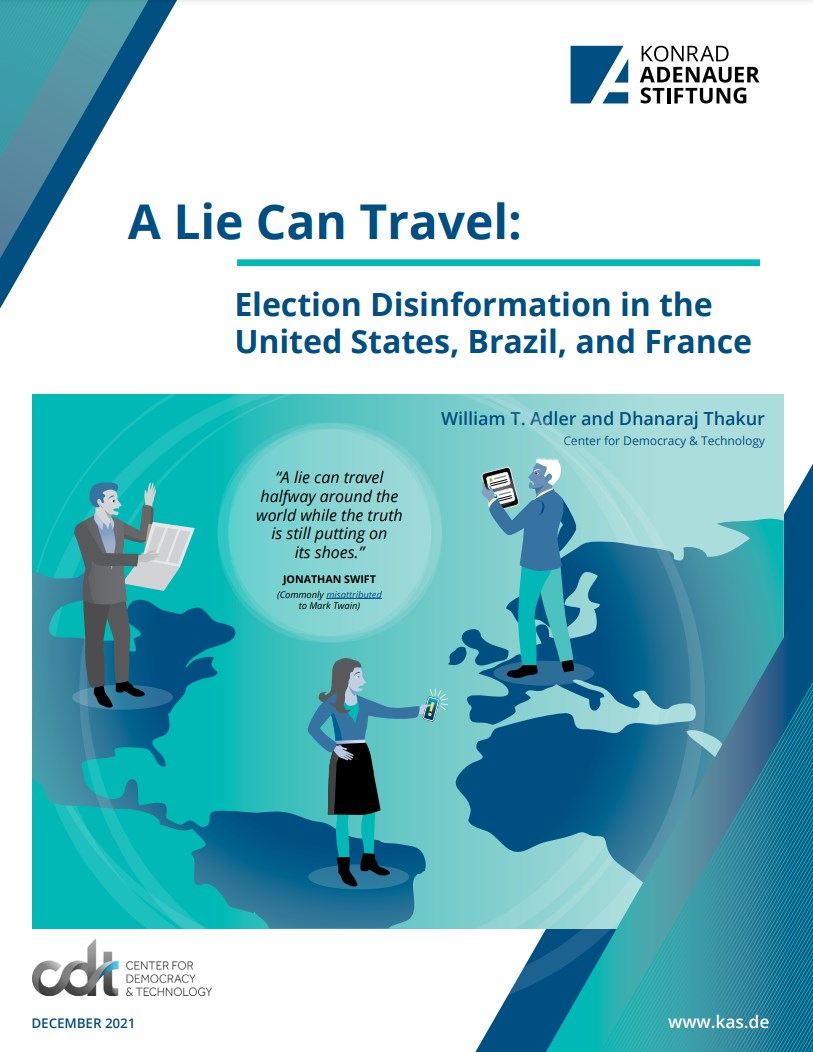
"Election Disinformation in France", in William T. Adler and Dhanaraj Thakur, A Lie Can Travel : Election Disinformation in the United States, Brazil, and France, Center for Democracy & Technology / Konrtad Adenauer Stiftung, December 2021, p. 38-50.
Much of the disinformation in France in recent years has been linked to specific events : the 2017 presidential election, the 2018–2020 gilets jaunes/yellow vests movement, the 2019 Notre-Dame de Paris fire, and the 2020–2021 COVID-19 pandemic.12 Since 2020, disinformation in France has taken on an unprecedented scale and is growing in volume and impact, according to the Prime Minister’s Government Information Service (SIG).13 According to SIG, this is due to several factors, including the pandemic, the proximity of the 2022 presidential election, and new incidents of terrorist violence. In recent years, especially since 2017, French authorities have become more concerned about election disinformation, and have enacted a number of legislative and policy measures that are described below. In 2021, concern about potential interference during the 2021 New Caledonian referendum and the 2022 French presidential election has been rising, a trend which will likely accelerate in the coming months as those events approach.
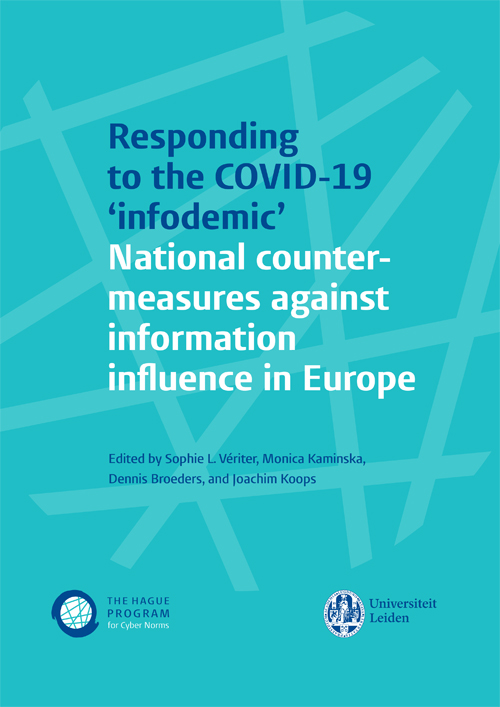
"France : A ‘light footprint’ approach to information manipulation", in Sophie Vériter, Monica Kaminska, Dennis Broeders and Joachim Koops (eds), Responding to the COVID-19 ‘infodemic’ : National countermeasures against information influence in Europe, , The Hague, The Hague Program for Cyber Norms, Universiteit Leiden, December 2021,p. 11-17.
The French response to information manipulation is characterised by a ‘light footprint’ approach, following the CAPS-IRSEM report recommending that states avoid heavy-handedness for the sake of their values but also out of a concern for effectiveness : civil society (journalists, the media, online platforms, and NGOs) must remain the first line of defense against information manipulation in liberal, democratic societies. In concrete terms, this means that the French approach is inclusive, civil-society-oriented, and that, compared to other states like the UK, Sweden, or Canada, the state communicates very little about what it has been doing on that front, in particular on its internal organisation.
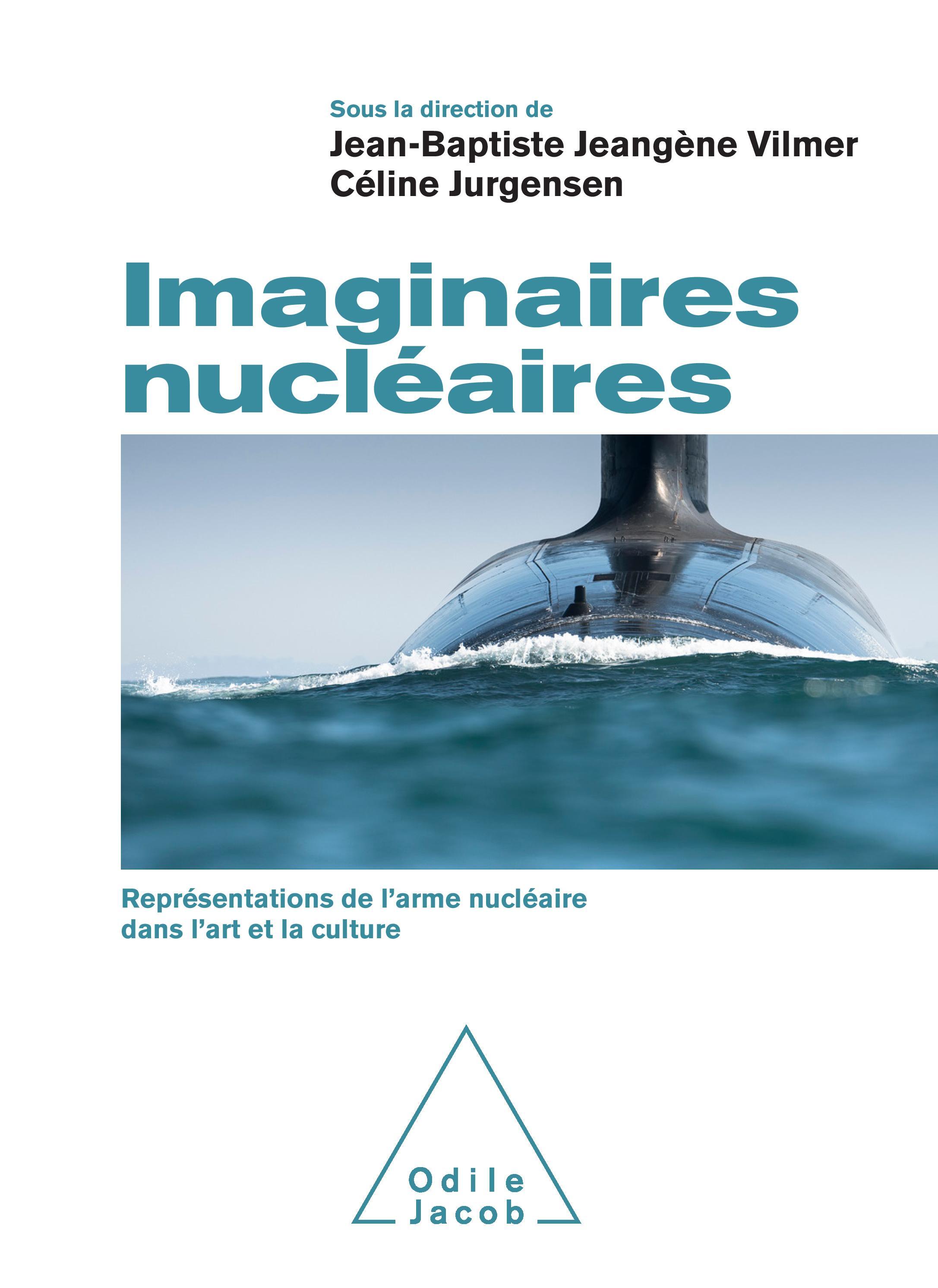
"Les armes nucléaires dans les séries télévisées", in J.-B. Jeangène Vilmer et C. Jurgensen (dir.), Imaginaires nucléaires. Représentations de l’arme nucléaire dans l’art et la culture, Paris, Odile Jacob, 2021, p. 71-86.
L’histoire de l’arme nucléaire dans les séries télévisées est presque aussi longue que celle de l’arme elle-même puisqu’elle commence dans les années 1950, aux États-Unis. La plupart des séries auxquelles il est fait référence dans ce chapitre sont américaines tout simplement parce qu’elles sont, en général, depuis toujours et encore aujourd’hui, beaucoup plus nombreuses et influentes que les autres. Plusieurs grands thèmes se distinguent, qui seront traités dans cet ordre dans les pages suivantes : la course à la bombe des années 1940, dont le traitement est plutôt récent puisqu’il date des années 2010 ; la guerre froide, durant laquelle le thème dominant est la crainte d’une guerre nucléaire ; la question de l’accessibilité de la bombe, c’est-à-dire le risque que d’autres puissent l’acquérir, des terroristes ou des États (prolifération) ; le genre post-apocalyptique, qui s’intéresse à l’après-explosion nucléaire ; la science-fiction, et en particulier l’usage d’armes nucléaires dans l’espace ; la fragilisation de la dissuasion, par le désarmement ou la désobéissance ; et enfin la métaphore de l’arme nucléaire, avec l’exemple des dragons de Game of Thrones.

"Not so remote drone warfare", International Politics, 2021
Drone warfare is the most emblematic manifestation of so-called remote warfare. And yet, how ‘remote’ is it really ? Based on extensive interaction with French drone crews, and interviews conducted in 2020, this article shows how drone warfare is not so new, not so distant, not so different, not so indifferent, and not so riskless. In other words, how distancing is a constant in the history of warfare ; how the cliché of the drone pilot killing people between the groceries and the family dinner is a partial reflect of reality ; how the videogame-like immersive environment of drone pilots is not that different from the one of modern inhabited aircrafts ; how drones contradict the widespread assumption that propensity to killing is proportionate to physical distance from target ; and finally how drone warfare is not that riskless, at least compared to its most likely alternatives. Therefore, drone warfare is not that remote.
"A French Opinion on the Ethics of Autonomous Weapons", War on the Rocks, 2 juin 2021
How will the world’s most powerful democracies deal with the ethical and legal dilemmas posed by the development of so-called “killer robots”, or lethal autonomous weapons systems (LAWS) ? On the one hand, LAWS promise unparalleled operational advantages, like acting as a force multiplier, expanding the battlefield, and removing humans from dull, dirty, or dangerous missions. Authoritarian powers like China and Russia appear to be dedicating tremendous resources into pursuing these capabilities. On the other hand, giving autonomous weapons the authority to determine who lives or dies is an ethical, practical, and legal nightmare. A couple of states have well-documented policies, most notably the United States and the United Kingdom. This article focuses on France, which has begun the difficult work of thinking through the ethical problems associated with lethal autonomous weapons systems.

"Peace without freedom in Eritrea : causes and consequences of the Ethio-Eritrean rapprochement", Journal of Eastern African Studies, 15:1, 2021, p. 23-42.
This article offers an analysis of the causes and consequences of the Ethio-Eritrean rapprochement. The causes are both internal (each side had their reasons) and external (under the influence of the UAE and Saudi Arabia). As for the consequences, the peace served as a catalyst of Eritrea’s reintegration : it boosted bilateral visits, had a limited regional snowball effect, lifted the UNSC sanctions, and accelerated the engagement of multilateral organizations and the EU in Eritrea. However, this reintegration is limited because of the persistent ambivalence of the regime, the degradation of the relations with Saudi Arabia and the US, and the fact that the peace with Ethiopia has stalled. Moreover, there is no peace dividend for the Eritrean population : after a glimpse of freedom when the border opened a couple of months, it is all back to the status quo ante, and even worse in some human rights respects. The conclusion shows the paradoxical nature of a rapprochement that also had negative effects and draws some lessons from the deeper problem explaining the stalled peace, that is institutional imbalance between a totalitarian state and a democratic one.
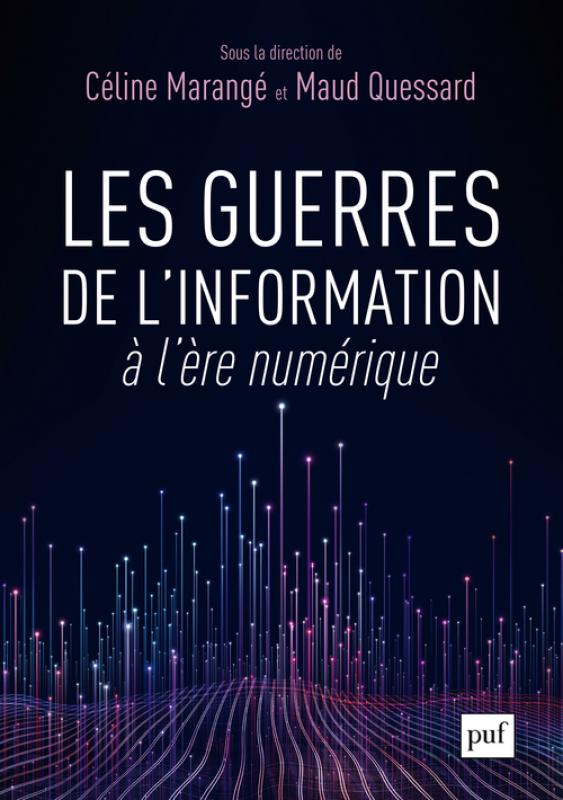
"Panorama des mesures prises contre les manipulations de l’information", in C. Marangé et M. Quessard (dir.), Les guerres de l’information à l’ère numérique, Paris, PUF, 2021, p. 365-388.
À l’exception de quelques États d’Europe centrale, nordique et orientale pour lesquels les attaques informationnelles venant de l’Est n’ont pas vraiment cessé avec la fin de la guerre froide, tous ceux qui, à l’« Ouest », avaient mis en place des mesures défensives contre les opérations soviétiques ont « désarmé » dans les années 1990 et se sont donc trouvés dépourvus lorsque, vingt ans plus tard, le besoin s’est fait sentir de se défendre à nouveau contre des attaques informationnelles étatiques de grande ampleur. La prise de conscience a été graduelle – et elle continue de croître partout dans le monde – mais semble s’être accélérée dans les années 2010, en trois étapes.
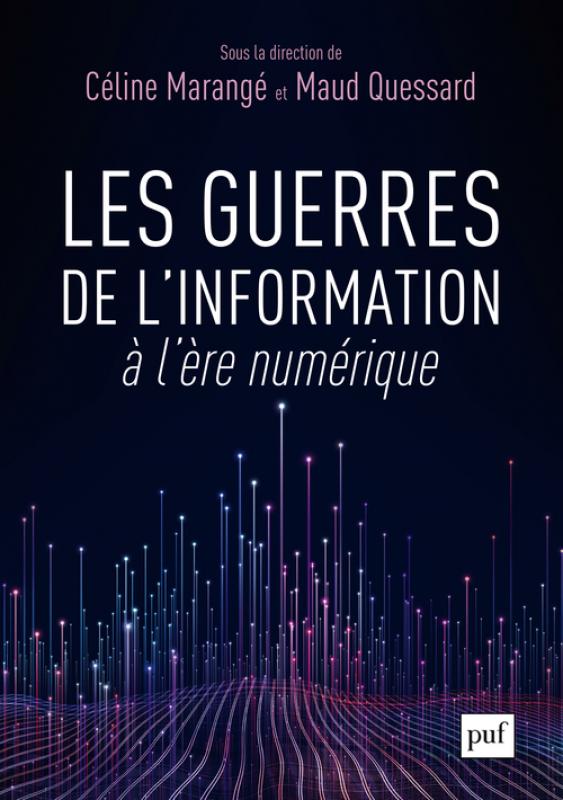
"Préface", à C. Marangé et M. Quessard (dir.), Les guerres de l’information à l’ère numérique, Paris, PUF, 2021, p. 7-10.
Les manipulations de l’information, qui ont toujours existé, sont aujourd’hui à la fois plus nombreuses et plus graves car elles sont véhiculées par des réseaux sociaux qui permettent de toucher des millions de personnes dans le monde en quelques minutes seulement, dans un climat de crise de confiance dans lequel la parole publique est dévaluée et la notion même de vérité est remise en cause. La pandémie de Covid-19 en 2020 l’a encore illustré : entre fin janvier et fin mars, le Service européen d’action extérieure de l’Union européenne a identifié plus de 150 informations fausses ou biaisées ainsi que des théories conspirationnistes, attribuées à la Russie, sur l’origine du virus, la réalité de la pandémie, les traitements potentiels ou encore les mesures prises par les États. La Chine, où le virus est apparu, est également responsable d’une campagne de désinformation visant à déresponsabiliser le Parti communiste chinois en accusant les États-Unis. Ces attaques ne sont pas anodines : dans une crise sanitaire comme celle-ci, « la désinformation peut tuer » comme l’a rappelé Josep Borrell, le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.
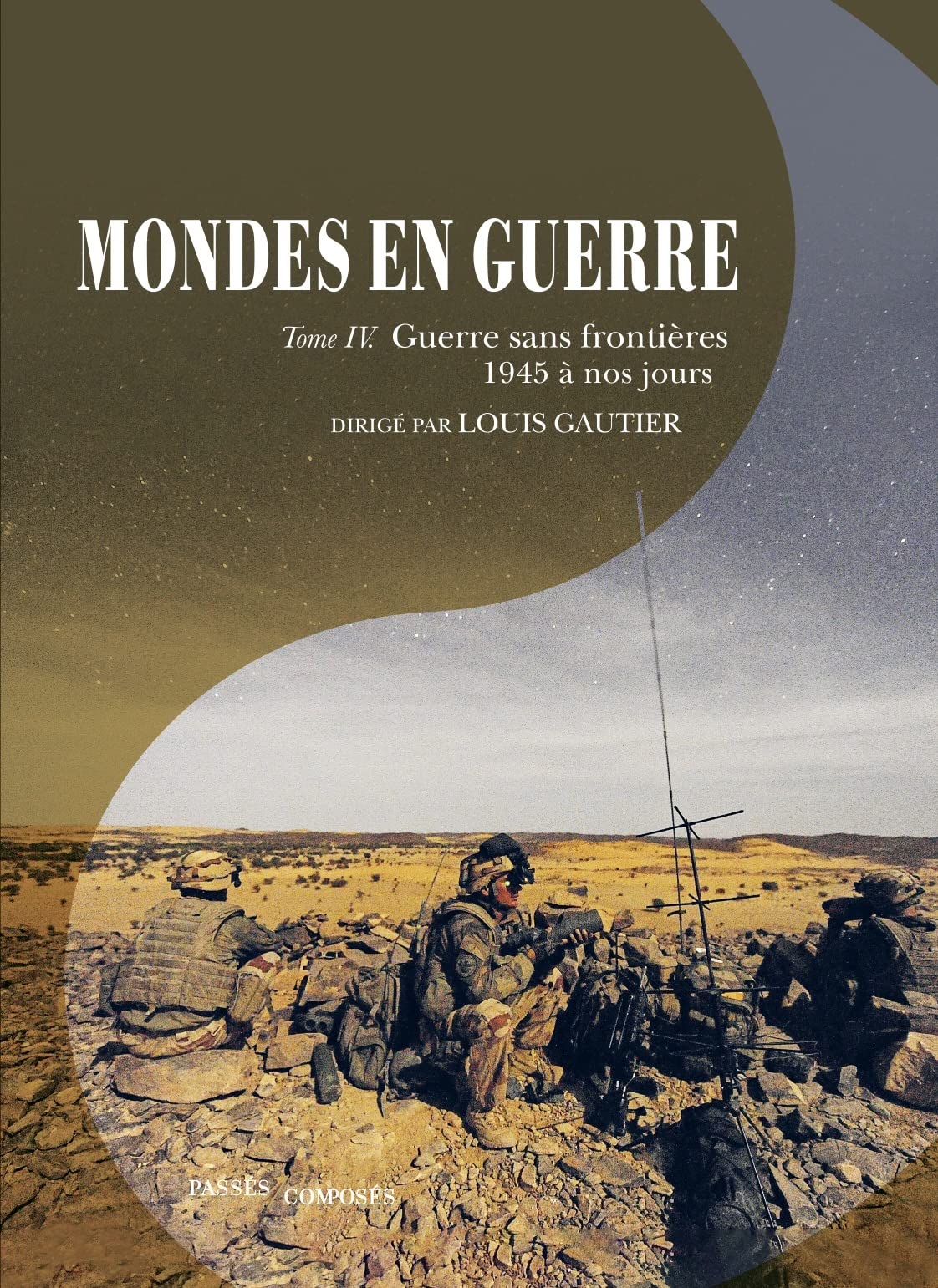
"La guerre, le droit et la justice", in Louis Gautier (dir.), Mondes en guerre. Tome IV. Guerre sans frontières. 1945-2020, Paris, Passés/Composés, 2021, p. 453-515.
La période de 1945 à nos jours est celle, dans l’histoire, qui a développé le plus de normes pour réguler les conflits armés et limiter leurs effets. Le vaste champ de l’éthique et du droit de la guerre – parfois appelé « tradition » ou « théorie de la guerre juste » – se développe depuis l’Antiquité. Il divise le problème de la légitimité de la guerre en trois grandes catégories : à quelles conditions peut-on dire d’une guerre qu’elle est juste au sens du jus ad bellum (le droit d’entrer en guerre), du jus in bello (le droit dans la guerre) et du jus post bellum (le droit après la guerre) ?

"Guerres et terrorisme : ne pas manipuler les faits", L’Obs, 1er décembre 2020
Le débat sur les causes du terrorisme se poursuit. Après une tribune dans « l’Obs » à laquelle nous avons répondu, une nouvelle tribune mobilise cette fois « des études » pour, elle aussi, faire croire à un lien de causalité directe entre interventions militaires et attentats terroristes. En dépit des apparences, toutefois, ses auteurs sont loin d’une démarche scientifique, comme en témoignent nombre d’erreurs et de sophismes.

"Guerres et terrorisme : ne pas se tromper de cible", L’Obs, 21 novembre 2020
Parce qu’il touche à la vie et à la mort de nos concitoyens, le terrorisme appelle un débat qui concerne l’ensemble de la communauté nationale. C’est à ce débat que tente de contribuer la tribune collective parue sur le site de « L’Obs » le 14 novembre intitulée « Guerres et terrorisme : sortir du déni ». Les auteurs y défendent une thèse pour le moins simpliste : Français, Européens, Occidentaux, seraient en grande partie responsables de ce qui leur arrive, car ce sont leurs interventions militaires qui susciteraient, au Moyen-Orient, réactions violentes, radicalisation et in fine actes de terrorisme.
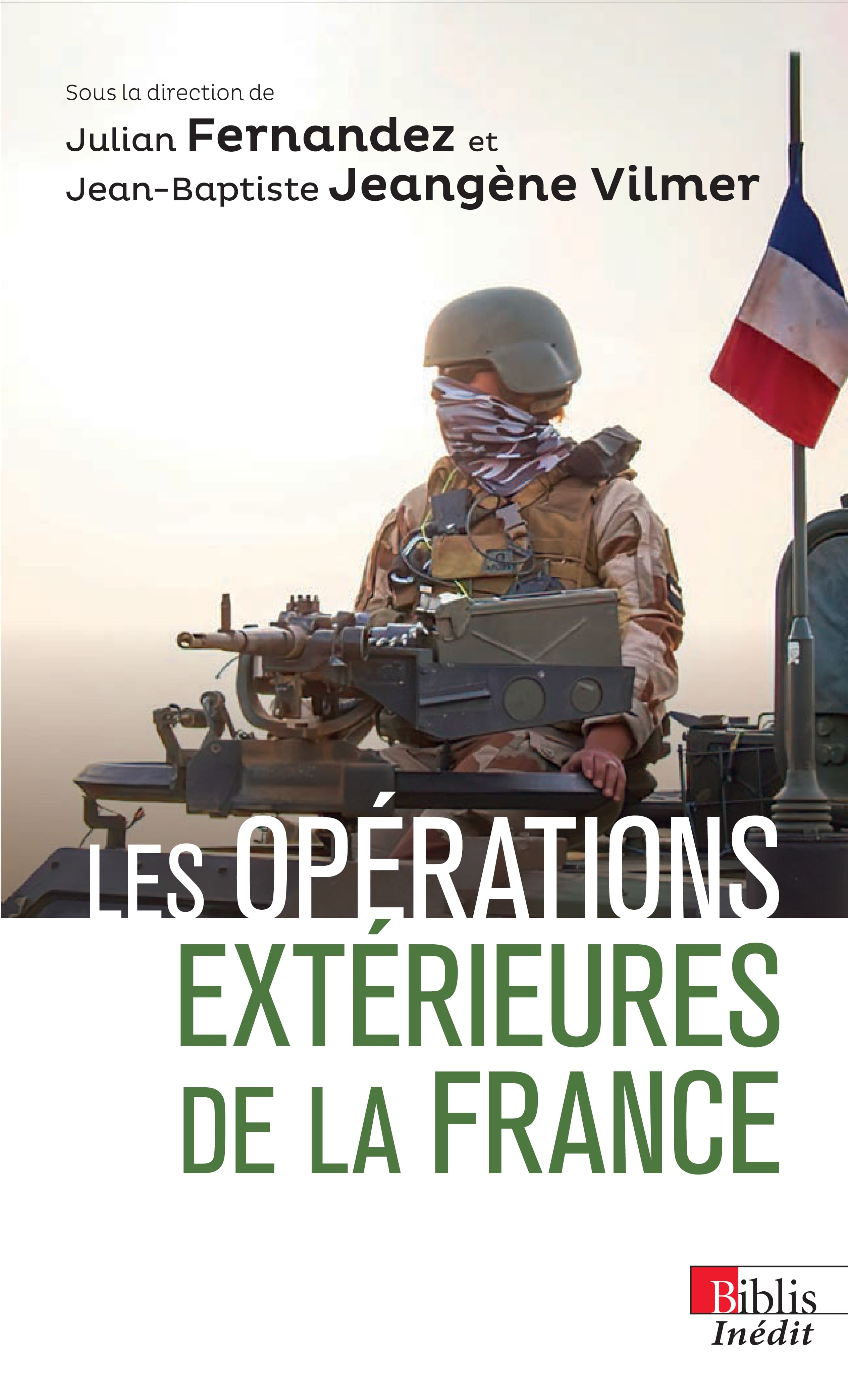
"Introduction", in J. Fernandez et J.-B. Jeangène Vilmer, Les Opérations extérieures de la France, Paris, CNRS Editions, 2020, p. 13-28.
Les engagements militaires de la France à l’étranger sont multiples et diversifiés. Plus de 7 000 soldats français sont aujourd’hui déployés sur de nombreux théâtres extérieurs (5 100 pour Barkhane au Sahel, 600 pour Chammal au Levant, 1 260 autres pour des missions de l’ONU, de l’OTAN et de l’UE et 500 pour des missions maritimes), sans compter les forces de présence (3 700 militaires dans cinq pays d’Afrique et du Moyen-Orient). Plusieurs autres opérations ont eu lieu ces dernières années qui sont aujourd’hui terminées, dont Hamilton en Syrie (2018) et Sangaris en Centrafrique (2013-2016). Les motifs de ces opérations sont pluriels.
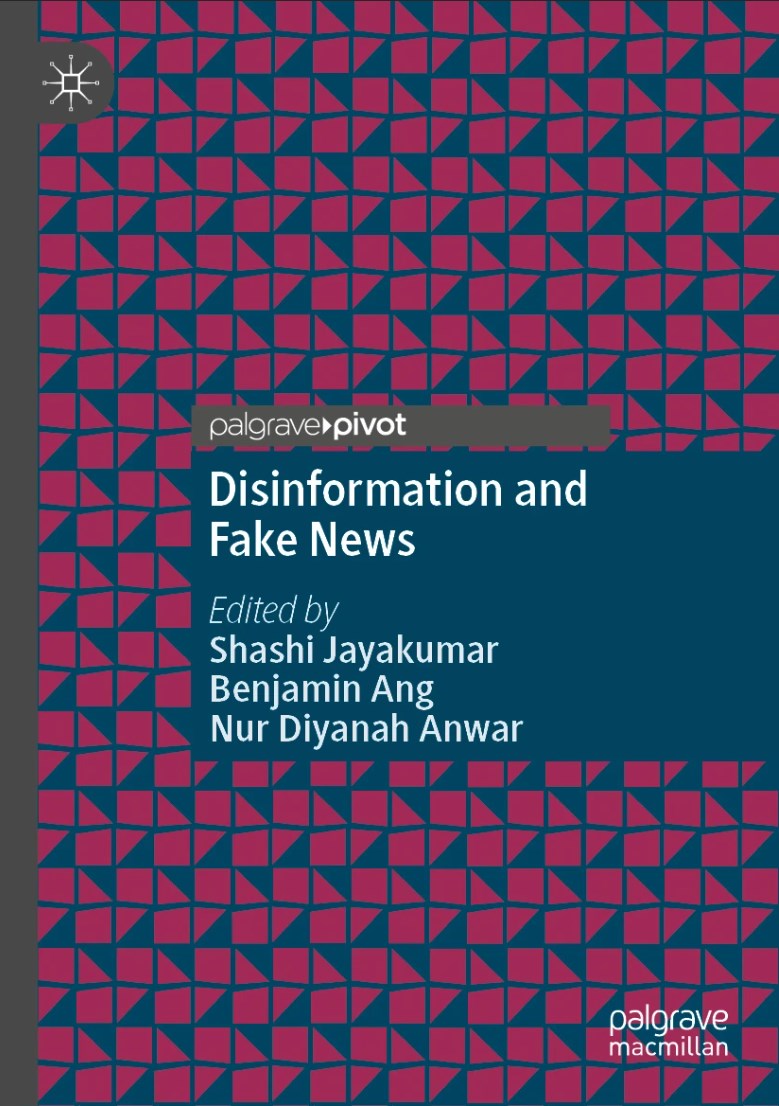
"Fighting Information Manipulation : The French Experience", Jayakumar S., Ang B., Anwar N.D. (eds) Disinformation and Fake News. Palgrave Macmillan, Singapore, 2020, p. 75-89.
Jean-Baptiste Jeangène Vilmer analyzes the impact of the massive data breach that was used in a large-scale disinformation campaign targeting Emmanuel Macron and his campaign team, in the run up to the 2017 French presidential elections. Despite the large data leak, the campaign was deemed a failure, as it did not succeed in significantly influencing French voters. Vilmer explores why this was the case by highlighting a number of mistakes made by the hackers, as well as the appropriate and effective strategies by the National Commission for the Control of the Electoral Campaign for the Presidential Election (CNCCEP) and the National Cybersecurity Agency (ANSSI). Vilmer cautions that the threat of further leaks may persist, and emphasizes a number of steps and legislation to tackle the threat of disinformation head on.

"Il n’y aura pas de monde d’après", Politique internationale, 168, été 2020, p. 131-156
La pandémie de Covid-19 ne bouleversera pas l’ordre mondial. Il n’y aura pas de « monde d’après », non seulement parce qu’il va falloir apprendre à vivre non pas « après » mais « avec » le risque sanitaire, mais aussi parce que cette crise ne traduit aucune rupture majeure : le choc actuel est moins transformateur que catalyseur, il confirme et exacerbe des tendances préexistantes. Dix d’entre elles ont le potentiel d’être les plus structurantes : la correction de la mondialisation, l’écologisation, le renforcement des Etats, la régression démocratique, la montée du nationalisme, la montée du populisme, la crise du multilatéralisme, la bipolarisation sino-américaine, l’affaiblissement de l’Europe et l’affaiblissement de la Chine.

"A Matter of Balance : A French Perspective on Limited Strikes", Ethics and International Affairs, 34:2, 2020, p. 201-215.
What are the philosophical arguments justifying limited strikes ? This essay, as part of the roundtable “The Ethics of Limited Strikes,” adopts a French perspective both because France is, along with the United States and the United Kingdom, one of the states that launched such limited strikes in recent years, and because it developed a limited warfare ethos. There is something specific about such an ethos that makes it particularly receptive to the jus ad vim framework and, therefore, to the issue of limited strikes. This essay also builds on the case of the use (or threat) of limited force in Syria as a response to the country’s use of chemical weapons between 2013 and 2018. Presented as a way to “punish” the Syrian regime as much as to “deter” it from using chemical weapons again, these limited strikes are a good illustration of the traditional retributive/preventive dichotomy of penal philosophy. I argue that the moral justification of those strikes should be guided by a consequentialist ethic, preventive rather than retributive. From a consequentialist perspective, limited strikes are justified when they “work”—that is, when they have a deterrent/compellent effect. For that to happen, they need to be credible and imply the potential of an escalation ; the challenge being to keep the escalation under control. Carrying the risk of inefficacy at one end of the spectrum and of escalation at the other, limited strikes are indeed a matter of balance.

"’Au-dessus et en avant des opérations’ : la naissance du Centre d’analyse et de prévision du Quai d’Orsay", in P. Dahan (dir.), Prévoir le monde de demain, CNRS Editions, 2020, p. 79-98., juin 2020
Le CAP, aujourd’hui le CAPS (Centre d’analyse, de prévision et de stratégie) a trois fonctions : l’analyse des évolutions des relations internationales ; la prévision à court, moyen et long termes et la stratégie au sens de la recommandation au ministre. Se fondant sur les archives diplomatiques et une série d’entretiens avec des anciens du CAP, ce chapitre revient sur cet acteur de la politique étrangère française depuis 1973 et s’intéresse à la manière dont, dans ses premières années, il s’est progressivement greffé au tissu du ministère. Il procède en trois étapes, présentant successivement les sources, la création et l’intégration du CAP.

"The Forever-Emerging Norm of Banning Nuclear Weapons", Journal of Strategic Studies, 45:3, 2022, p. 478-504 (en ligne depuis le 1er juin 2020).
The aim of this article is to assess the strength of the normative claim of banning nuclear weapons, expressed by the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons. The first part shows that, in the Finnemore/Sikkink norm lifecycle, it is likely to be stuck at the first stage (emergence), as it does not meet the conditions for reaching the tipping point and therefore cascading (a critical mass of states ; a mass of critical states ; the intrinsic characteristics of the norm ; how it fits in the existing normative framework). The second part shows that, in the three-part pattern of disarmament campaigns identified by Hanson, it is likely to be stuck at stage two, stigmatising and delegitimising nuclear weapons, but unable to eliminate them for three reasons (the exceptionality of nuclear weapons ; the international security environment ; and peer pressure). Overall, it will likely stay a forever-emerging norm.
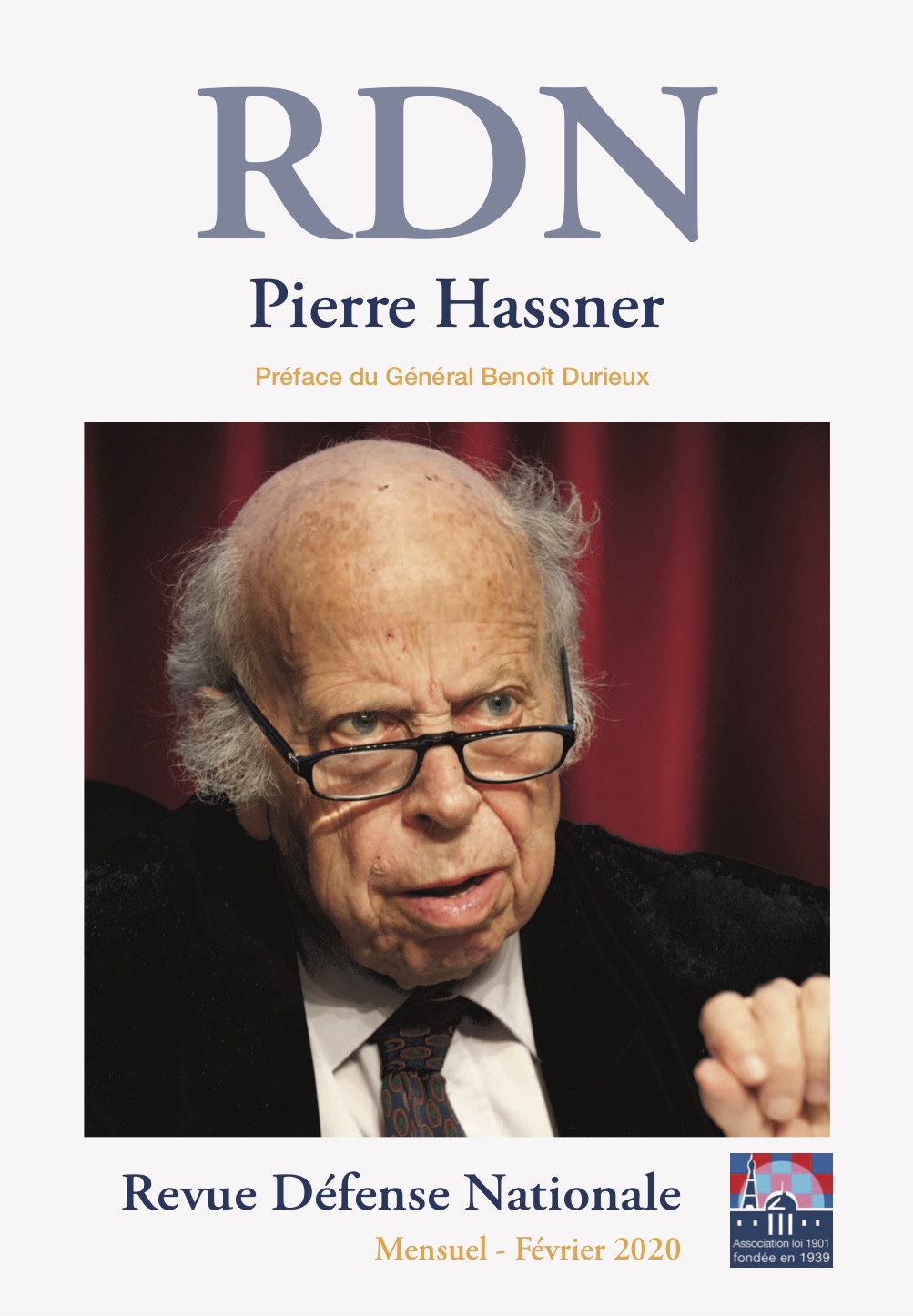
"’Maître Yoda’ : l’apport de Pierre Hassner à l’étude des relations internationales", Revue Défense Nationale, n°827, février 2020, p. 10-14.
Dans l’hommage qu’il lui rend au moment de sa disparition, Jacques Rupnik, élève et ami de Pierre Hassner, considère ce dernier comme "le plus grand spécialiste des relations internationales de ce pays depuis Raymond Aron". De fait, Hassner est assurément, sur les questions internationales et stratégiques, le penseur le plus marquant de sa génération et le plus écouté au-delà des frontières nationales. Quatre qualités peuvent expliquer l’importance de sa contribution : à la fois accessible et profond, il était aussi libre et inclassable.
"Russia as a hurricane, China as climate change : Different ways of information warfare", War on the Rocks, (with Paul Charon) 21 January 2020.
Disinformation studies have been engaged in a pivot to Asia. A growing number of scholars and governmental experts around the globe who were once fixated on Russian operations are now increasingly concerned with Chinese operations, especially since the beginning of the Hong Kong crisis. The danger in this evolution is looking at China through a Russian lens, an already widespread mistake. Both cases are very different, and any intellectually rigorous analysis encompassing both should start by contrasting them.
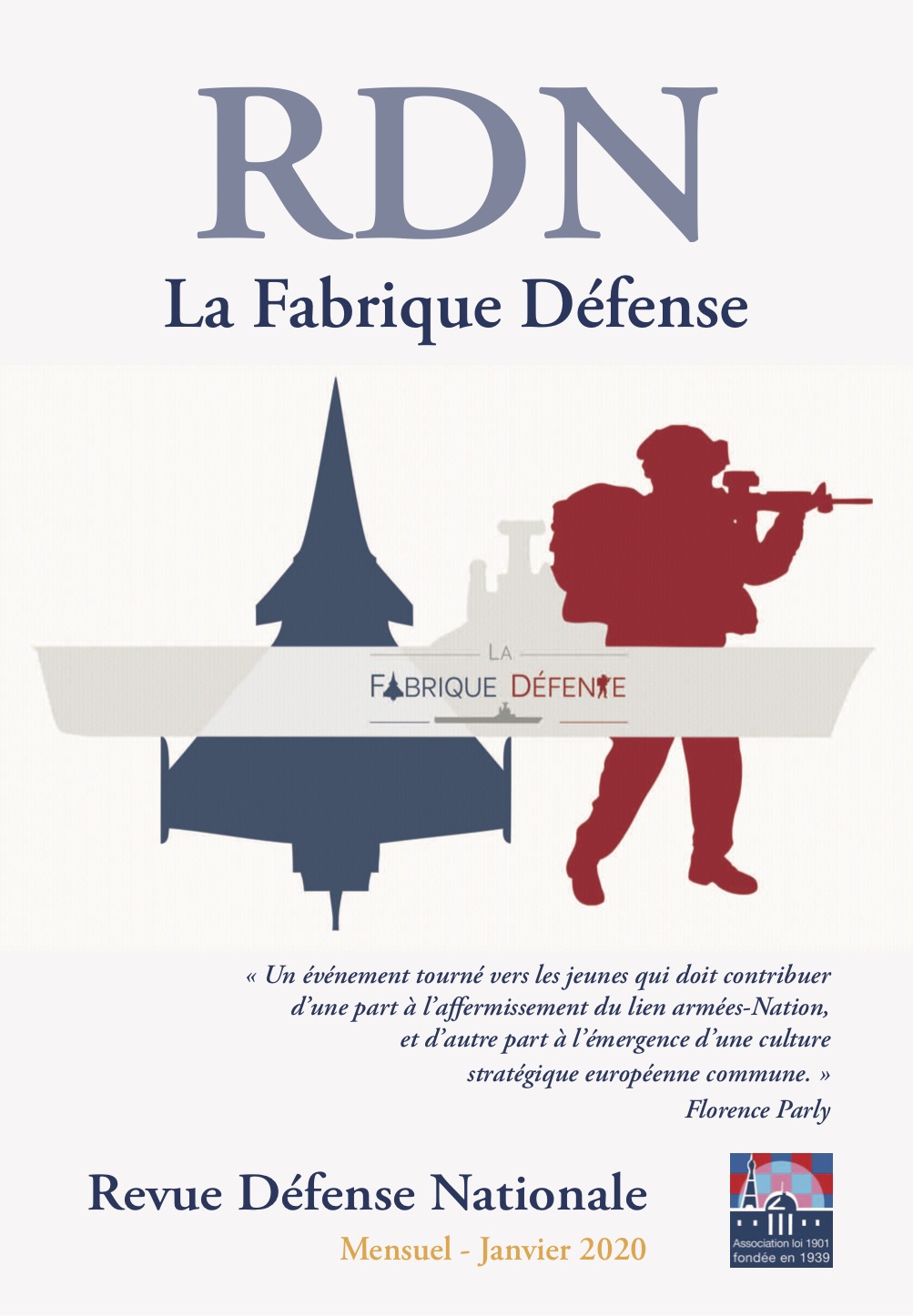
"La relève stratégique : les jeunes chercheurs de l’IRSEM", Revue Défense Nationale, n°826, janvier 2020, p. 13-20.
Si l’Institut de recherche stratégique de l’École militaire (IRSEM) est, avec d’autres, à l’origine de La Fabrique Défense (LFD), c’est parce que les jeunes font partie de sa raison d’être – en particulier les jeunes chercheurs (…). L’IRSEM a quatre missions : produire de la recherche bien sûr, mais aussi contribuer à l’enseignement militaire supérieur, contribuer au débat public sur les questions de défense et, donc, favoriser l’émergence d’une nouvelle génération de chercheurs que l’on appelle la ’relève stratégique’.

"L’"Afrique" et la Cour pénale internationale", in J. Fernandez, X. Pacreau et M. Ubédia Saillard (dir.), Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Commentaire article par article, 2e éd., Paris, Pedone, tome I, 2019, p. 229-254.
Afin de comprendre et d’expliquer la crise actuelle entre la CPI et certain pays africains et l’Union africaine, cette étude adopte une approche à la fois pluridisciplinaire et pragmatique. Elle commence par rappeler le contexte et les causes de cette crise. Elle répond ensuite aux deux principales objections de l’UA et de certains chefs d’Etats africains à l’encontre de la CPI, à savoir l’afrocentrisme et le dilemme de la paix et de la justice. Elle formule enfin des recommandations concrètes pour faciliter les relations entre les deux parties.
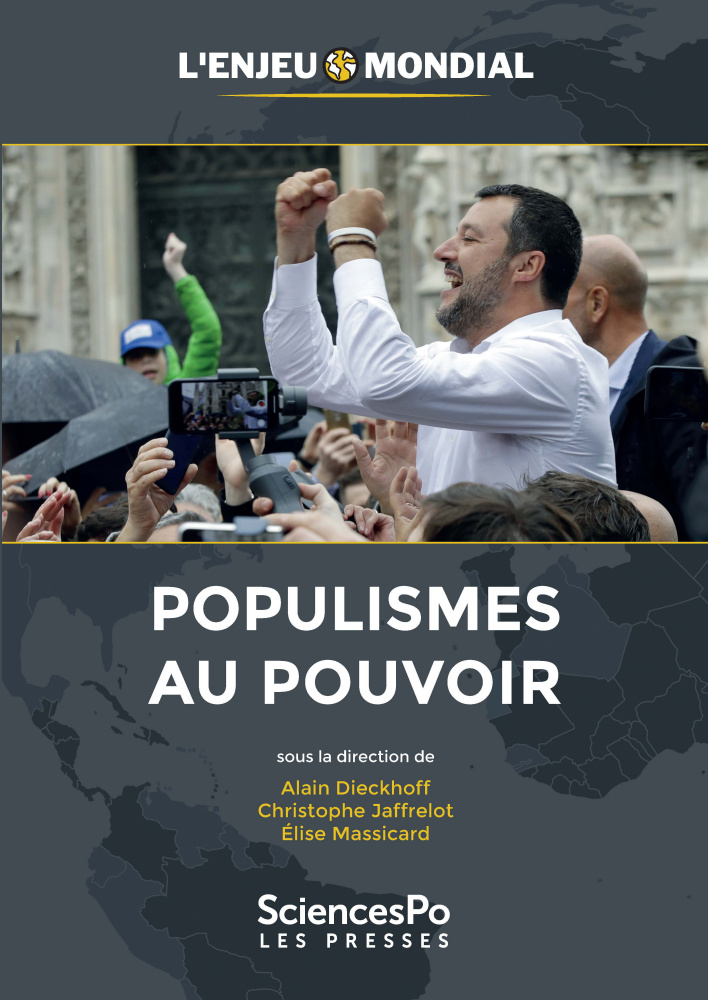
"Manipuler l’information pour accéder au pouvoir ou le conserver", in Alain Dieckhoff, Christophe Jaffrelot et Élise Massicard (dir.), L’Enjeu mondial. Populismes au pouvoir, Presses de Sciences Po, 2019, p. 287-289.
Ni le populisme ni les manipulations de l’information ne sont nouveaux, mais leur combinaison suscite aujourd’hui un regain d’intérêt. Depuis 2010 environ, on observe une "vague" populiste, en même temps qu’une forte recrudescence de manipulations de l’information. Cette corrélation ne doit rien au hasard.

"Lessons of #MacronLeaks", Berlin Policy Journal, 29 août 2019
The attempt to meddle with the French presidential election of 2017 failed. Still, it’s vital to learn the right lessons. Future disinformation campaigns will be ever more sophisticated.
"Il faut mieux protéger l’Amazonie", Le Monde, 27 août 2019
Le cas brésilien est spectaculaire mais il n’est certainement pas le seul. Se pose donc une question générale : comment contraindre un Etat souverain à protéger un bien commun qui se trouve sur son territoire et dont la destruction aurait un impact planétaire ?
"Lehren aus #MacronLeaks", Internationale Politik (IP), September / Oktober 2019, p. 85-91.
Was hilft gegen Cyberangriffe ? Eine Untersuchung der Kampagne gegen Emmanuel Macron und sein Wahlkampfteam 2017 zeigt, was funktioniert.
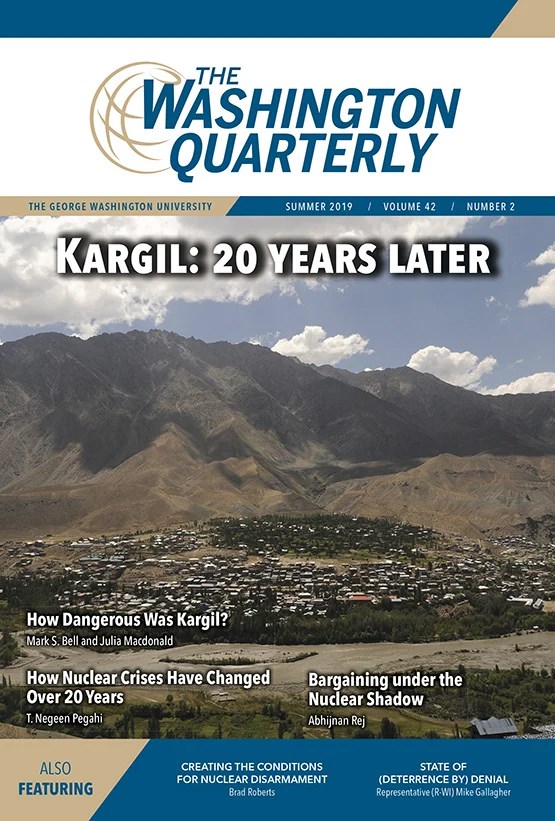
"A People-Oriented Peace Formula for the Donbass", The Washington Quarterly, 42:2, 2019, p. 115-132.
This article (A) explains the status quo (has been the preferred option for both sides) ; (B) shows it is dangerous (“transnistrization” or “abkhazization” of Donbass + facilitating organized crime + freeing Russia to increase tensions elsewhere + affecting Western credibility) ; (C) claims that now is the right time for a change (the 2019-2020 Ukrainian electoral sequence offers a unique opportunity to change the dynamic + Moscow has no exit strategy, but it has at least 3 reasons to look for one) ; and (D) finally proposes a 6-point formula : start a new diplomatic sequence, push Kiev and Moscow to negotiate, explore the potential of a UN mission, maintain unwavering yet demanding support of Kiev, be both firm and open to dialogue with Moscow, encourage a people-oriented approach.

"L’IRSEM, animateur du débat stratégique", L’ENA hors les murs (revue de l’association des anciens élèves de l’ENA), n°489, avril 2019
Conduire la recherche stratégique, favoriser l’émergence d’une nouvelle génération de chercheurs sur les questions de défense, contribuer à l’enseignement militaire supérieur et animer le débat public sur les questions de défense, telles sont les missions de l’Irsem au service des armées et du ministère.

"’Contre toute attente’, la paix entre l’Ethiopie et l’Erythrée. Causes, conséquences, scénarios", Note de recherche n°72, IRSEM, 6 mars 2019, 29 p.
Le rapprochement inattendu entre l’Éthiopie et l’Érythrée au cours de l’été 2018 a été l’un des revirements les plus spectaculaires des relations internationales de ces dernières années. L’Érythrée, qui s’est arrachée de l’Éthiopie à l’issue d’une guerre de libération nationale de trente ans (1961-1991), lui a refait la guerre en 1998-2000 et maintenait depuis un état de « ni guerre, ni paix ». Le régime s’est entièrement construit contre l’Éthiopie. Celle-ci a toujours été l’alibi commode du totalitarisme d’Issayas, qui pouvait justifier par la menace existentielle éthiopienne un certain nombre de mesures liberticides, dont le service national à durée indéterminée qui a contribué à faire fuir beaucoup de jeunes. Or, en l’espace de quelques mois, les ennemis jurés sont devenus des « frères », voire « un même peuple », et ont signé un accord de paix. Comment ? Pourquoi ? Et quelles en seront les conséquences probables ? Cette note tente d’expliquer ce rapprochement éclair en explorant les motivations de chacune des parties et le rôle des parrains régionaux. Elle en tire les conséquences, sur la politique intérieure érythréenne, la stratégie portuaire éthiopienne, les équilibres régionaux et les liens avec la communauté internationale. Enfin, elle élabore cinq scénarios sur l’évolution du régime érythréen, qui est la clé de cette nouvelle donne.

"Interdire les armes nucléaires : une fausse bonne idée", in Nicolas Haupais (dir.), La France et l’arme nucléaire, CNRS Editions, 2019, p. 175-204.
Le TIAN est-il le meilleur moyen de parvenir à ce désarmement général et complet ? Est-il un moyen garantissant un contrôle international strict et efficace ? Promouvant la stabilité internationale ? Garantissant la non-diminution de la sécurité pour tous ? Dans cette contribution, je répondrai par la négative : il y a plusieurs raisons de croire que ce traité, et au-delà le projet même d’interdire les armes nucléaires, est une fausse bonne idée. Après avoir brièvement rappelé le processus qui l’a fait naître, je ferai deux critiques : contre l’inefficacité du traité, et même sa dangerosité puisqu’il risque d’avoir des effets pervers.
"L’élimination ciblée des terroristes est à employer avec parcimonie", Le Monde, 12 février 2019, p. 21.
L’élimination ciblée, qui consiste à tuer un individu non détenu de manière préméditée et intentionnelle, s’invite régulièrement dans le débat français sur les méthodes de lutte contre le terrorisme, au prix de quelques confusions.
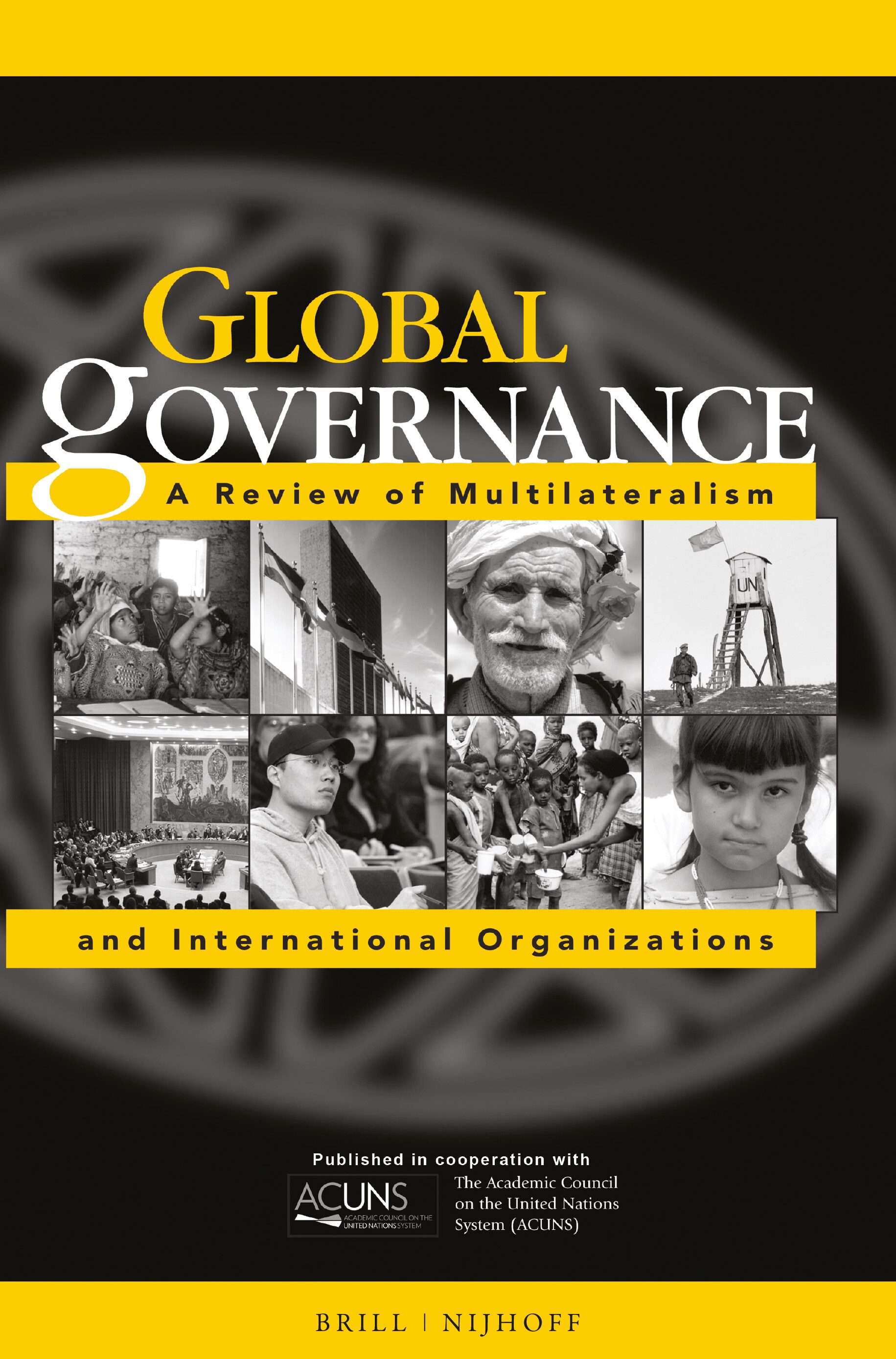
"The Responsibility Not To Veto : A Genealogy", Global Governance : A Review of Multilateralism and International Organizations, 24:3, 2018, p. 331-349.
The responsibility not to veto is the idea that the Permanent Five at the UN Security Council should voluntarily refrain from using their veto in the event of atrocities. There are currently three veto restraining initiatives, one of them from a P5 member, France. Despite its importance in diplomatic and UN circles, this debate has attracted little academic attention. This is partly because of the difficulty to access primary sources such as the details of the French proposal that circulated among the P5. Empirically focused and using diplomatic archives and experience, this article intends to fill such a gap. It provides the most detailed picture of the RN2V genealogy to date while offering a behind-the-scenes perspective on how the idea emerged and developed inside the French administration. It then unpacks the French strategy, its motivations and diplomatic efforts toward the P5, Group of 4, other states, and nongovernmental organizations, and eventually makes four recommendations for the initiative to have a chance of progressing among the Permanent Three.
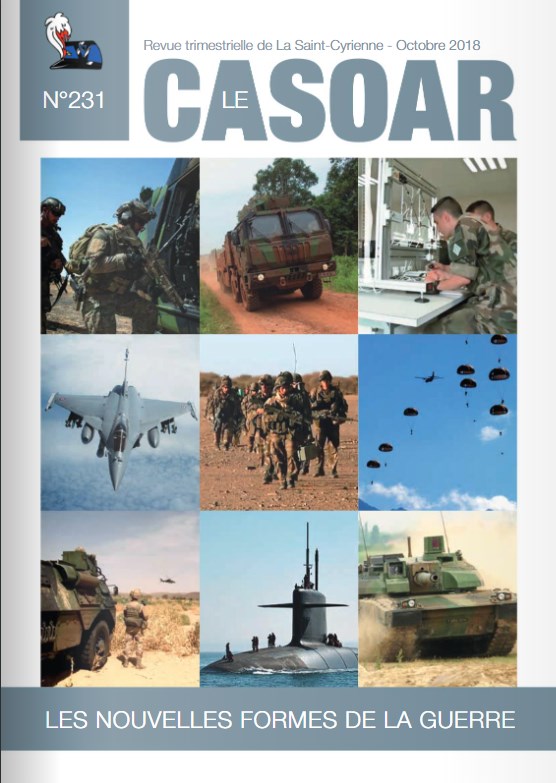
"Un monde en mutation", Le Casoar (revue trimestrielle de La Saint-Cyrienne), n°231, octobre 2018, p. 15-16.
On ne compte plus les publications qui parlent d’"un nouveau désordre mondial" pour désigner la période actuelle. Nous serions à un point de rupture, de bascule. Après la relative stabilité du monde bipolaire de la Guerre froide, et la relative clarté du moment unipolaire des années 1990, nous serions désormais dans une phase de transition, donc de turbulences. Ce schéma simpliste n’est pas faux, mais il faut le nuancer, de deux manières.

"Successfully Countering Russian Electoral Interference : 15 Lessons Learned from the Macron Leaks", CSIS Brief, Center for Strategic and International Studies, Washington D.C., juin 2018
The 2017 French presidential election remains the clearest failed attempt by a foreign entity to influence an electoral process in recent years. Taking aim at presidential candidate Emmanuel Macron, Russian interference succeeded neither in interfering with the election nor in antagonizing French society. This Brief examines how France successfully withstood the disinformation and interference ; how this failed attempt can be explained ; and, looking to the future, what lessons can be learned from this experience ?

"La relève stratégique : une première histoire du soutien aux jeunes chercheurs sur les questions de défense et de sécurité", Les Champs de Mars. Revue d’études sur la guerre et la paix, n°30, mai 2018, p. 9-43.
La "relève stratégique" désigne l’ensemble des jeunes chercheurs - doctorants ou jeunes docteurs - travaillant sur des questions de défense et de sécurité. Cet article retrace l’histoire du soutien que leur apporte l’institution, c’est-à-dire le ministère de la Défense / des Armées, des années 1960 à nos jours, par un ensemble d’actions : inciter (à faire une thèse), (s’)engager, financer, encadrer et récompenser. Il détaille pour finir l’apport actuel des deux principaux acteurs du ministère dans ce domaine, l’IRSEM et la DGRIS.
Cet article introduit le numéro 30 des Champs de Mars, la revue scientifique de l’IRSEM aux Presses de Sciences Po, un numéro double exceptionnel de plus de 760 pages, qui réunit les contributions d’une cinquantaine de jeunes chercheurs.
"Les frappes en Syrie sont-elles justifiées par la responsabilité de protéger ?", Le Monde, 14 avril 2018
Non seulement l’usage d’armes chimiques constitue au moins un crime de guerre, potentiellement un crime contre l’humanité, qui, l’un comme l’autre, relèvent bien de la R2P, mais il s’inscrit aussi dans le cadre d’une attaque généralisée et systématique du régime syrien contre une partie de son peuple depuis 2011, qui a déjà fait des centaines de milliers de victimes.
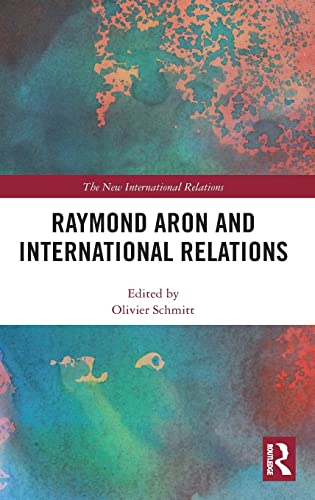
"Aron’s Oxymorus International Ethics", in Olivier Schmitt (ed.), Raymond Aron and International Relations, (Routledge, 2018, p. 70-92).
There is no normative IR theory in Aron, only unavoidable normative implications of his sociological and theoretical approach of IR, because “normative implications are inherent in every [social sciences] theory”. The aim of this chapter is to structure these implications to reveal Aron’s international ethics in three oxymorons, i.e. appearances of contradiction : a liberal realism, an inspired ethic of responsibility, and a post-Kantian Machiavellianism.
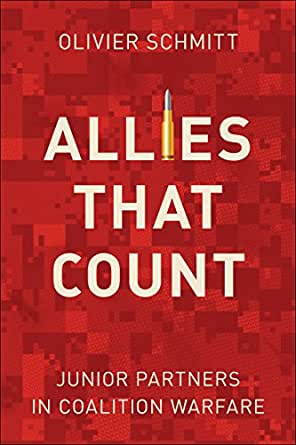
"Préface", à Olivier Schmitt, Allies That Count : Junior Partners in Coalition Warfare, Washington DC, Georgetown University Press, 2018, p. ix-xi
Allies That Count : Junior Partners in Coalition Warfare is an important work that focuses on an unfortuantely overlooked topic - junior partners in coalition warfare. Too often, scholarship and public debates related to contemporary warfare remain trapped in an artificial discussion of collective entities ("The North Atlantic Treaty Organization did X"), or they focus on the policies of the major actor, the United States. While this is partly understandable, it is also problematic as it seems to deny agency to the other partners and to lump them all together in the same category. The great benefit of Olivier Schmitt’s work is it highlights that not all junior partners are the same and that their autonomous policies can have positive effects on the conduct of a multinational intervention.
"The Kairos of European Defence", Frankfurter Allgemeine Zeitung, 17 février 2018
There are at least three reasons why the construction of a credible European Defence Union is no longer a choice but a necessity. First, Europe’s strategic environment has changed in recent years, due to numerous – and simultaneous – threats, on Europe’s territory (Russian belligerence, terrorist attacks, cyber operations, informational manipulations and organized crime) and in its neighborhood (the Middle East and Africa). An additional difficulty is the blurring of lines : between internal security and external defence, state and non-state actions, terrorism and crime.
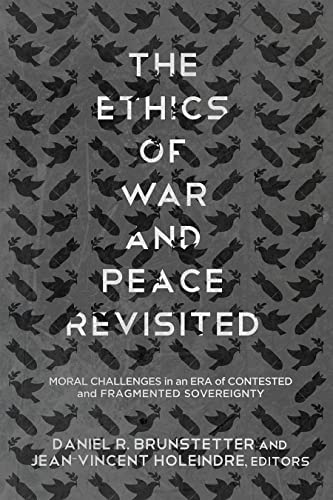
"France and the American Drone Precedent : A Consequentialist Response to a Polemical Critique", in Daniel R. Brunstetter and Jean-Vincent Holeindre (eds.), The Ethics of War and Peace Revisited, (Georgetown University Press, 2018), p. 97-116.
As France contemplates arming its drones, this chapter asks the following question : What have we learned about the specific advantages of drones and their application in foreign affairs from the American precedent ? In answering this question, the chapter assesses the legitimacy of armed drones as a means, and targeted killing as a policy, duringover the past two decades. The chapter is framed as a partial response to correct some of the misconceptions about drones found in Grégoire Chamayou’s work Théorie du drone (A Theory of the Drone ; originally published in 2013, and translated into English in 2015).
"L’élimination des armes nucléaires n’a de sens que si elle est accomplie partout et par tous", Le Monde, 11 octobre 2017
La Campagne internationale pour l’abolition des armes nucléaires (ICAN) a obtenu le prix Nobel de la paix pour sa contribution au traité d’interdiction des armes nucléaires, adopté à l’Assemblée générale des Nations unies le 7 juillet par 122 Etats voulant éliminer ces armes « de manière irréversible, vérifiable et transparente ». L’objectif semble louable, mais le moyen est inadapté.

"Introduction", in B. Durieux, J.-B. Jeangène Vilmer et F. Ramel (dir.), Dictionnaire de la guerre et de la paix, Paris, PUF, 2017, p. xxv-xxix.
Interventions militaires, opérations de contre-insurrection, maintien de la paix, frappes aériennes, éliminations ciblées…Le mot même de « guerre », dont il n’existe aucune définition consensuelle, tend à disparaître tant du lexique politique que du vocabulaire scientifique. Pour commencer, on ne la déclare plus. L’exigence de la déclaration de guerre, introduite lors de la conférence de La Haye de 1907, n’a jamais été respectée. Ainsi, la France n’a pas déclaré la guerre depuis la Seconde Guerre mondiale. On l’invoque parfois, dans des déclarations martiales, mais ce choix relève davantage de la communication politique que d’un changement d’état : contrairement à « intervention », un néologisme inventé au XIXe siècle précisément pour éviter de parler de guerre, et qui donne dans l’analogie médicale, voire chirurgicale, présupposant que l’opération sera propre, rapide et bénéfique, « guerre » est parfois employé pour souligner que l’affaire est sérieuse, que le combat sera long et qu’il faudra faire des sacrifices. Cet usage très mou est l’écume d’une critique scientifique profonde.

"Autonomes (armes)", in B. Durieux, J.-B. Jeangène Vilmer et F. Ramel (dir.), Dictionnaire de la guerre et de la paix, Paris, PUF, 2017, p. 142-149.
Les systèmes d’armes létaux autonomes (SALA), souvent appelés « robots tueurs », sont théoriquement dotés d’une capacité de désigner leur cible et d’ouvrir le feu sans intervention ni supervision humaine. Leur développement s’inscrit dans une tendance générale et inévitable à la robotisation militaire.

"Préventive (guerre)", in B. Durieux, J.-B. Jeangène Vilmer et F. Ramel (dir.), Dictionnaire de la guerre et de la paix, Paris, PUF, 2017, p. 1080-1087.
La guerre préventive est d’abord un paradoxe : faire la guerre pour l’éviter. La prévention devient la motivation de la guerre, et la guerre le moyen de la prévention. Mais prévenir quoi ? Un mal plus grand, une guerre plus dévastatrice. Le paradoxe résulte du fait que le moyen et la fin sont les mêmes, en présupposant que la guerre qu’on fait est préférable à celle qu’on évite de cette manière. La guerre préventive présente donc l’originalité d’être à la fois offensive et défensive. Comme le disait Suárez, habituellement « la défensive est affaire de nécessité, l’offensive une question de choix ». Mais la guerre préventive se présente comme une défense offensive par nécessité.

"Responsabilité de protéger", in B. Durieux, J.-B. Jeangène Vilmer et F. Ramel (dir.), Dictionnaire de la guerre et de la paix, Paris, PUF, 2017, p. 1196-1201.
La responsabilité de protéger (R2P) est une doctrine par laquelle les États s’engagent à protéger les populations des atrocités de masse (génocide, crimes contre l’humanité, nettoyage ethnique, crimes de guerre), qui s’organise autour d’une double responsabilité : celle, principale, de l’État territorial et celle, subsidiaire, de la « communauté internationale ».
"The French Turn to Armed Drones", War on the Rocks, 22 septembre 2017
On Sept. 5, French Minister of the Armed Forces Florence Parly announced the long-awaited decision to arm French surveillance drones. French drones are currently unarmed, used only for intelligence, surveillance and reconnaissance missions, like the Reapers based in Niamey, Niger. Given that a dozen countries already have armed drones, this decision is surprising only in its delay. Why did it take so long to arm French drones ? How did it finally happen ? And what are the strategic implications of such a decision ? While the French debate on this topic has been influenced by the American precedent, there are ways for France to reap the strategic benefits of armed drones in the Sahel while avoiding the political fallout that the United States has experienced.
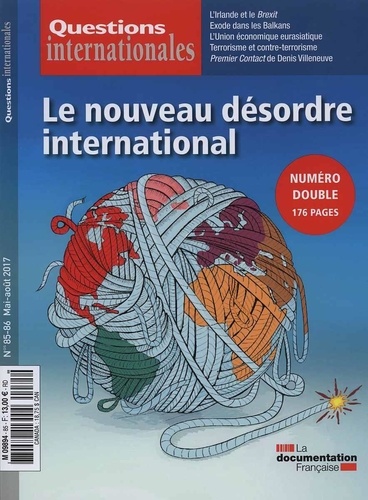
"Comment parler du monde ?", Questions internationales, n°85-86, mai-août 2017, p. 128-134
Si le monde n’est plus bipolaire ni unipolaire, qu’est-il devenu ? Peut-on encore le qualifier dans toute sa généralité ? La multiplicité et la simultanéité des crises sont le symptôme d’un changement de monde. Un monde déstructuré, dans une phase de transition qui a du mal à trouver son nom. Un monde diffus et partagé, qui témoigne de la dispersion de la puissance, des acteurs et des valeurs. Un monde confus aussi, complexe et imprévisible. Et un monde désenchanté, qui doute de sa capacité à assurer la sécurité collective.

"La lutte contre la désinformation russe : contrer la propagande sans faire de contre-propagande ?", Revue Défense Nationale, n°801, juin 2017, p. 93-105.
Il existe de nombreux travaux sur l’influence russe, mais peu sur la désinformation qui est l’un des moyens utilisés et encore moins sur les manières d’y répondre. Dans la lutte contre la désinformation russe, qui occupe désormais de façon explicite l’UE, l’OTAN et plusieurs États, la consigne est de contrer la propagande sans faire de contre-propagande. Comment ? Cet article tente de le montrer en trois parties : d’abord en définissant des termes souvent employés indifféremment et qu’il ne faut pourtant pas confondre. En l’occurrence, la désinformation n’est pas exactement la même chose que la propagande. Ensuite, en rappelant ce qui est fait pour lutter contre la désinformation russe, par l’OTAN, l’UE, les États et la société civile. Enfin, en envisageant ce qui reste à faire, sous la forme de 25 propositions concrètes.
English summary : https://euvsdisinfo.eu/25-ways-of-c...
России резюме (résumé en russe) : https://lb.ua/news/2017/06/19/36945...
Tiivistelmä Suomi (résumé en finnois) : http://www.verkkouutiset.fi/ulkomaa...

"Studying War", Editorial of the Réseau Asie & Pacifique, June 2017
The Institute for Strategic Research (IRSEM) is the research institute of the French Ministry of Armed Forces. Its purpose is to lie at the intersection of defense and academia. Created in 2010 by the merging of four Ministry research centers, it consists of around forty staff, both civilian and military. Its principle goals are to improve French research into security and defense issues and eventually generate dedicated “War Studies”, which has so far not been consolidated as a field in France.

"Etudier la guerre", Edito du Réseau Asie & Pacifique, juin 2017
L’institut de recherche stratégique de l’École militaire (IRSEM) est un institut de recherche du ministère des Armées, dont la singularité est d’être à l’intersection des mondes de la Défense et de l’Université. Créé en 2010 par la fusion de quatre centres de recherches du ministère, il est composé d’une quarantaine de personnes, civiles et militaires. Sa mission principale est de renforcer la recherche française sur les questions de défense et de sécurité, pour faire émerger à terme des « études sur la guerre » (War Studies), qui pour l’instant ne sont pas un champ consolidé en France.

"Le tournant des études sur la guerre en France", Revue Défense Nationale, n°800, mai 2017, p. 51-61.
Ces dernières années s’est constitué un véritable mouvement en faveur de « War Studies » à la française, animé par une poignée d’universitaires et soutenu par le ministère de la Défense. L’article revient en introduction sur la nature des « études sur la guerre », définies comme le domaine de recherche pluridisciplinaire ayant la guerre au sens large pour objet, et ce qui les distingue d’autres espèces proches (études stratégiques, études de sécurité, études de défense, etc.).
Il procède ensuite en trois parties :
1/ Le retard français Les War Studies sont reconnues comme une discipline académique dans le monde anglophone depuis au moins un demi-siècle. En France, les nombreuses tentatives de créer à l’université des centres de recherche ou des formations dans ce domaine depuis le début de années 1970 ont rarement duré et/ou n’ont jamais atteint la taille critique. Comment l’expliquer ?
2/ Le rattrapage actuel Depuis quelques années, la donne a changé pour plusieurs raisons : le renouvellement générationnel, le contexte sécuritaire, le rôle du ministère de la Défense, le début d’une fécondation croisée entre militaires et chercheurs, et le fait de présenter la matière sous le label « études sur la guerre », plus inclusif que « études stratégiques » ou « études de défense ».
3/ Les défis futurs Les efforts consentis par plusieurs acteurs pour développer les études sur la guerre en France ces dernières années sont sans précédent, mais les difficultés sont telles que l’on ne pourra pas faire l’économie d’une approche globale : ce sont les mentalités qu’il faut changer, de l’intérieur des milieux académique et militaire. Dans les milieux académiques, deux défis principaux subsistent : la scientificité du champ et l’interdisciplinarité. Dans les milieux militaires, le défi principal est l’attractivité de la recherche, qui n’est généralement pas valorisée dans la carrière.
"The Ten Main Defense Challenges Facing Macron’s France", War on the Rocks, 10 mai 2017
Emmanuel Macron will be the next president of France. For the first time in the history of the Fifth Republic (since 1958), both final candidates were outside the bipolar, mainstream left-right party system. The winner, France’s youngest-ever president, has never held elected office before, and is not a member of any political party. That is indeed a political “revolution” — the title of his campaign book. Now is the time to consider the main defense challenges France will face with Macron at the helm. Although the unexpected twists and turns of recent history demand a certain humility when making forecasts, one can still wager that geopolitics will remain eventful over the next five years. Below are the ten main defense challenges, in no particular order, that await the presidency of Macron.

"Les dix principaux enjeux de défense du prochain quinquennat", Défense & Sécurité Internationale (DSI), n°128, mars-avril 2017, p. 40-44.
Les dernières années invitent plutôt à l’humilité en matière d’anticipation. On peut toutefois parier que le prochain quinquennat sera au moins aussi chargé de menaces que celui qui s’achève. Voici dix des principaux enjeux de défense qui attendent la prochaine équipe, le onzième étant d’en définir l’ordre de priorité...

"Préface", à Lieutenant-colonel O. Entraygues (dir.), L’Âge du drone, Polémoscopie n°2, Editions Le Polémarque, 2017, p. 7-13.
Le vaste débat dont les drones militaires aériens font l’objet depuis une dizaine d’années est souvent confisqué par ceux qui ne connaissent ni le fonctionnement ni l’emploi de ces appareils mais s’y opposent malgré tout comme à l’incarnation aérienne du mal. Ils confondent soit la chose et l’un de ses usages, c’est-à-dire le drone et les campagnes américaines ou israélienne d’éliminations ciblées (c’est ce que j’appelle le « syndrome Chamayou »), soit le drone et les soi-disant « robots tueurs », c’est-à-dire les systèmes d’armes létaux autonomes qui n’existent pas encore et qui, contrairement aux drones, ne seront pas pilotés (« syndrome Terminator »).

"La compétence universelle à l’épreuve des crises diplomatiques", Revue de science criminelle et de droit pénal comparé (RSC), 4/2016, p. 701-724.
La compétence universelle est la capacité des juridictions nationales de poursuivre l’auteur présumé de certains crimes quel que soit le lieu où ceux-ci ont été commis et quelle que soit sa nationalité ou celle des victimes. Partant d’une intention louable – créer une insécurité juridique pour les crimes les plus graves, pour que leurs auteurs ne soient en sécurité nulle part –, elle place le décideur dans un dilemme entre le respect de ses obligations internationales et la prise en compte des contraintes de la realpolitik. À l’intersection de la politique étrangère et de la théorie normative du droit, cet article s’intéresse à la dimension politique de la compétence universelle, et en particulier à son effritement progressif à cause des crises diplomatiques qu’elle suscite.
Universal jurisdiction is the ability of national courts to prosecute the alleged perpetrator of certain crimes wherever they were committed, and whatever the perpetrator and victims’ nationalities may be. Stemming from a laudable intention - to create legal insecurity for the perpetrators of the most serious crimes, so that there is nowhere that they are safe -, it places the decision-maker in a dilemma between the respect of his international obligations and the constraints of realpolitik. At the intersection of foreign policy and normative legal theory, this article focuses on the political dimension of universal jurisdiction, and in particular on its gradual erosion due to the diplomatic crises it generates.
"Five recommendations to pacify relations between the ICC and Africa", Just Security, 2 décembre 2016
Three African countries – South Africa, Burundi and Gambia — recently started the process to leave the Rome Statute, the treaty that established the International Criminal Court, and others could follow suite. This is unprecedented in the history of international criminal justice, but the risk of a domino effect is low, as withdrawing from the ICC is costly, and not only in terms of image as it potentially involves retaliatory measures (such as cutbacks in EU or US development aid). At the recent Assembly of States Parties, even critical states like Kenya and Uganda, which have been behind the African Union’s backlash against the court for years, were either silent or supportive. Even though the current hemorrhage does not threaten the Court, it does confirm it has a serious image problem at the least. For more on this topic, Just Security already has an excellent series of contributions. In the last issue of International Affairs, Chatham House’s peer-reviewed academic journal, I also published an article on “The African Union and the International Criminal Court : counteracting the crisis.” I will summarize and build on that article here, focusing on the recommendations I propose to repair relations.
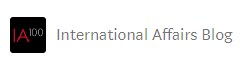
"African nations and the International Criminal Court : the real motives behind withdrawal", International Affairs Medium blog, 28 novembre 2016
On 20 October 2016, South Africa became the first nation to withdraw from the International Criminal Court (ICC). Burundi followed on 27 October ; Gambia on 10 November. Others could follow suit. This is unprecedented in the history of international criminal justice. Russia’s announcement of its withdrawal on 16 November, on the other hand, following the publication of an ICC’s preliminary report into the 2014 annexation of Crimea, is not the real news story. Having signed but not ratified the statute, it was never a real member of the court. How then can this ‘Afrexit’ be explained ? Why are African countries in particular leaving the ICC ?

"The African Union and the International Criminal Court : Counteracting the crisis", International Affairs, 92:6, 2016, p. 1319-1342.
In October 2016, South Africa became the first nation to withdraw from the Rome Statute of the International Criminal Court (ICC), after Burundi began taking steps to leave it. Kenya is likely to follow, and other states, like Uganda, could take the same cue. The ICC is facing the most serious diplomatic crisis of its history, with the African Union (AU) denouncing double standards, neo-colonialism and ‘white justice’, and regularly threatening to withdraw from the Rome Statute en masse. This article adopts both an interdisciplinary and a pragmatic policy-oriented approach, with the aim of producing concrete recommendations to counteract the crisis. It firstly outlines the context of this crisis which, although not new, is becoming increasingly serious. It then responds to the AU’s objections to the ICC. The court’s ‘Afro centrism’ is explained by objective facts (the occurrence of mass crimes taking place on the African continent, the large number of African parties to the Rome Statute, the principle of complementarity) as well as by subjective decisions (a convergence of interest between the African leaders who brought the cases to the court themselves to weaken their opponents, and the prosecutor who needed quickly to find cases). Afro-centrism should also be nuanced, as the ICC has already shown an interest in cases outside Africa and the extent to which it is a problem is a matter of perspective. The article also responds to the ‘peace vs justice’ objection, and emphasises that African states were instrumental in creating and sustaining the ICC. It finally formulates recommendations to ease relations between the ICC and AU, such as to investigate more outside Africa, reinforce African national jurisdictions, create intermediary institutional structures, promote regional-level action, and rely more on ICC-friendly African states and African civil society.
"L’Afrique et la Cour pénale internationale : chronique d’un divorce annoncé", The Conversation France, 3 novembre 2016
Un article long qui revient sur les motivations réelles des Etats démissionnaires (Afrique du Sud, Burundi, Gambie) et qui confirme que c’est une lecture politique - et non "raciale" - qu’il faut faire de la situation : chacun des chefs d’État a des raisons particulières de quitter la CPI, qui n’ont rien à voir avec la critique postcoloniale leur servant de prétexte. L’effet domino devrait être limité, mais confirme que la Cour a un sérieux problème d’image.
"L’Afrique et la Cour pénale internationale (2/2) : comment sortir de l’impasse ?", Le Monde Afrique, 1er novembre 2016
Un article court qui fait des propositions concrètes car contre-argumenter (pas une justice de "Blancs") et développer un discours positif (les Etats africains ont joué un rôle important dans la création et le développement de la CPI) ne suffira pas : il faut (1) « désafricaniser » la Cour, (2) renforcer les juridictions nationales, (3) créer des structures intermédiaires entre la CPI et l’UA et (4) s’appuyer sur les Etats parties amis et la société civile africaine.
"L’Afrique et la Cour pénale internationale (1/2) : une justice de ’Blancs’ ?", Le Monde Afrique, 31 octobre 2016
Un article court sur le prétendu afro-centrisme de la CPI qui (1) se nuance, (2) s’explique, (3) est en réalité l’œuvre des Etats africains eux-mêmes, qui ont africanisé la CPI en voulant l’instrumentaliser, et (4) n’est qu’une excuse pour une poignée de dirigeants jouant la partition du populisme anticolonialiste pour mieux dissimuler leurs intérêts égoïstes.

"Autonomous Weapon Diplomacy : The Geneva Debates", Ethics & International Affairs, Online Exclusive, 27 September 2016
Autonomous weapon systems – “Killer robots” in the popular culture – are weapon systems that can select and attack targets without human intervention. The first informal experts’ meeting on lethal autonomous weapons systems (LAWS) was organized in 2014 at the UN Convention on Certain Conventional Weapons (CCW) in Geneva, on the initiative of France, which also presided over the meeting. The last of these annual meetings took place April 11–15, 2016, under German presidency for the second consecutive year.

"Recension du livre de John Bew", Realpolitik : A History, (Oxford University Press, 2016), Revue française de science politique, 66:3-4, 2016, p. 584-585.
Qu’est-ce donc que la Realpolitik ? Se revendiquant de l’école de Cambridge en histoire des idées, dont Quentin Skinner est l’auteur le plus influent, John Bew propose une approche contextualisée supposant que les idées et discours politiques ne peuvent être compris qu’en les replaçant dans leur contexte historique d’énonciation. Dans cet ouvrage passionnant qui constitue la meilleure histoire du concept, il montre comment la naissance de la Realpolitik est « inextricablement liée aux révolutions européennes de 1848 [qui], à certains égards, étaient les équivalents, au 19e siècle et en Europe, des Printemps arabes ».

"Diplomatie des armes autonomes : les débats de Genève", Politique étrangère, 3:2016, p. 119-130.
Les systèmes d’armes létaux autonomes (SALA) n’existent pas encore mais pourraient bien transformer la manière dont les guerres seront menées demain. Depuis 2014, l’Organisation des Nations unies (ONU) a entamé une réflexion sur ces armes d’un genre nouveau, dont certains États voudraient interdire le développement. Si une telle interdiction paraît peu vraisemblable, on devrait néanmoins voir apparaître un code de "bonnes pratiques" encadrant leur utilisation.
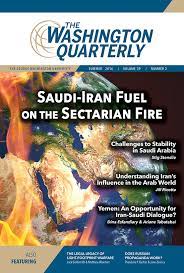
"Ten Myths About the 2011 Intervention in Libya", The Washington Quarterly, 39:2, 2016, p. 23-43.
Abstract (by TWQ) : Libya is still undergoing a violent post-Gaddafi transition, with criticisms of the 2011 international military intervention becoming increasingly vocal. Some are justified, but a French policy planning adviser responds to ten other common criticisms, and the myths upon which they are based, to help reassess further Western assistance to Libya.
(Cet article n’est pas exactement le même que la version française)
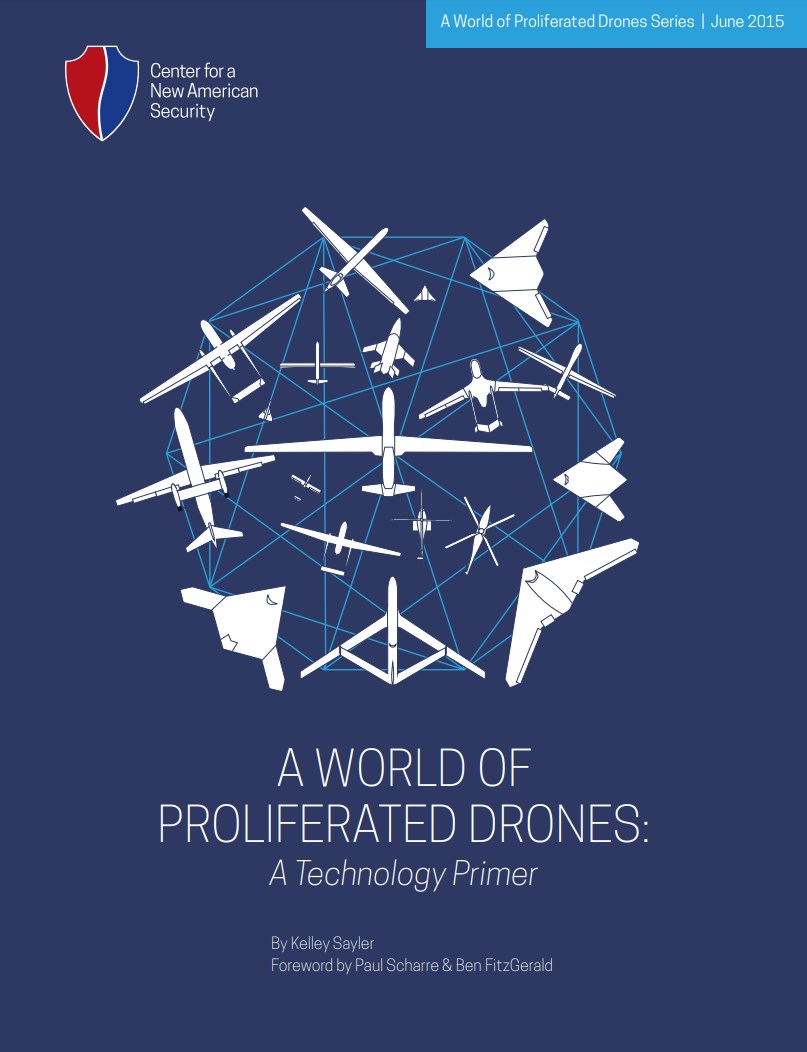
"Proliferated Drones : A Perspective on France", in Kelley Sayler (ed.), Proliferated Drones, Washington D.C., Center for a New American Security (CNAS), 27 May 2016
France has a long history of using drones. One of the very first drones – the remote-controlled World War I-era Voisin 8 biplane tested in 1917 – was French. Today, drones of all sizes are used in both domestic and foreign operations. While unarmed drones are used exclusively for intelligence, surveillance, and reconnaissance (ISR) as a complement to manned platforms, there is a debate emerging over the possible weaponization of the American-built, French-operated MQ-9 Reapers used in Operation Barkhane. By 2025 France will likely possess an unmanned combat air vehicle (UCAV), which is necessarily armed, to deploy in denied airspaces in combination with Rafale jet fighters. However, in acquiring and deploying drones, France is facing several financial, human resource, public perception, and cultural constraints.
" Drones armés, drones de combat et "robots tueurs"", The Conversation France, 29 avril 2016
(avec le colonel Christophe "Taraz" Fontaine) - Dans leur article intitulé « Drones de combat et éthique de la guerre : le débat est politique », Ludovic Fabre et Yves Auffret relaient les arguments habituels contre les drones armés, qui manqueraient de précision, feraient des dommages collatéraux, réduiraient la distinction entre combattant et non-combattant et augmenteraient l’asymétrie entre grandes et petites puissances. Ils ont raison d’utiliser le conditionnel car ces accusations sont largement discutables et nous y avons répondu ailleurs (par exemple ici, là ou encore là). Ce n’est pas sur le débat éthique que nous souhaitons réagir cette fois, mais sur la description des drones, qui n’est pas neutre et témoigne selon nous d’un certain nombre de confusions regrettables.

"Les éliminations ciblées sont-elles légales ?", Défense & Sécurité Internationale (DSI), hors-série n°47, avril-mai 2016, p. 60-62.
Il y a deux principaux débats autour des éliminations ciblées : l’un sur leur légalité, l’autre sur leur effi cacité. Je me limite ici au premier. Je parle d’ "éliminations ciblées" et non d’"assassinats ciblés", contrairement à l’usage le plus répandu en langue française, qui pourtant traduit l’anglais targeted killings (et non targeted assassinations). "Éliminations ciblées" est neutre : c’est le fait de tuer un individu non détenu de manière préméditée et intentionnelle, mais sans présumer de la légalité ou de l’illégalité de l’action. "Assassinats ciblés" en revanche est connoté puisque l’assassinat est par définition illégal. Pour l’élimination, c’est plus complexe.
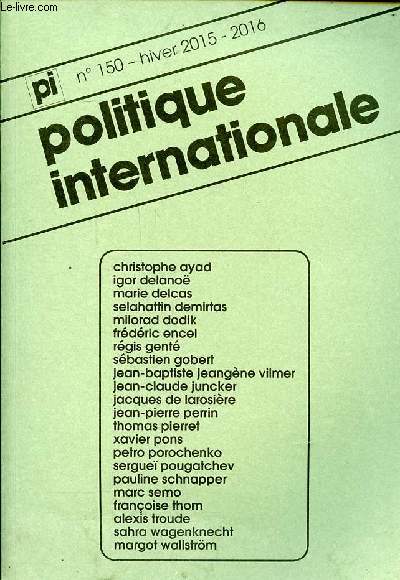
"Dix idées reçues sur l’intervention en Libye", Politique internationale, 150, hiver 2015-2016, p. 331-346.
La progression de Daech en Libye conduit à s’interroger sur la situation de ce pays et, tout particulièrement, sur les responsabilités de ceux qui sont à l’origine du chaos actuel — responsabilités souvent décrites de façon approximative. De plus en plus de voix s’élèvent pour critiquer l’intervention militaire qui, il y a cinq ans, a contribué à la chute de Kadhafi et qui, aujourd’hui, cristallise l’ensemble des reproches adressés aux interventions militaires occidentales. On l’accuse d’avoir été conduite en violation du droit international et de s’être révélée un remède pire que le mal qui a causé les turbulences actuelles dans le pays et déstabilisé toute la région. Fréquente dans l’opinion française, omniprésente chez les BRICS, cette lecture de l’histoire pollue les relations de la France avec le reste du monde et sape la légitimité de ses autres interventions. Au moment où l’accord de Skhirat indique une direction et un peu d’espoir, il importe de revenir sur les événements de 2011 pour répondre aux critiques. Toutes ne sont pas injustifiées, mais la plupart relèvent d’interprétations tendancieuses et certaines sont même fondées sur des contrevérités.
1. Non, l’intervention n’est pas responsable des désordres actuels en Libye 2. On ne peut pas prouver qu’il aurait été préférable de ne pas Intervenir 3. Oui, la bataille de la reconstruction a été perdue, mais pouvait-elle être gagnée ? 4. Non, la résolution 1973 n’a pas été dévoyée 5. Non, l’objectif de l’intervention n’était pas de tuer Kadhafi 6. Oui, il y avait vraiment des raisons humanitaires d’intervenir 7. Non, il n’y avait pas d’issue pacifique à la crise 8. Non, l’intervention n’a pas fait des dizaines de milliers de morts 9. Non, la Libye n’a pas tué la responsabilité de protéger 10. Non, l’intervention n’était pas l’expression du néocolonialisme occidental
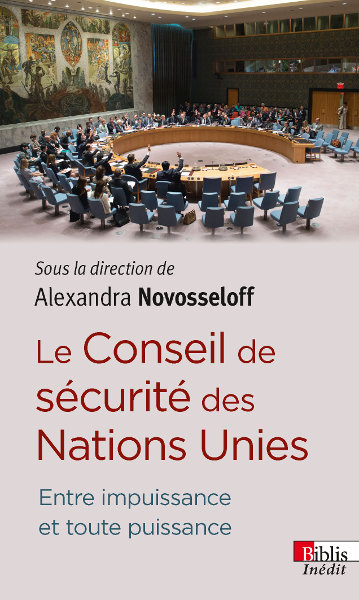
"Le veto est-il un attribut de la puissance ? Le cas de la France", in A. Novosseloff (dir.), Le Conseil de sécurité des Nations Unies : entre impuissance et toute puissance,, Paris, CNRS Editions, Biblis inédit, 2016, p. 285-296.
Afin de savoir si le veto et le statut de membre permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies sont, dans le cas de la France, des atouts de la puissance au XXIe siècle, nous procéderons en quatre temps : (1) il faut d’abord savoir ce qu’on entend par puissance, comment la définir et quels sont ses critères. (2) On peut ensuite déduire si le statut de membre permanent et le veto sont des attributs de la puissance ainsi définie ; puis, (3) en s’appuyant sur la pratique du veto, (4) conclure sur le cas de la France et examiner quel rôle joue le veto dans sa puissance.

"Vers un droit global de l’ennemi ? L’encadrement normatif des éliminations ciblées", in K. Benyekhlef (dir.), Vers un droit global ?,, Montréal, Editions Thémis, 2016, p. 201-220.
La politique américaine d’éliminations ciblées au Pakistan et, dans une moindre mesure, au Yémen et en Somalie, donne lieu à d’intenses débats médiatiques et académiques depuis maintenant plusieurs années. Ils font l’objet de trois confusions qu’il faut d’emblée clarifier.

"Droits humains et conflits armés", Philosophiques, 42:2, 2015, p. 311-333.
À première vue, il s’agit d’une chose et son contraire : la guerre est tellement le lieu par excellence de la violation des droits humains que leur relation semble se résumer à cet antagonisme primaire — l’un serait la négation de l’autre. La guerre viole les droits et les droits ont la paix, donc l’absence de guerre, comme condition de possibilité. Puis l’on se souvient que, contrairement aux apparences, la guerre n’est pas cet état de non-droit où tout est permis, mais un espace normé, codifié. Il est question des droits humains pendant la guerre — pour dénoncer leur violation, certes, mais la violation des règles n’est pas la preuve de leur absence — mais aussi avant la guerre, puisque certains conflits sont justifiés par la protection des droits des populations locales, ou en vertu d’un « droit de l’humanité » qui serait un intérêt à agir. Les relations entre droits humains et conflits armés sont résumées dans cet article en quatre parties : d’un point de vue historique, d’abord, où l’on montre leur réciprocité (le rôle de la guerre dans l’évolution des droits humains, et le rôle des droits humains dans l’évolution de la guerre). En reprenant la trilogie de l’éthique de la guerre ensuite : la guerre au nom des droits humains (jus ad bellum), les droits humains dans la guerre (jus in bello) et, en guise de conclusion, les droits humains après la guerre (jus post bellum).
At first glance these two terms may seem contradictory. War is the most extreme context of human rights violations, suggesting that they have a fundamentally antagonistic relationship and that one is the negation of the other. War violates rights, while rights require peace and hence the absence of war. Despite this appearance, however, war is not a state of lawlessness where all is permitted, but rather a regulated, codified space. There is a question of human rights in war and we obviously denounce their violation, but the violation of rules is not proof of their absence. There is another question of human rights before war, since certain conflicts are justified by the protection of the local population’s rights, or the “rights of humanity” as a cause for action. This article summarises the relations between human rights and armed conflicts in four sections : firstly from a historical perspective, focusing on their reciprocity (war’s role in the evolution of human rights and the role of human rights in the evolution of war). The next sections follow the trinity of the ethics of war : war in the name of human rights (jus ad bellum), human rights in war (jus in bello) and, to conclude, post-war human rights (jus post bellum).

"Pour des War Studies en France : un diagnostic et des propositions", (avec Jean-Vincent Holeindre), Revue Défense Nationale, n°785, décembre 2015, p. 53-59
En France, les études sur la guerre ne bénéficient pas de la reconnaissance institutionnelle et scientifique qu’elles ont dans d’autres pays comparables. Nous proposerons un diagnostic de la situation, avant d’en venir aux propositions. Le champ des études sur la guerre a longtemps souffert, et souffre encore, d’un double mal : la marginalisation et la fragmentation. Il a cependant été considérablement renouvelé depuis une quinzaine d’années par de nouveaux travaux issus d’une génération émergente, qui donne de l’espoir et un certain écho aux propositions suivantes.
"Les fondements de l’intervention française en Syrie", La Croix, 27 novembre 2015, p. 12-13.
Si la prohibition de l’usage de la force dans la charte des Nations unies peut à juste titre être considérée comme l’aboutissement le plus important du droit international contemporain, il reste trois manières légales d’utiliser la force armée : le consentement de l’État hôte, la légitime défense et l’autorisation du Conseil de sécurité.
"Penser la guerre (plaidoyer pour des War Studies en France)", Le Monde, 27 novembre 2015
(avec Thierry Balzacq, Frédéric Charillon, Jean-Vincent Holeindre, Hugo Meijer, Alice Pannier, Frédéric Ramel, Jean-Jacques Roche et Olivier Schmitt) - En réaction aux attaques terroristes de Daech, le président du CNRS a récemment appelé à « comprendre dans le détail et avec toute la profondeur nécessaire les phénomènes qui sont à l’œuvre aujourd’hui ». C’est une ambition forte et nécessaire. Il faut désormais s’en donner les moyens.
"Frogs of War : Explaining the New French Military Interventionism", War on the Rocks, 14 octobre 2015
French bombs have been falling on Syria since the end of September, reinforcing France’s tough new image in the international and English-speaking press. The French have been known for many years as “cheese-eating surrender monkeys” owing in part to their refusal to participate in the 2003 invasion of Iraq. This new intervention further contributes to France’s transformation from a caricature into “frogs of war.” In the last few years, French interventionism accelerated : Libya in 2011, Mali in 2013, Operation Barkhane in Mali, Chad, Niger, Mauritania, and Burkina Faso since 2014, the Central African Republic (CAR) in 2014, Iraq in 2014, and as of this week, Syria, where France had almost intervened following the chemical attacks of August 2013. How can this apparent evolution be explained ? “French interventionism” is nothing new, but this international activism and its sudden visibility, particularly as seen from the United States, is the result of a combination of factors.
"Oui, l’interventionnisme militaire est souvent nécessaire", Le Monde, 11-12 octobre 2015, p. 16.
Avec le chaos en Libye, l’emprise de Daech en Irak et en Syrie et la progression des talibans en Afghanistan, il est de bon ton de s’en prendre à l’interventionnisme occidental des quinze dernières années, dont les crises actuelles ne seraient que les contrecoups. Il est certainement nécessaire de tirer les leçons de nos échecs, mais il faut le faire sans céder à la simplification.

"Recension du livre de Jean Ping", Éclipse sur l’Afrique. Fallait-il tuer Kadhafi ?, pour La Vie des idées, 2 septembre 2015.
Fallait-il tuer Kadhafi ? Jean Ping, ancien président de la commission de l’Union Africaine, estime que l’intervention des Occidentaux en Libye est un désastre que rien ne peut justifier. Mais ses arguments, aujourd’hui largement repris au sein de la critique postcolonialiste, sont contestables.
"Encadrons l’usage des robots tueurs", Le Monde, 18 août 2015, p. 12.
Quoiqu’on pense de ces espoirs, ils ne sont pas moins légitimes que les craintes que ces machines suscitent. Au devoir de ne pas développer des technologies potentiellement dangereuses s’oppose en effet celui de le faire si celles-ci peuvent réduire l’impact des conflits armés sur ses propres forces et sur les civils. Le cas échéant, il ne serait pas seulement moral de les utiliser, mais immoral de ne pas le faire. C’est une raison de ne pas les interdire préventivement. Cette prudence impose aussi de réglementer leur usage.

"La guerre juste", in général B. de Courrèges d’Ustou (dir.), Défendre la France au XXIe siècle, Paris, Economica, 2015, p. 83-86.
Ce qu’on appelle la « tradition », la « doctrine » ou la « théorie » de la guerre juste n’est pas un ensemble de règles univoques, même si elle est généralement présentée comme une série de critères : autorité légitime, cause juste, bonne intention, dernier recours, proportionnalité, effet positif, chances raisonnables de succès, etc. Non seulement leur choix est discutable (dans quelle mesure, par exemple, peut-on évaluer la « bonne intention » d’un Etat intervenant ?), mais leur interprétation, surtout, suscite un débat considérable depuis des millénaires, qui s’est peu à peu constitué en une branche de la philosophie morale : l’éthique de la guerre.
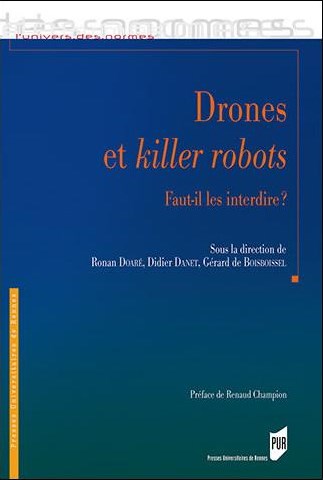
"Drones armés et systèmes d’armes létaux autonomes : des enjeux différents", in R. Doaré, D. Danet et G. de Boisboissel (dir.), Drones et killer robots : Faut-il les interdire ?, Rennes, Presses universitaires de Rennes (PUR), collection L’Univers des normes, 2015, p. 91-102.
L’une des nombreuses confusions, voire désinformations, du débat médiatique actuel sur l’usage d’armes plus ou moins autonomes est de confondre deux espèces : les drones armés et les systèmes d’armes létaux autonomes (SALA).
"Comment faire face au totalitarisme érythréen", Le Monde, 18 juin 2015, p. 14.
On parle enfin de l’Erythrée, et c’est tant mieux. Mais cela ne répond pas à la question de savoir quoi faire. Certains Etats font mine de croire qu’un dialogue politique avec le régime est possible. On n’obtiendra pourtant rien du président Issayas Afeworki susceptible de réduire le flot de fuyards, ce qui prouve au passage que, si le régime a bien les caractéristiques du totalitarisme, il s’agit d’un « totalitarisme failli », qui n’a plus les moyens de juguler son hémorragie.
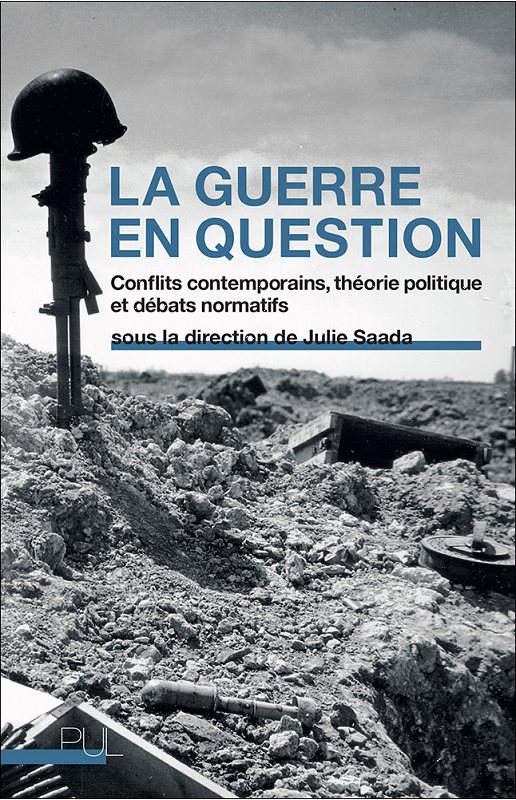
"Les justifications de la guerre préventive et leurs impasses", in Julie Saada (dir.), La guerre en question. Conflits contemporains, théorie politique et débats normatifs, Lyon, Presses universitaires de Lyon (PUL), collection sciences politiques, 2015, p. 191-215.
Si l’idée de guerre préventive pose toujours des problèmes insolubles à la théorie de la guerre juste, c’est en raison de son caractère irréductiblement paradoxal. Il est consensuel de dire que l’intervention militaire est toujours un aveu d’échec, qu’il vaut mieux éviter la guerre que la faire, et que c’est pour cette raison qu’on s’entend depuis des siècles pour la considérer comme un dernier recours seulement. Autrement dit, on considère la prévention comme une alternative, un moyen d’éviter la guerre. Et voilà qu’avec l’idée de guerre préventive la prévention devient la motivation de la guerre, et la guerre le moyen de la prévention. Mais prévenir quoi ? Un mal plus grand, une guerre plus dévastatrice. Le paradoxe résulte du fait que le moyen et la fin sont les mêmes : l’objectif est toujours d’éviter la guerre, mais le moyen proposé pour cela est de la faire – en présupposant que celle qu’on fait est préférable à celle qu’on évite de cette manière. La guerre préventive présente donc l’originalité d’être à la fois offensive et défensive. Elle se présente surtout comme une notion confuse, à vrai dire, car les deux termes qui la composent sont problématiques. Elle est toutefois dans l’usage et, avec ces réserves, cet article l’utilisera, pour mieux montrer les difficultés inhérentes à toute tentative de codifier un droit de prévention ou de préemption en matière de légitime défense.

"Vers une bipolarité fluide Etats-Unis / Chine ?", Revue Défense Nationale, n°781, juin 2015, p. 58-63.
Pour émerger, la bipolarité a besoin de quatre conditions cumulatives : (1) il faut de l’espace, donc un repli américain ; (2) la Chine doit continuer à croître comme elle le fait actuellement, jusqu’à arriver au niveau des États-Unis ; (3) l’écart de puissance doit se creuser entre les deux premiers et le reste du monde ; (4) un nombre croissant d’États doivent se sentir contraints de « choisir » entre les États-Unis ou la Chine.
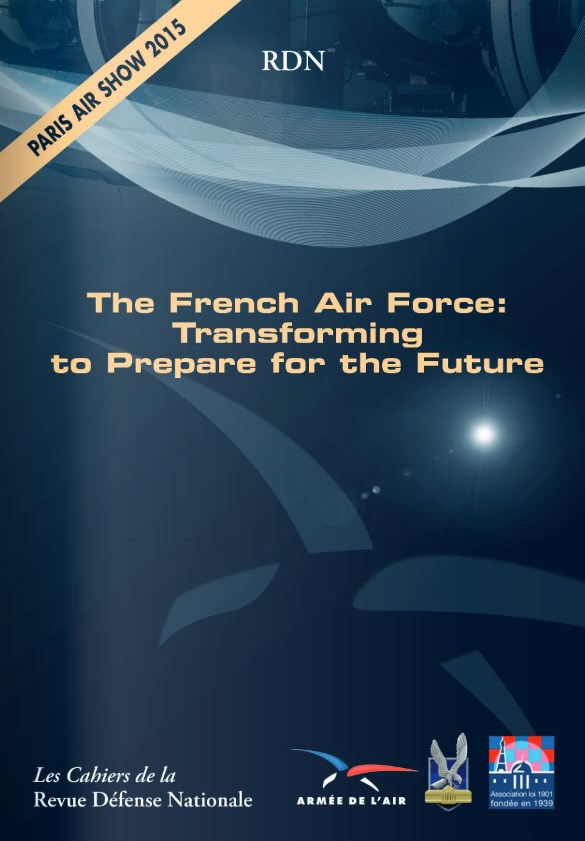
"When France Arms its Drones", in The French Air Force : Transforming to Prepare for the Future, Les Cahiers de la Revue Défense Nationale, Paris Air Show 2015 special issue, June 2015, p. 96-101.
France does not possess any armed drones, but it does have Reaper, which if modified can be armed. Reaper drones are currently deployed in Niamey (Niger), as part of Operation Barkhane. This article defends the armament of our Reapers and prepares the ground for a doctrine of use and a campaign of public diplomacy.

"Quand la France armera ses drones", in L’Armée de l’air : se transformer pour préparer l’avenir, Les Cahiers de la Revue Défense Nationale, spécial Salon du Bourget 2015, juin 2015, p. 101-106.
La France ne possède donc pas de drones armés, mais des Reaper qui, à condition d’être modifiés, sont armables. Ils sont actuellement déployés à Niamey (Niger), dans le cadre de l’opération Barkhane. Cet article défend l’armement de nos Reaper et pose les jalons d’une doctrine d’emploi et d’une diplomatie publique.
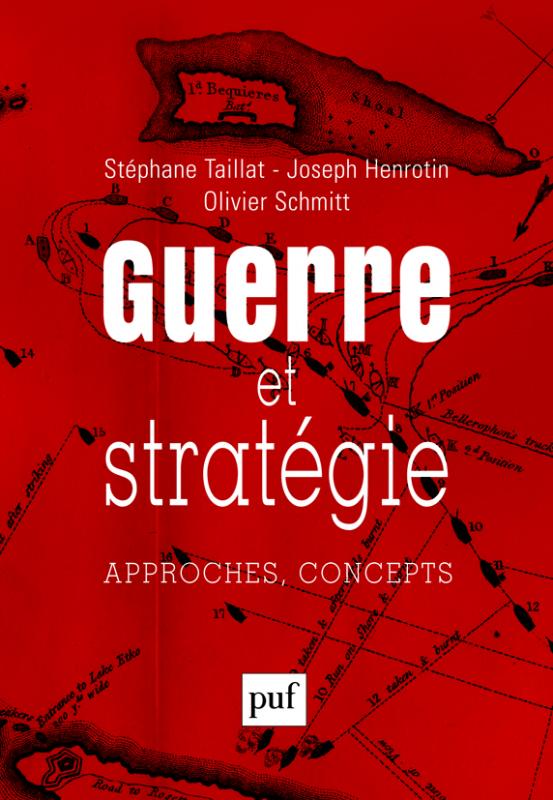
"Ethique et action stratégique", in Stéphane Taillat, Joseph Henrotin et Olivier Schmitt (dir.) , Guerre et stratégie : approches, concepts, Paris, PUF, 2015, p. 171-195.
L’éthique et la stratégie suscitent, chacune de leur côté, un intérêt considérable et croissant mais, enfermées dans leurs silos disciplinaires respectifs, elles se croisent rarement. Les éthiciens ne s’occupent pas de stratégie ni les stratégistes d’éthique. Plus précisément, ils s’évitent. En théorie, il est de bon ton de reconnaître que l’éthique devrait jouer un rôle dans la stratégie – et, plus largement, dans les décisions politiques – mais, en pratique, les stratégistes s’en méfient. Le but de ce chapitre est simplement d’examiner leur relation : quelles sont, d’abord, leurs similitudes ? Que dire ensuite de leur compatibilité ? Finalement, l’éthique influence-t‑elle l’action stratégique et, le cas échéant, comment ? Avoir un avantage moral donne-t‑il un avantage stratégique ? Avoir un désavantage moral donne-t‑il un désavantage stratégique ? Et une mauvaise stratégie peut-elle ruiner un avantage moral ?
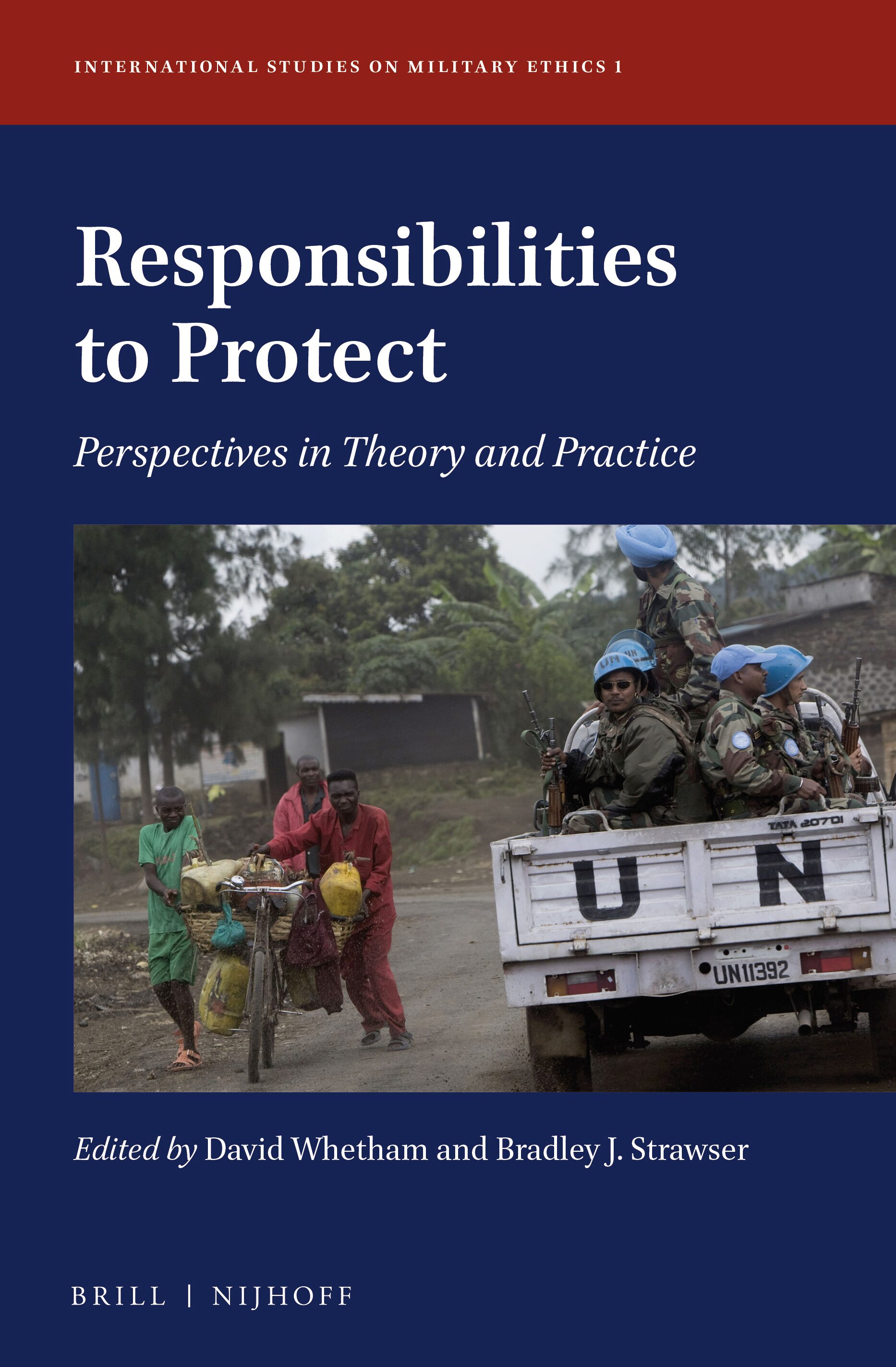
"Ten Myths about the Responsibility to Protect : A Realist Critique", in D. Whetham and B. J. Strawser (ed.), Responsibilities to Protect : Perspectives in Theory and Practice, Brill / Nijhoff, 2015, p. 80-100.
The concept of “responsibility to protect” (R2P) is one of the most cited on the international stage in the early twenty-first century, and its popularity is often at the expense of accuracy. More often cited than understood, R2P gives rise to a number of misconceptions. This chapter exposes the main ones.

"Terminator Ethics : Should We Ban ’Killer Robots’ ?", Ethics and International Affairs, 23 mars 2015
"In this incisive analysis, Jean-Baptiste Jeangène Vilmer argues that three things confuse the current debate on LAWS : the use of different names to describe the weapons in question (“killer robots,” “lethal autonomous weapon systems,” etc.), the inherently speculative nature of the debate, and differing definitions of “autonomy.” He then posits that “fully autonomous weapon systems” are a red herring, the moral argument against LAWS is too philosophically muddled to be effective, and that it is entirely unclear that LAWS will not abide with international humanitarian law. Finally, Vilmer argues that safeguards can be installed to regulate LAWS’ use." (Paul Scharre, Center for a New American Security)
This essay was first published in French as “Terminator Ethics : Faut-il Interdire les ‘Robots Tueurs’ ?”, Politique Etrangère, December 2014, p. 151-167.

"La fin des droits de l’homme ?", Etudes, 2015/3, p. 19-30.
Plusieurs facteurs portent à la mise en question des droits de l’homme dans le monde : progression des régimes autoritaires, affaiblissement moral de l’Occident, crise des institutions internationales, etc. Mais il apparaît à l’examen que leur prétendu déclin est plutôt une crise de croissance. La démocratie libérale et le respect des droits humains répondent davantage aux aspirations des populations. Il importe d’en faire un des critères non pas d’affichage mais de détermination de la politique étrangère de la France.

"Crimée : les contradictions du discours russe", Politique étrangère, 1/2015, p. 159-172.
Après avoir nié l’intervention russe en Crimée, le président Poutine a fini par la reconnaître et par employer des arguments fallacieux pour la justifier. Contrairement à ce qu’affirme la propagande russe – relayée par différents partis d’extrême droite en Europe de l’Ouest –, cette annexion de fait est illégale et les comparaisons avec le Kosovo sont infondées. Un an après son fait accompli en Crimée, le Kremlin poursuit sa stratégie de démembrement de l’Ukraine.

"Les Turbulences de l’ordre mondial : une lecture critique du World Order de Henry Kissinger", Revue française de science politique, 65:1, 2015, p. 111-125.
Au sortir de « l’été de toutes les crises », qui a concentré la plupart des symptômes du désordre mondial (Ukraine, Syrie, Irak, Sahel, Libye, Israël/Palestine, mer de Chine, Ebola) et témoigné de l’état de nature hobbesien dans lequel les relations internationales semblent revenues, la parution début septembre du dernier livre de Kissinger est on ne peut plus opportune.
"Torture : l’irréaliste scénario de la bombe à retardement", Le Monde, 13 décembre 2014, p. 15.
Devoir torturer des terroristes afin de déjouer un attentat imminent est une fiction qui n’a jamais existé. Les sévices endurés ne font qu’encourager les actes barbares.

"Terminator Ethics : faut-il interdire les "robots tueurs" ?", Politique étrangère, 4/2014, p. 151-167.
Les systèmes d’armes létaux autonomes font débat, certaines ONG réclamant leur interdiction préventive. La notion d’autonomie est pourtant très complexe : il n’existe pas de système d’arme totalement soustrait à l’intervention humaine. En termes moraux et vis-à-vis du droit international humanitaire, ces systèmes posent des problèmes peu différents des autres armes utilisées par l’homme. Il semble donc préférable de les encadrer, plutôt que les interdire a priori.

"L’applicabilité du droit international humanitaire à la cyberconflictualité", in Didier Danet et Amaël Cattaruzza (dir.), Cyberdéfense : quel territoire, quel droit ?, Economica, 2014, p. 240-252.
Le droit international humanitaire (DIH) est l’ensemble des règles qui cherchent à limiter les effets des conflits armés, à la fois en protégeant les personnes et les biens et en limitant ou en interdisant certains moyens et certaines méthodes de guerre. Mais dans quelle mesure le DIH s’applique-t-il à la cyberconflictualité ?
"Le veto est-il un attribut de la puissance ? Le cas de la France", Aquilon. Revue en ligne de l’Association des internationalistes, 13, juin 2014, p. 31-39.
Afin de savoir si le veto et le statut de membre permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies sont, dans le cas de la France, des atouts de la puissance au XXIe siècle, nous procéderons en quatre temps : (1) il faut d’abord savoir ce qu’on entend par puissance, comment la définir et quels sont ses critères. (2) On peut ensuite déduire si le statut de membre permanent et le veto sont des attributs de la puissance ainsi définie ; puis, (3) en s’appuyant sur la pratique du veto, (4) conclure sur le cas de la France et examiner quel rôle joue le veto dans sa puissance.

"Union africaine versus Cour pénale internationale : répondre aux objections et sortir de la crise", Etudes internationales, 45:1, avril 2014, p. 5-26.
La propagande africaine anti-CPI est apparue en 2005, en réaction à la saisine de la CPI par le Conseil de sécurité au sujet du Darfour, mais s’est surtout développée à partir de l’émission des mandats d’arrêt contre el-Béchir (2009-2010). Elle a ensuite été ravivée par l’affaire Laurent Gbagbo, arrêté et transféré à La Haye en 2011 – lui et sa femme Simone étant accusés d’avoir commis des crimes contre l’humanité en Côte d’Ivoire. Plus récemment, le transfèrement de Charles Blé Goudé à la CPI (22 mars 2014) remet le feu aux poudres : Michel Gbagbo, le fils de l’ancien président, parle d’une « opération de déportation coloniale » qui est « un frein à la réconciliation ». Dans les derniers mois, toutefois, l’offensive majeure est venue d’Afrique de l’Est : c’est le Kenya qui, grâce à un intense lobbying exercé sur les États de l’UA, en premier lieu ses voisins, a permis de focaliser l’hostilité africaine à l’égard de la Cour et de rassembler une contestation inquiétante. Sanji Mmasenono Monageng, première vice-présidente et juge à la CPI, originaire du Botswana, estime que les relations entre l’UA et la CPI « n’ont probablement jamais été aussi tendues et soumises à rude épreuve qu’aujourd’hui ». D’où la nécessité et l’urgence de comprendre la crise et de faire des propositions pour en sortir.
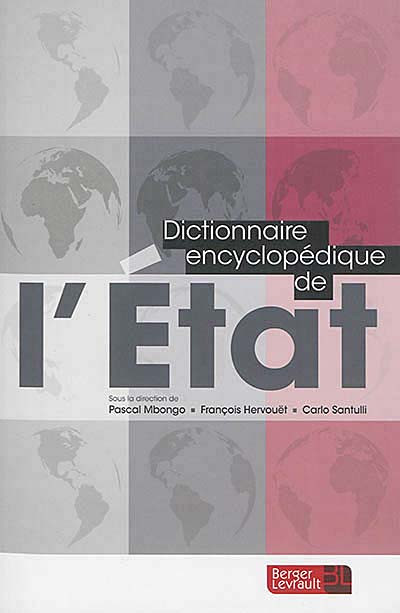
"Responsabilité de protéger", in P. Mbongo, F. Hervouët et C. Santulli (dir.), Dictionnaire encyclopédique de l’Etat, Paris, Berger-Levrault, 2014, p. 811-816.
La responsabilité de protéger (R2P) est l’un des concepts ayant le plus réussi sur la scène internationale en ce début de XXIe siècle. Apparu en 2001, reconnu quatre ans plus tard par l’Assemblée générale de l’ONU, faisant désormais l’objet d’un poste de Conseiller spécial auprès du Secrétaire général, de plusieurs rapports du Secrétaire lui-même et d’un débat informel annuel à l’Assemblée générale, il a été invoqué par le Conseil de sécurité dans au moins huit résolutions et par plusieurs dirigeants pour justifier l’intervention de l’OTAN en Libye (2011), et plus généralement par un grand nombre d’observateurs, chercheurs et journalistes lorsqu’il s’agit de défendre une intervention militaire pour des raisons humanitaires.
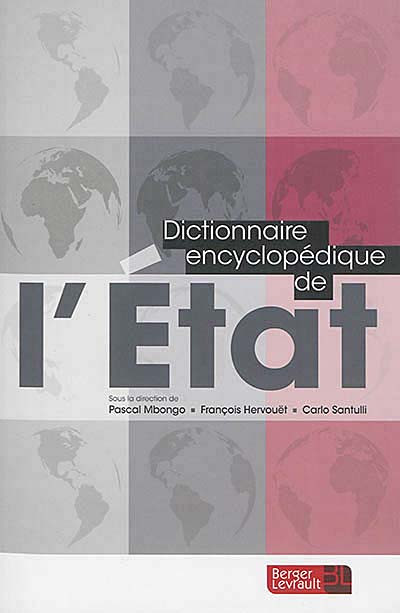
"Ethique des relations internationales", in P. Mbongo, F. Hervouët et C. Santulli (dir.), Dictionnaire encyclopédique de l’Etat, Paris, Berger-Levrault, 2014, p. 411-417.
Ce domaine de recherche pouvant être défini comme l’étude de la nature et du rôle des prescriptions, des valeurs morales, des enjeux et des dilemmes éthiques dans les relations internationales, a plusieurs appellations, dont les plus courantes sont « éthique des relations internationales », « éthique internationale », « morale internationale », « éthique globale », « éthique mondiale », ou « théorie normative en relations internationales ».
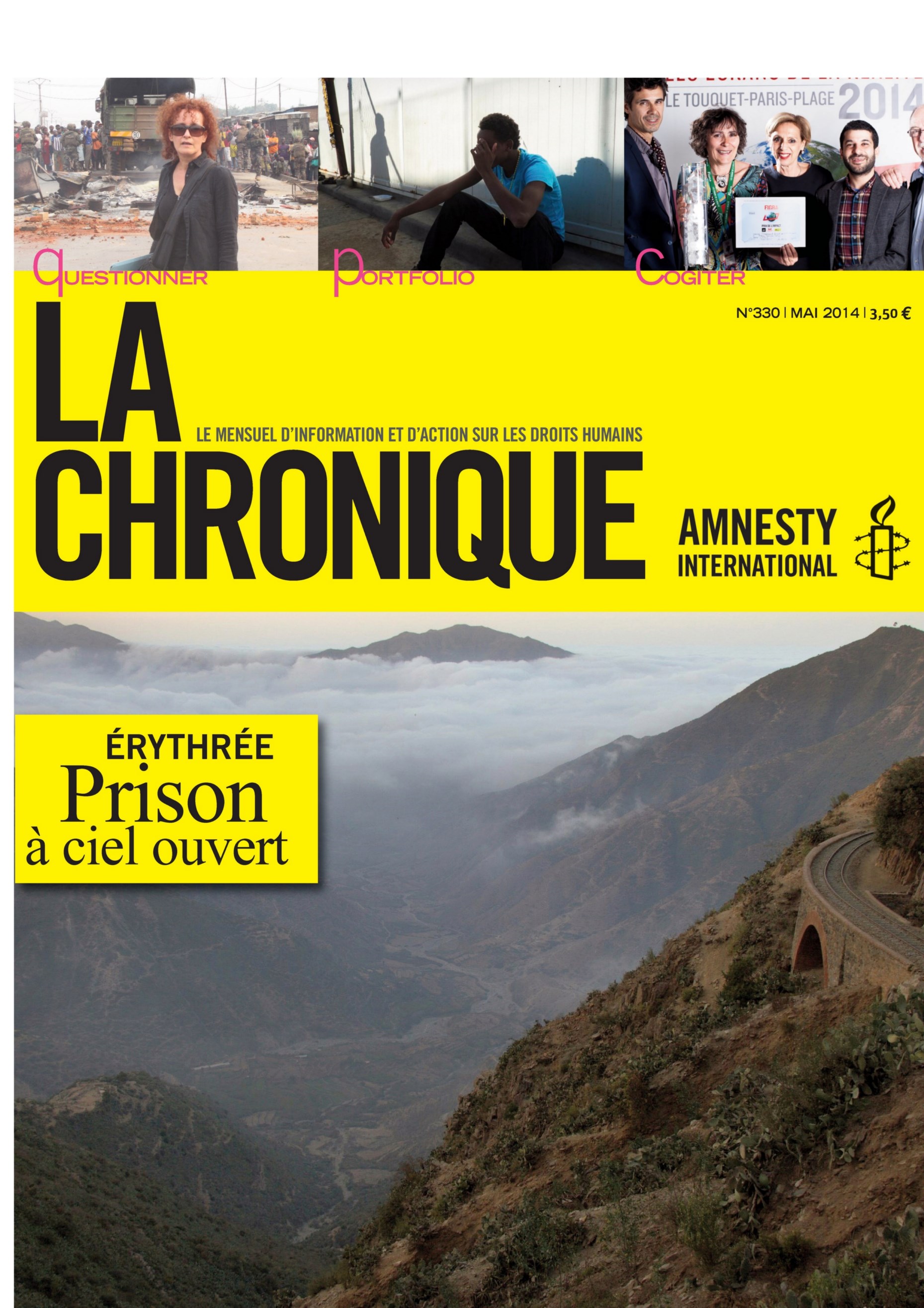
"Erythrée : prison à ciel ouvert", La Chronique. Mensuel d’Amnesty International, n°330, mai 2014, p. 11-17
Dossier composé avec Franck Gouéry : "L’Erythrée sous camisole" (JBJV, p. 11-13), "Fuir l’Erythrée : une odyssée tragique" (FG, p. 14-15) et "Un fauteur de troubles (politique étrangère)" (JBJV, p. 16-17) - avec des photos prises en Erythrée au printemps 2012.

"Du Kosovo à la Syrie : l’intervention humanitaire armée", in J.-V. Holeindre et L. Testot (dir.), La Guerre des origines à nos jours, Auxerre, Editions Sciences Humaines, 2014, p. 239-245.
En tant que mode de justification de la guerre, l’intervention humanitaire armée a toujours existé, et pas seulement en Occident. Sa présence est attestée en Chine il y a 4000 ans, où des princes invoquaient déjà des raisons humanitaires pour intervenir militairement chez leurs voisins. Théorisée à la fin du xixe siècle, elle se développe particulièrement dans les années 1990, en raison de plusieurs facteurs combinés : l’effondrement du bloc de l’Est, les efforts de la diplomatie française pour promouvoir le droit d’assistance, le développement de la pratique de l’action humanitaire, le rôle croissant des médias, le développement d’un discours global sur les droits de l’homme, la multiplication des instruments disponibles et enfin la mondialisation, qui réduit la distance entre la victime et l’observateur-intervenant potentiel.
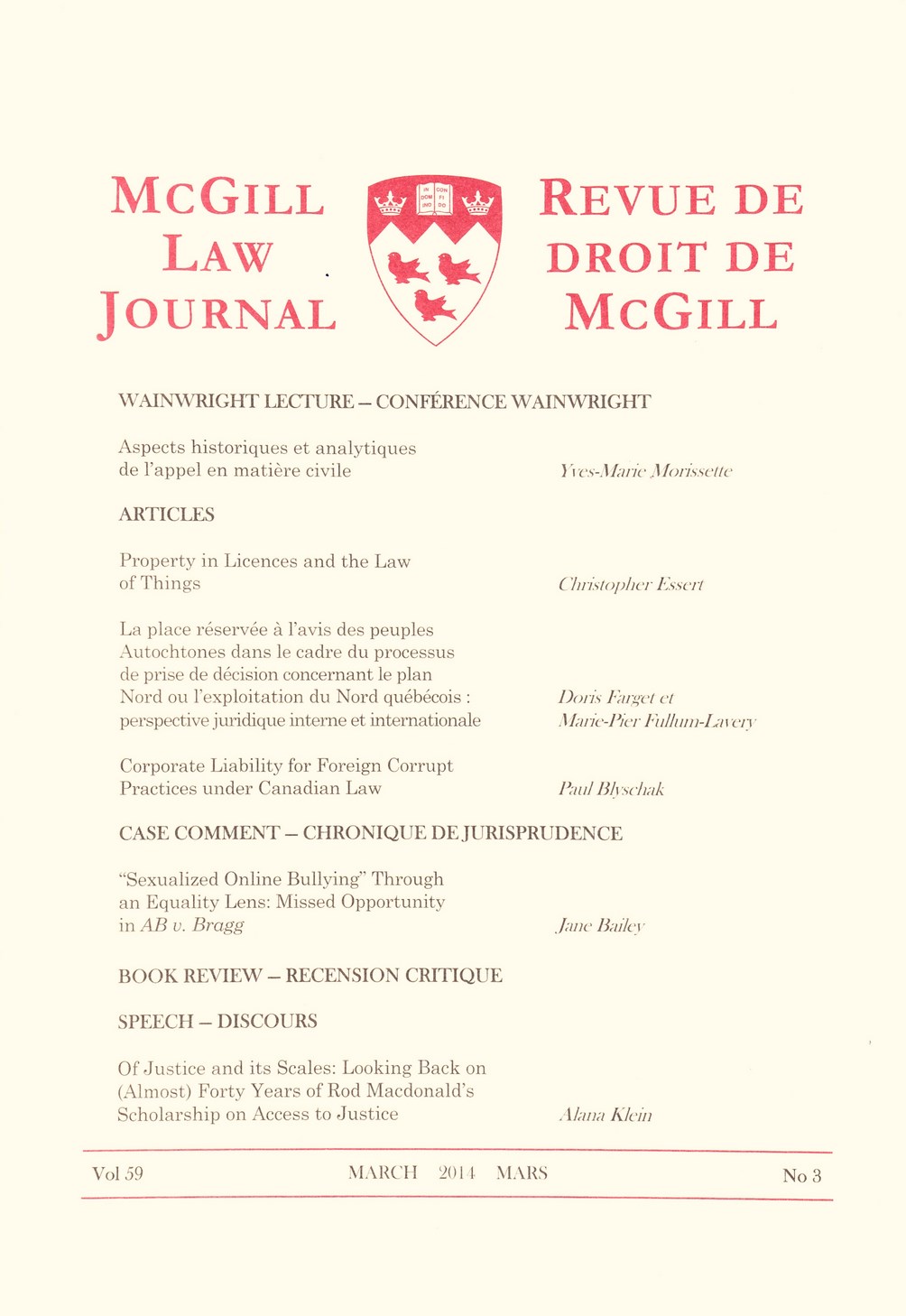
"Ressources francophones en droit international humanitaire", McGill Law Journal. Revue de droit de McGill, 59:3, 2014, p. 741-757.
Recension comparative de : Marco Sassòli, Antoine Bouvier et Anne Quintin (dir.), Un droit dans la guerre ? Cas, documents et supports d’enseignement relatifs à la pratique contemporaine du droit international humanitaire, seconde édition, Genève, CICR, 2012 ; Abdelwahad Biad et Paul Tavernier, dir., Le droit international humanitaire face aux défis du XXIe siècle, Bruxelles, Bruylant, 2012 ; Eric David, Principes de droit des conflits armés, 5ème édition, Bruxelles, Bruylant, 2012 ; Eric David, Françoise Tulkens et Damien Vandermeersch, Code de droit international humanitaire 2012, 5ème édition à jour au 1er janvier 2012, Bruxelles, Bruylant, 2012.
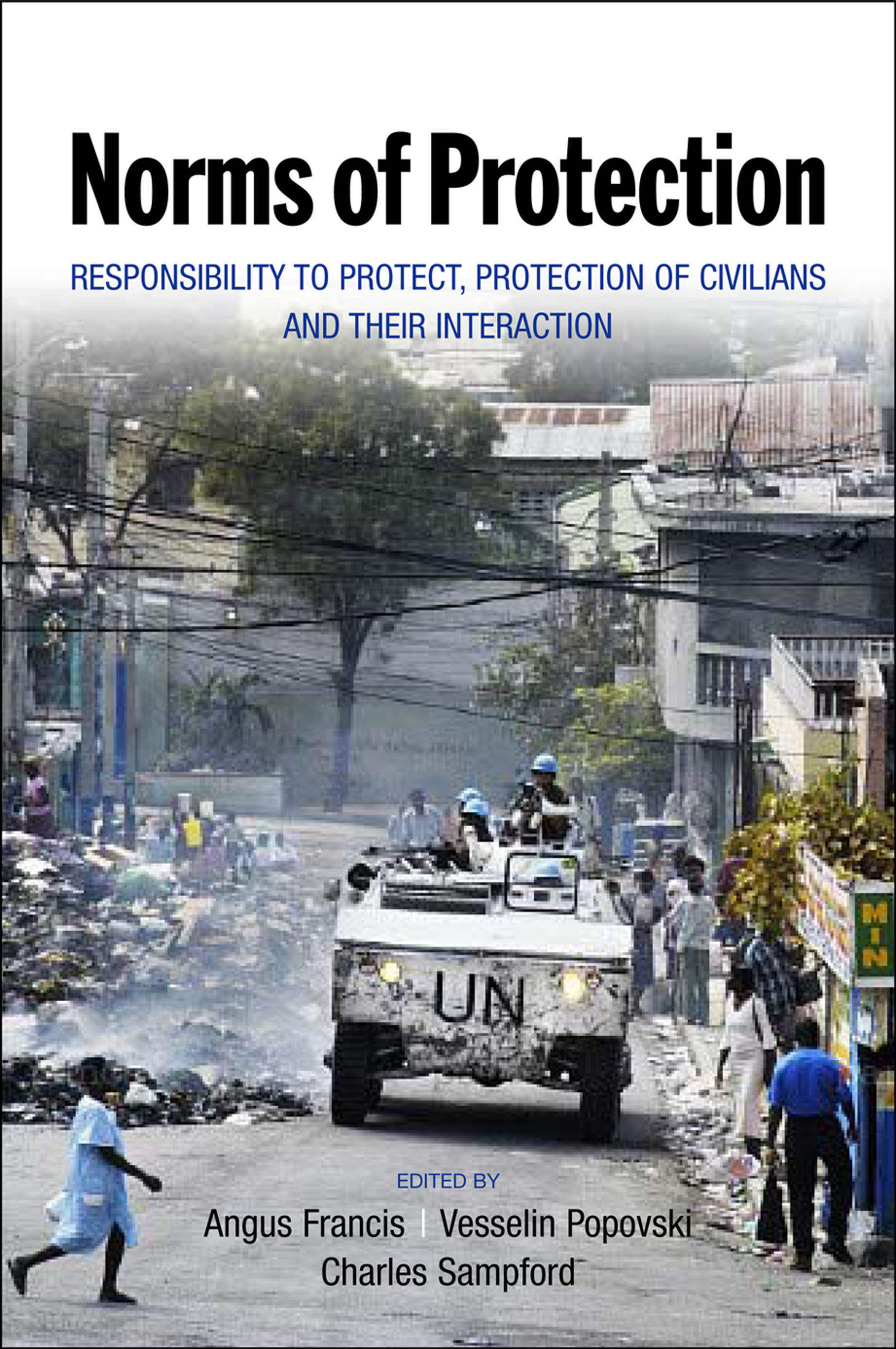
"Recension du livre de Angus Francis, Vesselin Popovski et Charles Sampford (eds)", Norms of Protection : Responsibility to Protect, Protection of Civilians and Their Interaction, sur le site du Réseau de recherche sur les opérations de paix (ROP) de l’Université de Montréal, 11 février 2014.

"Légalité et légitimité des drones armés", dossier "Les drones dans la guerre", Politique étrangère, 2013/3, p. 119-132.
Les questions éthiques et juridiques que suscite la robotisation militaire font l’objet d’un débat qui souffre de deux amalgames. Le premier confond la fin politique (l’assassinat ciblé, lui-même moyen de la lutte antiterroriste) et l’un de ses instruments pratiques (le drone). Si le drone est aujourd’hui la « figure aérienne du mal », c’est largement du fait de son emploi par la CIA au Waziristan, au Yémen et en Somalie. Cette politique d’assassinats ciblés est discutable, mais il ne faut pas confondre la fin et les moyens.

"Robotisation et transformations de la guerre", introduction au dossier "Les drones dans la guerre", Politique étrangère , 2013/3, p. 80-89.
Depuis longtemps déjà, nous sommes entrés dans ce que Martin Van Creveld considère comme le quatrième âge de la guerre – après ceux des outils (jusqu’à 1500 av. J.-C.), des machines (1500-1830) et des systèmes (1830-1945) –, celui de l’automatisation (depuis 1945). Par « robotisation », on entend la tendance actuelle à confier à des robots des tâches habituellement accomplies par des humains. Un robot est une machine programmable dotée de capteurs, capable de réagir à son environnement et de réaliser certaines tâches, ce qui implique un degré d’autonomie. Il n’en existe pas de définition consensuelle et, au sens large où nous l’entendons ici, le robot militaire inclut à la fois les drones, qui sont télépilotés mais disposent tout de même d’une certaine autonomie, en particulier pour leur navigation, et les robots plus autonomes. La robotisation militaire est en marche et elle est inévitable pour de nombreuses raisons.

"Recension du livre de Grégoire Chamayou", Théorie du drone, pour La Vie des idées, 4 décembre 2013.
Le drone pose des problèmes stratégiques, éthiques et juridiques complexes qui occupent de nombreux chercheurs. En l’instrumentalisant ainsi à des fins militantes, en le réduisant à une arme capitaliste permettant aux Américains d’exporter leur impérialisme et d’opprimer les peuples, le risque était certes de plaire à un certain lectorat, d’ailleurs convaincu d’avance, mais aussi de décevoir voire énerver les spécialistes, et ça n’a pas manqué.

"Recension du livre de Frédéric Ramel", L’Attraction mondiale, Paris, Presses de Sciences Po, 2012, dans la Revue française de science politique, 63:3-4, 2013, p. 743-744.
Dans Philosophie des relations internationales (Presses de Sciences Po, 2ème éd., 2011), Frédéric Ramel consolidait ce champ par le moyen d’une anthologie historique, de Dante à Michael Walzer. Dans L’Attraction mondiale, dont le sous-titre aurait pu être Introduction à la philosophie politique des relations internationales, il en explore la dimension politique, au moyen d’un fil directeur, le cosmopolitisme, et dans une forme qui rappelle aussi l’anthologie puisque l’ouvrage, qui témoigne d’une grande érudition, présente et organise la pensée de nombreux auteurs, anciens, modernes et contemporains, en trois parties.
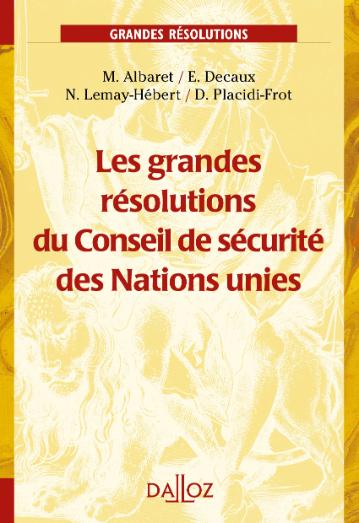
"Recension du livre de M. Albaret, E. Decaux, N. Lemay-Hébert et D. Placidi-Frot (dir.) ", Les Grandes Résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, Paris, Dalloz, 2012, dans La Chronique (mensuel d’Amnesty International France), juillet/août 2013, p. 32.
Depuis 1946, le Conseil de sécurité a adopté plus de 2000 résolutions qui ont contribué à façonner la société internationale et qui témoignent aujourd’hui de ses évolutions théoriques et pratiques. Celles qui en sont le plus représentatives – 49 d’entre elles – sont réunies, présentées et commentées dans cet ouvrage. Il s’agit d’un impressionnant travail collectif, rassemblant 51 contributeurs, de différentes disciplines et générations, qui vient combler un vide éditorial puisqu’une telle analyse synthétique n’existait pas auparavant.
"Armer les rebelles syriens, un "moindre mal" pour accélérer l’issue du conflit", Le Monde.fr, 29 mai 2013
Tous les ingrédients sont réunis pour que cette guerre d’usure dure encore une décennie – elle a bien duré 15 ans au Liban – ou débouche plus rapidement sur une partition de fait du pays, dans le sang et le risque de nettoyage ethnique.
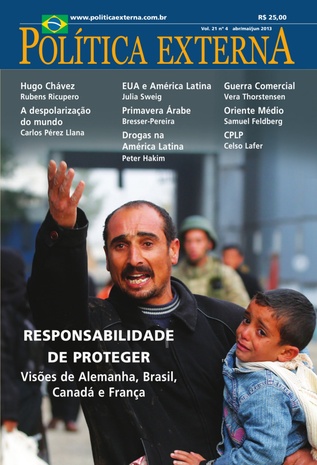
"Dez mitos sobre a Responsabilidade de Proteger ", Política Externa, 21:4, 2013, p. 47-58.
A partir de 2001, começou-se a falar sobre a R2P. Diante da concorrência que representa esse outro conceito, o que fazem os promotores franceses do direito de ingerência ? Argumentam que a R2P nada mais é que o “novo nome” do direito de ingerência. Essa é a posição oficial da França há anos. Não só Mario Bettati e Bernard Kouchner, mas também o embaixador da França nas Nações Unidas, ao invocar a R2P para a intervenção militar na Birmânia, em 2008 e, três anos depois, o presidente Sarkozy e seu ministro Alain Juppé, no caso da Líbia. Todos dizem : “nós inventamos a R2P há 20 anos, é apenas o direito de ingerência que mudou o seu nome”. Eles cometem dois erros. Primeiro, a R2P é muito mais ampla do que a noção de ingerência, utilizada para designar uma intervenção militar. A R2P é uma atitude em relação a uma crise humanitária - sentir-se “responsável” em proteger as vítimas - que pode se materializar de várias maneiras. Segundo, a R2P foi construída não só sem o apoio do direito de ingerência, mas contra ele. Porque a R2P realmente não oferece nada de novo e o vocabulário que ela usa é problemático, pode-se ser cético a seu respeito. É o que explica que o termo “intervenção humanitária” não está prestes a desaparecer, ainda mais pelo fato de que eles não designam a mesma coisa. A R2P é muito mais ampla do que a intervenção, que é apenas um de seus meios. O autor prefere chamar a R2P de “intervenção militar justificada por razões humanitárias”. Ele defende uma terceira via, que critica a R2P sem renunciar à legitimidade da intervenção, em alguns casos e com certas condições.
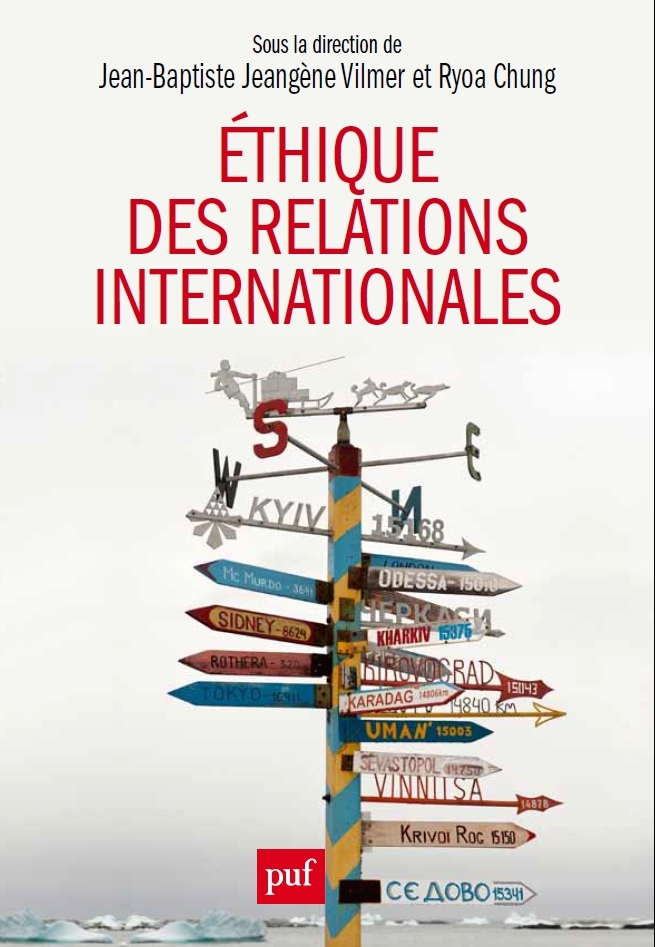
"L’éthique de la guerre", in J.-B. Jeangène Vilmer et R. Chung (dir.), Ethique des relations internationales. Problématiques contemporaines, Paris, PUF, 2013, p. 157-190.
La philosophie de la guerre développe trois types de questions. Premièrement, la nature de la guerre : qu’est-ce que la guerre ? Le concept est-il encore pertinent ? Comment penser philosophiquement les « guerres nouvelles » ? Deuxièmement, les causes de la guerre : pourquoi les guerres surviennent-elles ? Comment expliquer leur existence et leur persistance ? Puisent-elles leurs origines dans la nature humaine ? Troisièmement, la légitimité de la guerre : à quelles conditions peut-on dire d’une guerre qu’elle est juste au sens du jus ad bellum (le droit d’entrer en guerre), du jus in bello (le droit dans la guerre) et du jus post bellum (le droit après la guerre) ? Ce troisième volet correspond à l’éthique de la guerre, auquel ce chapitre est consacré.
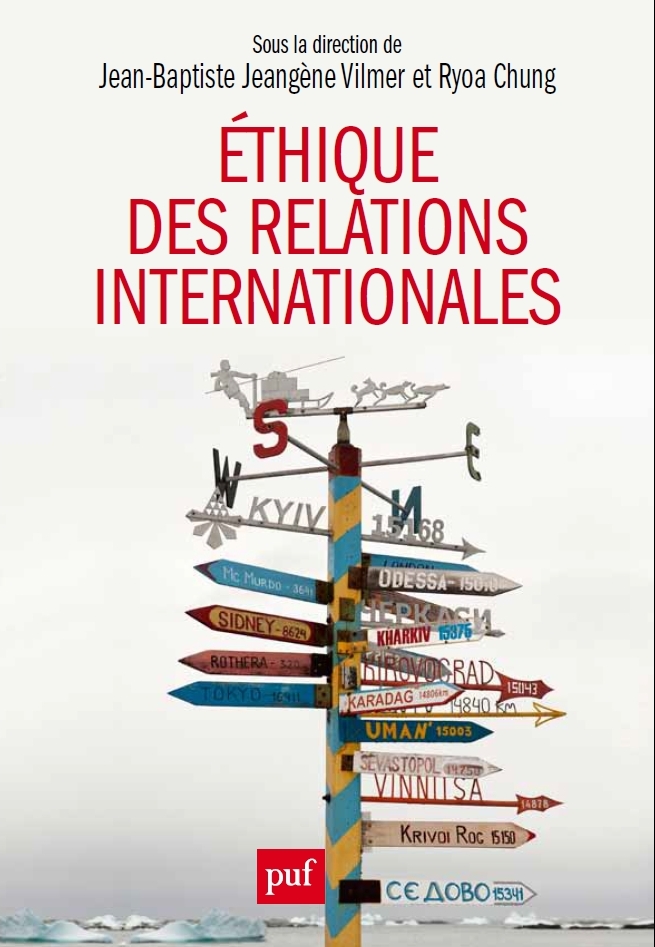
"Introduction", in J.-B. Jeangène Vilmer et R. Chung (dir.), Ethique des relations internationales. Problématiques contemporaines, Paris, PUF, 2013, p. 1-38.
La tendance est à la moralisation des relations internationales. Prenant acte de cette évolution, un domaine de recherche s’est développé sous différentes appellations, dont les plus courantes sont « éthique des relations internationales », « éthique internationale », « morale internationale », « éthique globale », « éthique mondiale », « théorie normative en relations internationales », ou des conjonctions comme « éthique et relations internationales » ou « la morale dans les relations internationales ». On peut la définir comme l’étude de la nature et du rôle des prescriptions, des valeurs morales, de enjeux et des dilemmes éthiques, dans les relations internationales.

""Un armement de plus en plus autonome" (article) et "Droit d’entrer en guerre et intervention humanitaire" (étude de documents)", Textes et Documents pour la classe, 1060, "Les guerres contemporaines", automne 2013, p. 14-15 et 38-39.
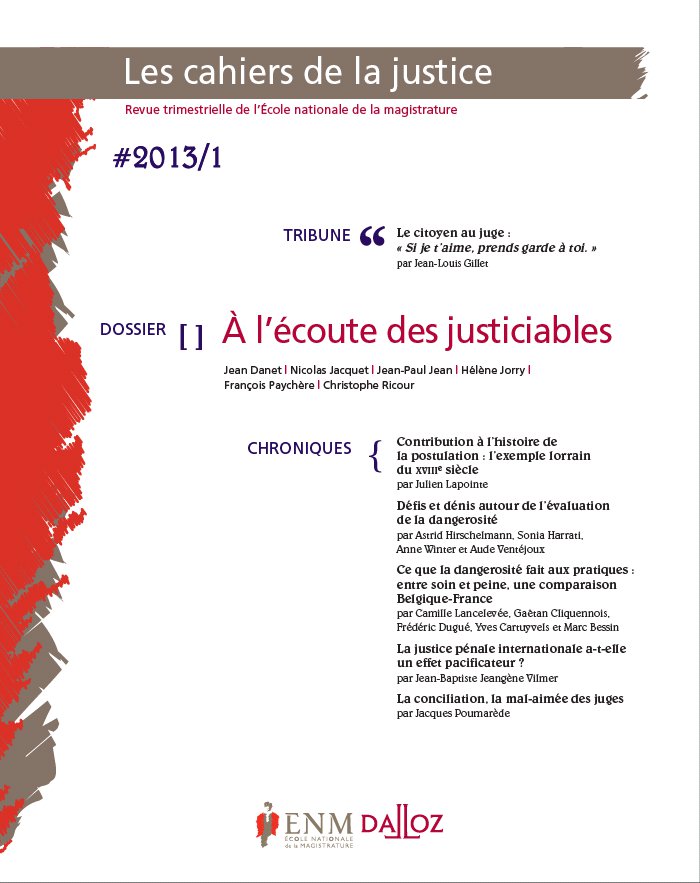
"La justice pénale internationale a-t-elle un effet pacificateur ?", Les Cahiers de la justice. Revue trimestrielle de l’Ecole Nationale de la Magistrature (Dalloz), 2013/1, p. 115-126.
Les institutions de la justice pénale internationale, en particulier la Cour pénale internationale et les tribunaux ad hoc (TPIY et TPIR), n’ont pas seulement une fonction punitive : ils ont aussi une fonction sécuritaire, c’est-à-dire l’ambition d’avoir un effet pacificateur, de réaliser le projet kantien d’une « paix par le droit ». Mais en ont-ils les moyens ? Dans quelle mesure contribuent-ils réellement à la pacification ? Ont-ils un effet dissuasif ? Cet article montre que leur contribution est au mieux limitée et que faire preuve de romantisme judiciaire, c’est-à-dire nourrir à l’égard de la justice des attentes démesurées, a l’effet pervers de nuire à sa crédibilité, et de réduire ses chances déjà modestes d’avoir un effet pacificateur.
English
"Pour un réalisme libéral en relations internationales", Commentaire, 141, printemps 2013, p. 13-20.
Dans la vulgate des relations internationales, le réalisme est généralement présenté comme une théorie amorale, une Realpolitik autorisant les États à défendre leurs intérêts à n’importe quel prix, réduisant le droit international à n’être que l’instrument des grandes puissances dans un contexte anarchique où règne la loi du plus fort. Face à une crise humanitaire grave, on présume également que le réaliste, qui fait primer le respect de la souveraineté sur celui des droits de l’homme, est anti-interventionniste. À tel point que, pour illustrer le débat entre réalistes et libéraux sur l’intervention dite humanitaire, on parle en France de ce qui oppose les « souverainistes » aux « droits-de-l’hommistes ». Ce portrait explique que, comme l’a noté le théoricien américain des relations internationales Robert Gilpin, « personne n’aime un réaliste politique ». Dans cet article, j’aimerais donner des raisons de l’aimer. Montrer que cette présentation est une contrefaçon trompeuse. Qu’un certain genre de réalisme, un réalisme libéral – réaliste par sa prudence et son pragmatisme, libéral par sa volonté de rendre le monde plus juste –, est non seulement possible mais aussi souhaitable.

"Recension du livre d’Océane Zubeldia", Histoire des drones, de 1914 à nos jours, Paris, Perrin, 2012, dans Politique étrangère, 2013/1, p. 199-200.
Adapté d’une thèse de doctorat, ce livre du capitaine Océane Zubeldia, désormais chercheur au Centre d’études stratégiques aérospatiales, est la première et la seule histoire des drones disponibles en français. Cela suffit à en faire un ouvrage intéressant, d’autant plus qu’il est bien documenté.

"La France au Mali : sa légitimité et ses intérêts", iPhilo.fr, 2 février 2013.
La légitimité de l’intervention se déduit de deux arguments. Le premier est qu’il y avait de « bonnes » raisons d’intervenir – bonnes pas seulement pour nous, mais pour le plus grand nombre : empêcher la création d’une zone franche terroriste au Sahel et l’afghanisation du Mali ; empêcher la barbarie de la charia, imposée à une population qui ne l’a pas demandée ; et stopper l’afflux de réfugiés. A cela s’ajoute une raison d’intérêt national que personne ne conteste : l’obligation non seulement morale mais aussi juridique qu’a l’Etat français de protéger ses ressortissants. Le second argument est le consensus quasi-planétaire que suscite l’intervention, qui a reçu un soutien diplomatique de l’ONU, l’UE, l’UA, l’Organisation de la coopération islamique, l’Algérie, les Etats-Unis, la Russie, etc., et un soutien militaire (transport, ravitaillement, surveillance) d’une douzaine de pays.

"La France n’a pas à rougir de défendre ses intérêts au Mali", Le Monde, 25 janvier 2013, p. 19.
Dans ses voeux à la presse du 16 janvier, le président François Hollande insiste : "La France, elle libère. (...) Elle porte des valeurs. Elle n’a aucun intérêt au Mali. Elle ne défend aucun calcul économique ou politique. Elle est au service, simplement, de la paix." La communication élyséenne sur l’intervention au Mali repose sur le désintéressement. C’est une erreur, qui a des effets pervers. La France est intéressée. Elle n’a pas à en avoir honte.
Türk çevrilmiş : http://www.dunyabulteni.net/?aType=...
"Les risques de la robotisation militaire", Le Devoir, 27 décembre 2012, p. A7.
Ceux qui pensent pouvoir rendre les robots « éthiques » en comptant précisément sur leur absence d’émotions confondent la moralité et l’application de règles. Or, le DIH n’étant pas un ensemble de règles univoques, il n’a de sens que dans le cadre du « particularisme moral » selon lequel nos jugements s’effectuent au cas par cas - ce que les robots ne peuvent pas faire.
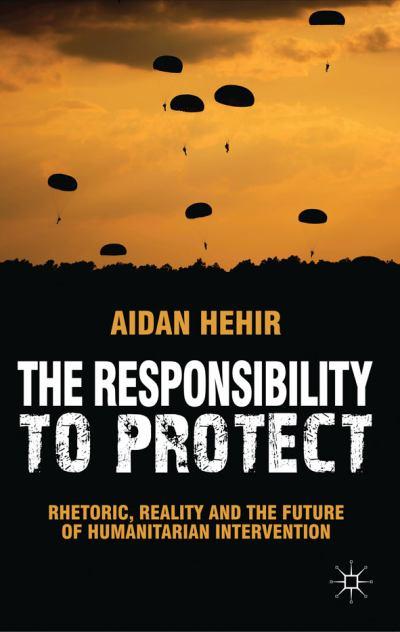
"Recension du livre d’Aidan Hehir", The Responsibility to Protect : Rhetoric, Reality and the Future of Humanitarian Intervention, New York, Palgrave Macmillan, 2012, dans Politique étrangère, 2012/4, p. 912-913.
Dans son style décapant habituel, Aidan Hehir fait tomber les idées reçues et les approximations qui entourent encore le concept nébuleux de la responsabilité de protéger (R2P), faisant de ce livre l’un des plus utiles écrits sur le sujet.

"Du Kosovo à la Syrie : l’intervention humanitaire armée", Sciences Humaines, Les Grands Dossiers, hors-série n°1, "La Guerre des origines à nos jours", novembre-décembre 2012, p. 118-121.
En tant que mode de justification de la guerre, l’intervention humanitaire armée a toujours existé. Sa présence est attestée en Chine il y a 4000 ans. Théorisée à la fin du XIXe siècle, elle se développe particulièrement dans les années 1990, en raison de plusieurs facteurs combinés : l’effondrement du bloc de l’Est, les efforts de la diplomatie française pour promouvoir le droit d’assistance, le développement de la pratique de l’action humanitaire, le rôle croissant des médias, le développement d’un discours global sur les droits de l’homme, la multiplication des instruments disponibles et enfin la mondialisation, qui réduit la distance entre la victime et l’observateur-intervenant potentiel.
"Il faut armer les rebelles syriens", Le Monde, 8 décembre 2012, p. 15.
Avec l’enlisement du conflit syrien, il devient nécessaire de réévaluer les options disponibles. En l’absence d’une solution politique et d’une intervention militaire directe improbable et dangereuse, il ne reste qu’une manière de hâter la fin du conflit : armer les rebelles.
العربية : http://afak-sy.blogspot.ca/2012/12/...
in English : http://www.biyokulule.com/view_cont...

"Israël ou l’absurde quête de la proportionnalité", Libération, 23 novembre 2012, p. 25.
Le discours est rodé. A chaque offensive, il faut reconnaître à Israël le droit de se défendre, et lui reprocher de le faire de façon « disproportionnée ». La proportionnalité est toujours au cœur du débat. Mais que signifie-t-elle exactement ?
"Lutter avec des monstres sans en devenir soi-même", Le Devoir, 19 novembre 2012
"Quand on lutte avec des monstres, on doit veiller à ne pas devenir soi-même un monstre. Quand tu fixes longtemps ton regard dans l’abîme, l’abîme fixe aussi son regard en toi", écrivait Nietzsche en 1886. C’est le défi de toute lutte contre un adversaire a priori pire que soi, c’est-à-dire qui utilise des moyens ou des méthodes qu’en temps normal nous condamnons moralement. C’est le défi auquel font face les rebelles syriens.

"Homeland, la Maison Blanche et les drones", Libération, 19 octobre 2012, p. 22-23.
On explique l’engouement actuel pour les séries télévisées par le fait qu’elles sont des révélateurs des évolutions politiques et sociales de nos sociétés. Homeland, qui vient de remporter le Emmy Award de la meilleure série, en est une preuve supplémentaire. En une seule saison - qui débarque en France au moment où la deuxième commence aux Etats-Unis -, elle nous a déjà beaucoup dit sur la politique américaine en matière de lutte antiterroriste, et ce qui distingue à ce titre l’administration Obama de celle de George W. Bush.
Tribune reprise et lue intégralement dans la revue de presse culturelle d’Antoine Guillot sur France Culture (5 novembre 2012) : http://www.franceculture.fr/emissio...
"Quels avions pour Alep ?", Le Monde.fr, 15 août 2012
(avec Olivier Schmitt) - Après Nicolas Sarkozy et François Fillon, c’est au tour de Bernard-Henri Lévy de dénoncer la passivité de la France à l’égard de la crise syrienne et de proposer un plan d’action en sept points (Le Monde daté 15 août), qui pose les bonnes questions mais apporte des réponses peu convaincantes.

"Libya to Syria : R2P and the ‘Double Standards’ Issue", Fair Observer, 23 July 2012
The ‘double standards’ critique is not relevant to justify a military intervention in Syria, and denotes a dangerous romanticism in international relations.
First of the Fair Observer’s five best Global Security articles of 2012 : http://www.fairobserver.com/article...

"Syrie : les limites de la justice pénale internationale", Mediapart, 26 juin 2012
Lorsqu’en 1872 Gustave Moynier défend l’idée d’une Cour permanente et indépendante pour juger les crimes de guerre, « une institution judiciaire internationale, propre à prévenir et à réprimer les infractions à la Convention de Genève », il identifie déjà les deux fonctions de la justice pénale internationale : non seulement rétributive (punir les crimes), mais aussi sécuritaire (les prévenir). Lorsque 130 ans plus tard, la Cour pénale internationale (CPI) entre en vigueur, ses vœux sont exaucés mais la question demeure : dans quelle mesure cette justice contribue-t-elle à la paix et à la sécurité ? Dans quelle mesure a-t-elle un effet pacificateur ?
"La Syrie, les massacres et le romantisme judiciaire", La Tribune, 25 juin 2012
En présumant qu’une saisine de la Cour pénale internationale (CPI) permettra « l’arrêt des massacres en Syrie » (Le Monde, 13 juin 2012), Mario Bettati et Bernard Kouchner font preuve d’un optimisme qui serait encourageant s’il n’était pas justifié par un certain nombre d’approximations.

"De la mythologie française du droit d’ingérence à la responsabilité de protéger : une clarification terminologique", Annuaire Français de Relations Internationales, 13, 2012, p. 81-100.
L’intervention militaire justifiée par des raisons humanitaires est une pratique, érigée en doctrine, qui a reçu différentes appellations : intervention d’humanité au XIXe siècle, intervention humanitaire (humanitarian intervention) dans la tradition anglophone, « droit ou devoir d’ingérence » en France, « responsabilité de protéger » depuis quelques années. Cette multiplicité en fait l’une des questions internationales les plus confuses. Cet article interdisciplinaire (sciences politiques, droit, philosophie) offre une clarification terminologique qui défait le lien habituellement fait en France entre droit d’ingérence et responsabilité de protéger, renvoie dos à dos ces deux concepts et propose une terminologie alternative.
English"Syrie : les dangers du romantisme militaire", Le Devoir, 11 juin 2012, p. A7.
« Dans une affaire aussi dangereuse que la guerre, disait Clausewitz, les erreurs dues à la bonté d’âme sont la pire des choses. » Difficile, d’ailleurs, de distinguer la bonté sincère du besoin de se donner bonne conscience, ou une bonne image. Spectateurs impuissants des massacres en Syrie, nous sommes tous indignés. La volonté d’intervenir est normale, et elle peut s’appuyer sur cette longue tradition qui refuse de considérer la souveraineté comme un bouclier derrière lequel on peut tuer impunément. Mais il faut savoir pour qui on intervient : pour eux, ou pour nous ?
"Syrie : le précédent libyen n’est pas pertinent", Le Monde, 7 juin 2012, p. 22.
En demandant que la France fasse "pour Houla et Homs, ce qu’elle a fait pour Benghazi et Misrata" (Le Monde du 29 mai), Bernard-Henri Lévy se fait l’écho d’une critique répandue, celle du "deux poids, deux mesures", qu’on appelle aussi le problème de la sélectivité. Pourquoi intervenir ici et pas là, quand les exactions sont similaires ? Y aurait-il donc de bonnes et de mauvaises victimes ? Non. Mais il y a de bonnes et de mauvaises opportunités d’intervenir : celles qui permettraient de secourir, et d’autres qui sacrifieraient trop. La sélectivité s’explique et même se justifie. Elle s’explique en premier lieu parce que les Etats n’interviennent que là où ils ont un intérêt à le faire. C’est-à-dire que l’intervention n’est jamais purement humanitaire : ses motivations sont toujours plurielles. Tant que les Etats auront des intérêts, les interventions seront sélectives.
En russe : http://www.inosmi.ru/asia/20120608/...

"L’intervention militaire justifiée par des raisons humanitaires, de la Libye à la Syrie", Grotius International. Géopolitiques de l’humanitaire, avril 2012
A l’heure où se pose la question d’une intervention militaire en Syrie, que certains invoquent en s’appuyant sur le précédent libyen et la « responsabilité de protéger » (R2P) de la « communauté internationale », il est important de clarifier les termes du débat. Et de ne pas s’appuyer sur ce que Raymond Aron appelait « des mots d’ordre grandioses et vagues ».

"Quand intervenir ? Le critère du dernier recours dans la théorie de l’intervention humanitaire", Raisons politiques, 45, 2012, p. 103-128.
On s’entend pour dire que toute intervention militaire, même justifiée par des raisons humanitaires, doit être menée « en dernier recours ». Mais qu’est-ce que le dernier recours ? Cet article met en évidence des problèmes épistémologiques au sein de ce critère classique de la doctrine de la guerre juste, qui est également contre-intuitif face à une urgence humanitaire : épuiser tous les recours, n’est-ce pas perdre du temps ? Ce critère est également problématique en ce qu’il présuppose que l’usage de la force armée est toujours la pire des options, alors que ce n’est pas forcément le cas. Cet article corrige et reformule le principe du dernier recours en celui de l’option la moins mauvaise, dans le cadre d’une éthique réaliste du moindre mal.
English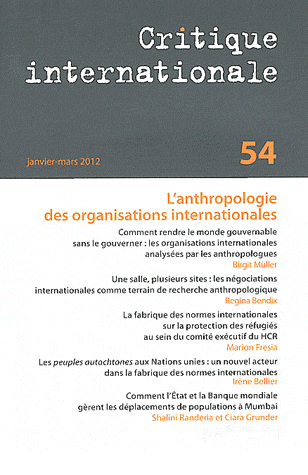
"Pourquoi intervenir ? Le critère de la cause juste dans la théorie de l’intervention humanitaire armée", Critique internationale, 54, 2012, p. 145-168.
La théorie de l’intervention militaire justifiée par des raisons humanitaires reprend en général les critères de la doctrine traditionnelle de la guerre juste : cause juste, autorité légitime, bonne intention, effet positif, dernier recours et proportionnalité. En ce qui concerne le premier de ces critères, la cause juste, il y a au moins trois manières de l’aborder. Certains auteurs utilisent une formulation en termes de droits : puisque l’intervention humanitaire est définie comme celle visant à prévenir ou à mettre fin à des violations massives de droits de l’homme, déterminer la cause juste revient finalement à dire de quels droits il s’agit. La plupart des auteurs utilisent une formulation en termes d’exactions : ils dressent une liste des crimes qui, selon eux, constituent des causes justes d’intervention. La troisième approche consiste à formuler la question en termes de dommage, sans nécessairement préciser quels sont les droits violés et quels sont les crimes causant ces dommages. Cette position s’inscrit dans une perspective conséquentialiste.
English
"Tuer ou laisser mourir ? Un résumé du livre", Dossier du ROP (Réseau francophone de recherche sur les opérations de paix), 6 avril 2012
Ce n’est jamais l’humanité qui fait la guerre : ce sont toujours des Etats qui utilisent un concept. Dans La Guerre au nom de l’humanité : tuer ou laisser mourir (PUF, 2012), j’analyse ce phénomène dans plusieurs dimensions – historique, juridique, éthique et politique – pour élaborer une théorie réaliste de l’intervention militaire justifiée par des raisons humanitaires.

"Les interventions militaires en débat 4/4 : Les évolutions d’Amnesty International", La Chronique. Mensuel d’Amnesty International France, avril 2012, p. 22-23.
La mission d’impartialité d’Amnesty International (voir La Chronique n°294, avril 2011) est au coeur de sa position sur l’intervention militaire justifiée par des raisons humanitaires. Le but de l’organisation n’est pas de prendre parti dans un conflit, qu’il soit interne ou internationalisé, mais de détecter et dénoncer des violations des droits de l’homme. « On fait des recommandations aux différentes parties sur la base de cette impartialité, explique Stephan Oberreit, directeur général de la section française. On ne condamne pas des régimes en tant que tels mais des violations ».
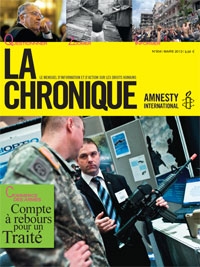
"Les interventions militaires en débat 3/4 : L’intervention en Libye (2011)", La Chronique. Mensuel d’Amnesty International France, mars 2012, p. 22-23.
En dépit des réticences de certains Etats et d’une partie de l’opinion, l’intervention en Libye marque la fin de l’éclipse de l’intervention humanitaire de la première décennie du XXIe siècle, et constitue la première intervention humanitaire au sens classique du terme, c’est-à-dire sans le consentement de l’Etat cible, depuis le Kosovo.

"Existe-t-il un "effet CNN" ? L’intervention militaire et les médias", Inaglobal. La revue des industries créatives et des médias, 8 février 2012
Quel type d’influence les médias ont-ils sur la politique étrangère, et sur le déclenchement d’interventions militaires en particulier ? "L’effet CNN" désigne l’influence des médias sur la politique étrangère, notamment sur la décision d’intervenir dans un conflit armé ou suite à une catastrophe naturelle. L’expression s’est répandue suite au développement considérable à la fin du XXe siècle des chaînes télévisées d’information continue – dont CNN est le symbole, mais elle n’est évidemment pas la seule.

"Les interventions militaires en débat 2/4 : L’intervention américaine en Irak (2003) ", La Chronique. Mensuel d’Amnesty International France, février 2012, p. 22-23.
L’intervention américaine en Irak en mars 2003 peut-elle être considérée comme une intervention humanitaire ? Quelle que soit leur tendance politique – en France, Kouchner, Glucksmann, Madelin ; en Amérique du Nord, Ignatieff, Scruton, Tesón –, les faucons interventionnistes répondent par l’affirmative. La plupart des juristes et des membres de la société civile répondent par la négative. Pour trancher, on peut tenter d’appliquer au cas irakien les critères traditionnels de la doctrine de la guerre juste : autorité légitime, cause juste, bonne intention, dernier recours, proportionnalité et effet positif.

"Les interventions militaires en débat 1/4 : L’âge d’or de l’interventionnisme des années 1990 et l’intervention au Kosovo (1999)", La Chronique. Mensuel d’Amnesty International France, janvier 2012, p. 22-23.
Entre 1945 et 1990, à l’ONU, les opposants traditionnels à l’idée d’intervention sont le bloc de l’Est, les pays du Sud (faibles craignant l’appétit des forts) et les jeunes Etats (attachés à leur souveraineté chèrement acquise). Or, dans la dernière décennie du siècle, on assiste à l’effondrement du bloc de l’Est, l’essor de la démocratie au Sud et la maturation des jeunes Etats. Autrement dit, les obstacles à l’interventionnisme tombent peu à peu. A cela il faut ajouter les efforts de la diplomatie française pour promouvoir le droit d’assistance, le développement de la pratique de l’action humanitaire, le rôle croissant des médias et la consécration de ce que l’on appelle « l’effet CNN », le développement d’un discours global sur les droits de l’homme, la multiplication des instruments disponibles et, enfin, la mondialisation, qui réduit la distance entre la victime et l’observateur-intervenant potentiel.

"La justice pénale internationale prise dans le dilemme de la paix et de la justice", Grotius International. Géopolitiques de l’humanitaire, janvier 2012
D’un côté, les politiques, les diplomates et les négociateurs donnent la priorité à la paix : ils craignent notamment que des poursuites judiciaires à l’encontre des personnes soupçonnées d’avoir commis des crimes nuisent voire empêchent l’obtention d’un cessez-le-feu et le retour à la paix. Ils leur proposent donc des amnisties officielles, ou des arrangements secrets, pour contourner le glaive de la justice et les convaincre de se rendre à la table des négociations. Ils ne rejettent pas a priori le rôle de la justice mais soutiennent qu’il n’y a pas de justice sans paix. D’un autre côté, les défenseurs des droits de l’homme et les représentants des institutions judiciaires internationales donnent la priorité à la justice : ils pensent qu’une paix achetée par l’impunité est illusoire et provisoire, et que la justice peut avoir un effet pacificateur, notamment en dissuadant la commission de crimes futurs. C’est ici qu’apparaît le slogan « pas de paix sans justice ».

"Le regard du politologue : au nom du moindre mal et de l’intime conviction", Dossier "Quand la France doit-elle entrer en guerre ?", Alternatives Internationales, 53, décembre 2011, p. 54-55.
En 2005, l’Organisation des Nations unies a adopté un document reconnaissant aux Etats la " responsabilité de protéger ". Toute intervention militaire qui se prétend humanitaire est-elle pour autant légale ou légitime ?
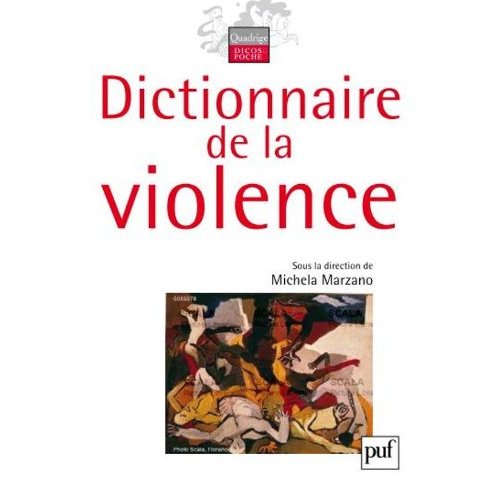
"Ingérence (humanitaire)", in Michela Marzano (dir.), Dictionnaire de la violence, Paris, PUF, 2011, p. 702-706.
L’ingérence est par définition une violence puisqu’il s’agit d’une immixtion sans titre, sans droit, d’une intervention illicite. Le mot est généralement employé pour parler des relations entre les États, sur la scène internationale, et l’ingérence peut alors être soit immatérielle, dans le cas d’une déclaration, par exemple, de ce qu’on appelait au XIXe siècle une intervention diplomatique, soit matérielle, c’est-à-dire physique, de ce qu’on appelait et qui s’appelle encore une intervention armée. Dans les deux cas, mais avec des moyens et des conséquences différentes, il s’agit de contraindre par la force, ou la menace de la force. Le sens qui nous intéresse ici est celui que l’on donne à l’ingérence dite humanitaire, c’est-à-dire à cette forme d’intervention qui revendique une légitimité exceptionnelle en vertu de la manière dont elle est justifiée : par des raisons humanitaires, pour secourir des victimes de violations graves et massives des droits de l’homme.
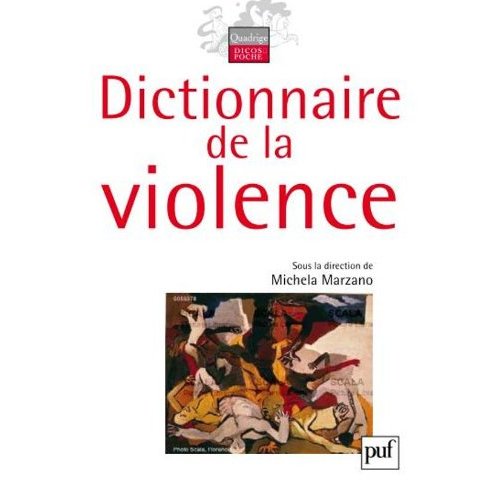
"Bombardements aériens", in Michela Marzano (dir.), Dictionnaire de la violence, Paris, PUF, 2011, p. 161-168.
Le problème du bombardement, qu’il soit terrestre, maritime ou aérien et, plus généralement, de toute action meurtrière à distance, est que celui qui attaque n’a pas un contact direct avec sa cible mais se tient à une certaine distance ou hauteur, qui garantit sa sécurité mais peut nuire à son discernement. Cela rend plus difficile le respect de l’un des piliers du droit de la guerre : le principe de discrimination, selon lequel il est absolument interdit de tuer délibérément des non combattants, et « les attaques doivent être strictement limitées aux objectifs militaires », c’est-à-dire « aux biens qui, par leur nature, leur emplacement, leur destination ou leur utilisation apportent une contribution effective à l’action militaire et dont la destruction totale ou partielle, la capture ou la neutralisation offre en l’occurrence un avantage militaire précis » (art. 52§2 du Protocole additionnel 1 aux conventions de Genève). Afin de rendre compatible cet avantage stratégique décisif qu’est le recours au bombardement aérien avec cet impératif moral et juridique fondamental qu’est le respect du principe de discrimination, s’est lentement élaborée une norme dont nous retracerons la construction, avant d’examiner l’une de ses limites.

"The Ethics of Intervention – Human Rights, National Sovereignty and the Balance of Risk", Debate with prof. Malcolm Chalmers, Speakers’ Corner Trust, 2 août 2011
The international community has too often been paralysed in the face of an avoidable humanitarian crisis by the lack of an agreed ethical framework for intervention. The price has been paid by the victims. If further crises are to be avoided, we need to address the objections to humanitarian intervention.
"L’Afrique face à la justice pénale internationale", Le Monde.fr, 12 juillet 2011
L’Afrique a trente et un Etats parties au Statut de Rome, qui ont donc l’obligation de coopérer avec la Cour. Lorsque celle-ci est saisie par le Conseil de sécurité, cette obligation est même étendue à tous les Etats membres de l’ONU. La résistance de l’Afrique est un révélateur d’au moins deux des problèmes auxquels la justice pénale internationale est aujourd’hui confrontée.
"Tuer l’ennemi public numéro 1, est-ce "rendre justice" ?", Le Monde, 14 mai 2011, p. 23.
Il y a là un affrontement entre deux écoles classiques de philosophie pénale. Ceux qui pensent que tuer permet de rendre justice ont une conception rétributiviste, tournée vers le passé, selon laquelle la raison d’être de la peine est d’imposer un dommage à l’auteur du crime, pour le punir de son action. C’est la logique du talion, qui est d’ailleurs utilisée par les partisans de la peine de mort. Ceux qui, au contraire, pensent que tuer ne permet pas de rendre justice ont une conception utilitariste, tournée vers l’avenir, selon laquelle la raison d’être de la peine est d’être utile à la société, en prévenant ou en réduisant le risque d’un certain comportement. On peut considérer que tuer Ben Laden est légitime à certains égards. Mais dire que cela permet de "rendre justice" est contraire aux valeurs de la République française.
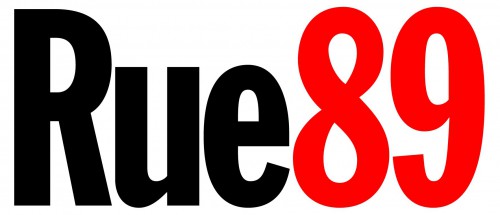
"Libye : le faux problème du ’deux poids, deux mesures’", Rue89, 12 avril 2011
Parmi les critiques formulées récemment à l’encontre de l’intervention en Libye figure en bonne place celle du « deux poids, deux mesures » : pourquoi la Libye et pas Bahreïn, la Syrie ou le Yémen ? Cette question récurrente émerge à chaque intervention : pourquoi secoure-t-on un pays plus qu’un autre, pourquoi le Kosovo et pas la Tchétchénie ? Elle est légitime puisque, d’un côté, on prétend intervenir au nom d’une règle universelle – la protection des droits de l’homme – et de l’autre, on ne l’applique pas universellement. Les droits des Tchétchènes, des Zimbabwéens et des Darfouris valent-ils donc moins que ceux des Kosovars, des Timorais et des Libyens ? Comment justifier cette asymétrie morale ?

"Quelle responsabilité de protéger ?", Ouest France, 11 avril 2011
Les interventions militaires en Libye et en Côte d’Ivoire sont partout présentées comme la consécration de la « responsabilité de protéger », c’est-à-dire l’idée que la communauté internationale doit intervenir pour prévenir ou faire cesser les violations graves et massives des droits de l’homme. Le concept est tiré d’un rapport déposé par une Commission internationale en 2001 et l’on dit qu’il existe « juridiquement » depuis son adoption par l’Assemblée générale des Nations Unies en 2005. Qu’en est-il réellement ?
"Ecarter le tyran pour protéger la population", Le Temps, 6 avril 2011
L’une des nombreuses questions qui restent sans réponse au sujet de l’intervention en Libye est celle de son objectif : s’agit-il de protéger les civils ou de renverser Kadhafi ? D’une intervention humanitaire dont le but est d’empêcher un massacre, ou d’une intervention politique, pro-démocratique, dont le but est de changer de régime ?
"L’intervention en Libye : ni droit d’ingérence, ni désintéressement", Le Monde, 28 mars 2011
L’intervention militaire en Libye donne lieu à certaines confusions. On parle volontiers d’une renaissance du droit d’ingérence, qui aurait été rebaptisé "responsabilité de protéger". Sans jamais questionner la réalité d’un tel droit – puisqu’il est de notoriété publique, en France, qu’il existe et que Bernard Kouchner en est "l’inventeur". Double falsification. Ce que l’on appelle l’ingérence est le fait pour un Etat de violer la souveraineté d’un autre Etat en utilisant la force pour mettre fin à des violations graves des droits de l’homme – mais cela n’a jamais été un droit. Et Bernard Kouchner a seulement popularisé cette idée qui n’est ni française ni récente. Les anglophones l’appellent "humanitarian intervention" depuis le XIXe siècle.
"Libye : ni droit d’ingérence ni altruisme", Le Figaro, 26-27 mars 2011, p. 18.
Il est possible et souhaitable de défendre cette intervention sans faire appel à des notions aussi faibles que le droit d’ingérence ou la responsabilité de protéger, et sans avoir la naïveté de faire croire que les États intervenants sont désintéressés.

"Comment distinguer neutralité et impartialité ? Le cas du CICR", La Chronique. Mensuel d’Amnesty International, n°294, avril 2011, p. 14.
Les principes sur lesquels s’appuie le Comité International de la Croix-Rouge (CICR) n’ont pas été formulés explicitement dès sa création, en 1863, mais en 1920, lorsqu’Edmond Boissier écrit dans la revue de l’organisation que « Charité et universalité, à côté de l’indépendance et de l’impartialité, sont les caractères essentiels et distinctifs de la Croix-Rouge ». L’année suivante, le CICR dans ses statuts se donne la tâche de « maintenir les principes fondamentaux et uniformes de l’institution de la Croix-Rouge », parmi lesquels « l’impartialité, l’indépendance politique, confessionnelle et économique ».

"Défendre les droits humains, est-ce être impartial ?", La Chronique. Mensuel d’Amnesty International, n°294, avril 2011, p. 11.
Amnesty International est une ONG qui défend les droits humains et le fait en revendiquant une impartialité. Mais défendre les droits humains, n’est-ce pas déjà être partial ? N’est-ce pas déjà prendre le parti que les humains ont des droits et qu’il faut les défendre ? Prétendre le contraire présuppose que les droits humains ne dépendent pas de préférences subjectives mais existent objectivement, et que les défendre n’est pas non plus une préférence subjective mais un devoir universel. Or, ces deux énoncés ne vont pas de soi.

"Impartialité : de quoi s’agit-il ?", La Chronique. Mensuel d’Amnesty International, n°294, avril 2011, p. 11.
Le terme est apparu au XVIe siècle et signifie littéralement l’absence de partialité, c’est-à-dire de parti pris. L’impartialité est cette attitude, considérée comme vertueuse, synonyme de droiture et de justice, qu’on attend par exemple d’un juge : qu’il ne manifeste aucun préjugé personnel, qu’il soit désintéressé, indépendant et neutre. L’homme n’ayant ni le point de vue de Dieu ni ce que le philosophe américain Thomas Nagel appelle le « point de vue de nulle part », cette attitude ne lui est pas naturelle et représente un effort considérable : il faut s’arracher de ses préférences personnelles, s’en détacher, en faire abstraction ; « dépersonnaliser » le jugement, la décision ou l’action.

"Régimes oppressifs : qu’en disent disent les médias ? (3/3)", La Chronique. Mensuel d’Amnesty International, n°294, avril 2011, p. 20-21.
Après avoir distingué les différents types de régimes oppressifs puis examiné le cas particulier de la Chine, nous questionnons la manière dont les médias usent - ou abusent - des qualificatifs accolés à certains pays hier et aujourd’hui.

"Régimes oppressifs : la Chine est-elle une dictature ? (2/3)", La Chronique. Mensuel d’Amnesty International, n°293, mars 2011, p. 22-23.
Comment nier que la Chine soit une dictature, puisqu’elle en a toutes les caractéristiques ? On peut choisir de ne pas le dire, mais il est difficile de le cacher. La question concerne finalement moins le genre que l’espèce : cette dictature est-elle autoritaire ou totalitaire ?

"Régimes oppressifs : de quoi parle-t-on ? (1/3)", La Chronique. Mensuel d’Amnesty International, n°292, février 2011, p. 20-21.
Que veut-on dire, au juste, lorsque l’on dit d’un régime, d’un pays, qu’il est une dictature ? Qu’il est totalitaire ? Autoritaire ? Est-ce la même chose ? Que veut-on dire, au juste, lorsque l’on parle de tyrannie, de despotisme, d’absolutisme, voire de fascisme ? L’usage est vague et les considère volontiers comme des synonymes. Les médias aiment les étiquettes et les distribuent généreusement. La littérature spécialisée les distingue mais n’est pas accessible au plus grand nombre. L’honnête homme réclame – et mérite – une clarification terminologique.

"Turkménistan contre Azerbaïdjan : les implications politiques et juridiques du différend autour des gisements de la Caspienne", Regard sur l’Est, dossier n° 55, septembre 2010 "Ressources énergétiques de la Caspienne"
Les relations entre le Turkménistan et l’Azerbaïdjan sont compliquées depuis l’indépendance acquise en 1991, en grande partie à cause de cette mer Caspienne qui sépare les deux pays autant qu’elle les réunit, mais aussi à cause de la personnalité du premier président turkmène, Saparmourat Niazov (1991-2006) qui entretenait des rapports conflictuels avec ses homologues azerbaïdjanais et ouzbek notamment.

"Turkménistan : la grande illusion", La Chronique. Mensuel d’Amnesty International, n°286, septembre 2010, p. 10-17.
Dossier Turkménistan avec trois articles : une introduction générale sur la situation des droits de l’homme, une enquête sur les prisons turkmènes et une analyse sur les conditions d’enquête au Turkménistan pour les ONG internationales, avec 13 photos.

"Recension du livre de Hugo Slim", Les civils dans la guerre. Identifier et casser les logiques de violence, Genève, Labor et Fides, 2009, pour le site internet du Réseau de recherche sur les opérations de paix (ROP), août 2010.
La traduction française de Killing Civilians d’Hugo Slim (Londres, Hurst, 2007) est fort bienvenue, et pas seulement parce que, comme le rappelle l’auteur, sa publication coïncide avec les 60 ans des Conventions de Genève ou parce que la tradition humanitaire francophone est particulièrement riche. Il s’agit d’un livre important, dont la raison d’être et le point de départ est à la fois une intuition morale millénaire (la protection des plus faibles) et l’un des piliers du droit international humanitaire moderne (le principe de discrimination entre combattants et non-combattants).

"La mythologie française du droit d’ingérence", Libération, n°9017, 11 mai 2010, p. 20.
Dans un article récent (Libération, 24 mars), Bernard Kouchner affirmait une nouvelle fois ce qui s’est imposé depuis longtemps comme l’histoire officielle du droit d’ingérence : « Je me suis battu pour que le droit d’ingérence, inventé par les French Doctors, voie le jour. Nous en avons créé jusqu’au nom. Depuis sa naissance, je travaille pour que ce droit vive. J’ai soutenu sa consécration par l’ONU sous le nom de "responsabilité de protéger" ». En réalité, ce que l’on appelle le « droit d’ingérence » n’existe pas, il n’a pas été inventé par les French Doctors, le nom lui-même était déjà utilisé depuis un siècle et demi, la responsabilité de protéger n’est pas la même chose, et ses créateurs rejettent explicitement le droit d’ingérence à la française.
"¿Hasta dónde ir en nuestras relaciones con las dictaduras ?", La Nación (Chili), 22 mars 2010
Contrariamente a una idea bastante extendida, en relaciones internacionales realismo y moral no se oponen, sino que son interdependientes.
(Traduction de l’article du Monde)
"Jusqu’où aller dans nos relations avec les dictatures ?", Le Monde, 23 février 2010
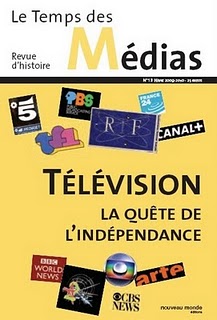
"L’impossible indépendance de la télévision du Turkménistan indépendant", Le Temps des médias, 13, 2009, p. 86-104.
Le Turkménistan est une dictature d’Asie centrale dans laquelle il n’y a strictement aucune liberté de la presse. Cet article examine la construction de la télévision nationale depuis l’indépendance du pays, le contrôle, la censure et l’instrumentalisation du média, le contenu des programmes et son rôle dans l’édification d’un pouvoir sultanique, d’abord sous le président Niyazov (1991-2006), ensuite sous son successeur Berdymouhamedov (depuis 2007).
"Le Darfour doit-il faire le deuil de la justice pour obtenir la paix ? ", Le Temps, 7 avril 2009 : tribune
Les vives réactions au mandat d’arrêt de la Cour pénale internationale (CPI) contre le président soudanais Omar al-Bachir ont montré que cette décision a des enjeux complexes, dont il faut prendre toute la mesure. Le premier d’entre eux est ce que l’on pourrait appeler le dilemme ou le paradoxe de la paix et de la justice, problème classique des relations internationales. La décision de la CPI est assurément un progrès pour la justice, un soulagement pour les victimes et une avancée significative dans l’histoire du droit pénal international. La question est de savoir si c’est une bonne chose pour la paix.
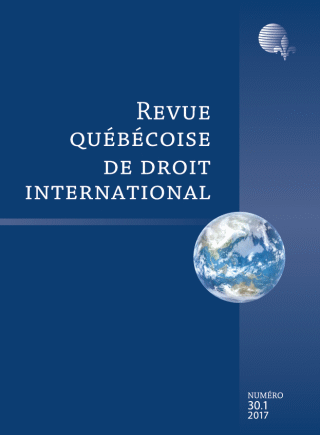
"Recension du livre de Dominique Gaurier", Histoire du droit international : Auteurs, doctrine et développement de l’antiquité à l’aube de la période contemporaine, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2005, dans la Revue québécoise de droit international, septembre 2008.
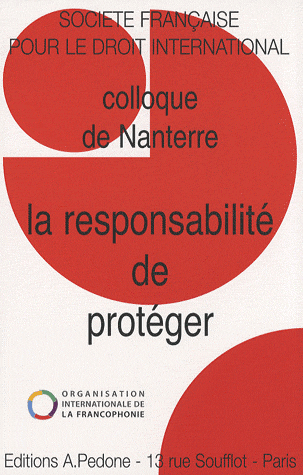
"La responsabilité de protéger et le débat sur la qualification de génocide au Darfour ", in La responsabilité de protéger, Actes du 41e colloque annuel de la Société Française pour le Droit International (SFDI), Paris, Pedone, 2008, 233-241.
Le but de cette présentation est d’analyser le rôle du débat sur la qualification de génocide relativement à la responsabilité de protéger qui s’impose en principe à la communauté internationale dans le cas du Darfour. Deux questions sont particulièrement populaires au sujet du Darfour. D’une part, savoir s’il s’agit d’un génocide. D’autre part, s’il faut intervenir et surtout comment. Le but de ma communication n’est pas d’approfondir chacune de ces questions, mais d’analyser la relation qu’elles entretiennent. Autrement dit, ce qui m’intéresse ici est le lien entre deux débats : celui sur la qualification de génocide et celui sur la responsabilité de protéger au Darfour. Dans quelle mesure la qualification de génocide est-elle pertinente à l’égard de la responsabilité de protéger dans le cas du Darfour ? Pour le savoir, je procéderai en deux parties, en examinant dans un premier temps le débat lui-même : les actes commis au Darfour peuvent-ils être qualifiés de génocide ? Et, dans un second temps, les conséquences d’une telle détermination : quelle est la pertinence et l’importance de la qualification de génocide relativement à la nécessité d’agir ?
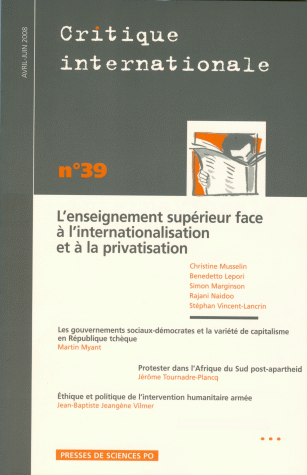
"Éthique et politique de l’intervention humanitaire armée", Critique internationale, 39, avril-juin 2008, 161-182.
L’intervention humanitaire armée, connue également par les concepts de « droit ou devoir d’ingérence » et de « responsabilité de protéger », est une intervention militaire en territoire étranger pour mettre fin à des violations graves et massives des droits de l’homme. Cette pratique étant définie selon son but, elle repose entièrement sur la « bonne intention » de l’Etat intervenant, sous-estimant du même coup le poids de la politique dans l’éthique de l’intervention. Dans quelle mesure l’Etat intervenant doit-il être désintéressé ? Le but de cet article est triple. Premièrement, proposer une critique réaliste du critère traditionnel de « bonne intention », donc abandonner l’exigence de désintéressement de l’Etat intervenant. Deuxièmement, examiner le cas irakien : peut-il être considéré comme une intervention humanitaire ? Troisièmement, reconstruire une éthique pragmatique et essentiellement conséquentialiste de l’intervention humanitaire, sans le critère de « bonne intention », et basée sur une double évaluation permettant d’éviter ou au moins de limiter l’usage prétextuel du label humanitaire.
English
"Humanitarian Intervention and Disinterestedness", Peace Review : A Journal of Social Justice, 19:2, 2007, p. 207-216.
The contemporary conception of humanitarian intervention is entirely based on what is usually called the “right intention” criterion, which is a requirement of disinterestedness or selflessness of the intervening state. From a realist perspective which cautiously presumes that states are never totally disinterested, the question is : How distinterested should the intervening State be ? The “hierarchy of motives” criterion presuming that the presence of egoistic motives would not be prejudicial as long as the humanitarian aspect stays the “primary goal” or the “overriding motive” is easy to refute. By the same token, multilateralism, consent of victims and consent of the region do not resist the reality of international relations. Therefore, the disinterestedness of the intervening State is a weak postulate which must be abandoned.
"Le Darfour, le génocide, les médias et les intellectuels", Le Panoptique, 15, octobre 2007
Le débat sur la qualification de génocide au Darfour a une dimension politique,juridique et médiatique. Il a lieu parce que l’on se persuade que la reconnaissance d’un génocide impliquerait l’obligation légale d’intervenir pour y mettre fin, ce qui est faux. Le rôle des intellectuels dans ce débat n’est pas satisfaisant. Il devrait être de démasquer l’amalgame terminologique, l’hyperbole sémantique et l’usage d’une rhétorique génocidaire dont le but est essentiellement de mobiliser les foules. Encore faudrait-il que les médias donnent leur place aux intellectuels spécifiques, entre les intellectuels universels et les experts.

"Darfour : quelle intervention ?", L’Information Agricole, 804, janvier-février 2007, p. 6 (édito)
Face à la passivité grossière de la communauté internationale, de nombreuses voix s’élèvent pour réclamer une intervention militaire, au nom de ce qu’on appelle en France le droit ou le devoir d’ingérence. L’intention est bonne, mais il faut en mesurer les probables effets pervers.

"L’intervention humanitaire armée en Chine antique", Revue des deux mondes, janvier 2006, 152-173.
« (…) la lecture fort suggestive que propose M. Jean-Baptiste Jeangène Vilmer sur la manière dont la Chine antique a théorisé le droit à la guerre. Pour les Machiavel chinois du IIIe siècle avant J.-C., faire la guerre, c’était la faire au tyran, en portant secours aux populations asservies. Une guerre humanitaire en quelque sorte, capable non seulement de légitimer le combat pour la victoire mais aussi l’exercice du pouvoir, une fois le tyran chassé. On voit par là comme nos sages confucéens eussent pu trouver un emploi de conseil auprès de M. Bush et de beaucoup d’autres responsables » (éditorial de Michel Crépu, p. 6).
Ethique animale (2005-2015)
SYNTHESE
- Articles dans Journal international de bioéthique ; Revue semestrielle de droit animalier ; L’Archicube : revue de l’Association des anciens élèves et amis de l’École normale supérieure ; Klēsis : revue philosophique ; Cahiers antispécistes ; Jeu : revue de théâtre, etc.
- chapitres de livres chez Presses Universitaires de Rennes (PUR), Payot, Editions Quae, Michigan State University Press, Presses universitaires de France (PUF), etc.
- Tribunes dans la presse : Le Monde, Libération, Le Courrier, L’Express, Le Devoir, etc.

"Foreword (on ’the Animal Question’)", in Louisa Mackenzie and Stephanie Posthumus (eds), French Thinking About Animals, East Lansing, Michigan State University Press, 2015, p. vii-xiii.
Is there a French way of asking the “animal question” ? First of all, we might ask : what is the animal question exactly ? Referring back to the first uses of the expression, we can respond that the animal question was principally a question of animal ethics : what moral responsibility do humans have towards non-human animals ?
"Le repas végétarien, le plus laïque de tous", Le Monde, 27 mars 2015, p. 15.
(avec Sandrine Bélier, Allain Bougrain-Dubourg, Florence Burgat, Aymeric Caron, Franz-Olivier Giesbert et Matthieu Ricard) - Plutôt que d’utiliser le porc ou la laïcité pour attiser la haine confessionnelle et diviser les Français, nous proposons une solution simple, défendue par ailleurs depuis longtemps par de nombreuses associations : l’instauration dans les cantines scolaires d’une alternative végétarienne systématique, c’est-à-dire à tous les repas, et pas seulement lorsque du porc est proposé.
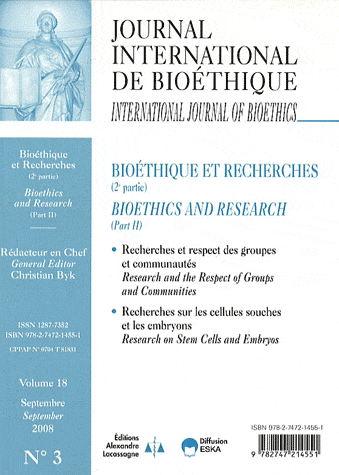
"Diversité de l’éthique animale", Journal international de bioéthique, 24:1, 2013, p. 15-28.
L’éthique animale n’est pas un ensemble de règles sur la conduite à adopter à l’égard des animaux avec lesquels nous interagissons mais un domaine de recherche qui a pour objet l’étude de la responsabilité morale des hommes à l’égard des animaux pris individuellement. Cet article le présente à travers plusieurs fractures : celle entre l’humanisme français et l’éthique animale anglophone, celle entre l’approche par la justice et l’approche par la compassion, celle entre l’abolitionnisme et le welfarisme, et celle entre ceux qui parlent de droits des animaux et ceux qui préfèrent parler d’intérêts.

"L’animal n’est pas une frontière", table ronde "Ethique environnementale : eux et nous", Festival "Mode d’emploi", Villa Gillet, Lyon, 30 novembre 2012
La frontière entre l’humain et le non-humain est rendue de plus en plus poreuse, par le progrès technologique d’une part, qui réalise ce qui n’est déjà plus de la science-fiction (intelligence artificielle, clones, robots, cyborgs), et par le progrès moral d’autre part, qui après avoir étendu le cercle de la considération morale des hommes blancs et libres aux esclaves, aux femmes et aux minorités de toutes sortes, s’interroge désormais sur la pertinence de la barrière de l’espèce. C’est à cette seconde frontière que j’aimerais m’intéresser, pour répondre aux inquiétudes de ceux qui pensent qu’accorder davantage de considération à « l’animal » est un grave danger pour « l’humain ».

"Peter Singer : le philosophe qui voulait "libérer" les animaux", La Cité : journal bimensuel (Suisse), 9-23 novembre 2012, p. 17.
Contrairement aux caricatures qu’on en fait souvent, Singer ne réclame pas que l’on traite les animaux comme les hommes. Il dit exactement le contraire : « le principe d’égale considération des intérêts n’exige pas que nous traitions les animaux non humains comme nous traitons les humains », tout simplement parce que certains intérêts des animaux sont différents, et que considérer également des intérêts différents implique des traitements différents.
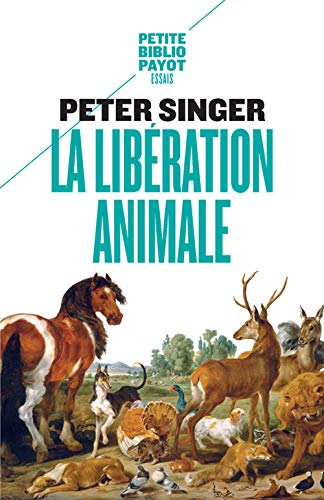
"L’éthique animale de Peter Singer", préface à Peter Singer, La Libération animale, Paris, Payot, collection "Petite Bibliothèque Payot" n°884, 2012, p. 9-39.
Ce livre est un classique. Peter Singer, philosophe australien né en 1946, titulaire de la chaire de bioéthique à Princeton University (Etats-Unis), est régulièrement cité comme étant le philosophe vivant le plus influent dans le monde . Et Animal Liberation (1975), son bestseller vendu à près d’un million d’exemplaires dans une vingtaine de langues, l’un des livres les plus influents du XXe siècle.
"Qui tue le plus ?", (avec Nora Carisse) Nous autres, 8 septembre 2012
Une vaste littérature philosophique existe depuis deux décennies sur la compatibilité de l’éthique animale et l’éthique environnementale. Une littérature plus vaste encore sur la légitimité du véganisme et de l’écologie. Notre propos n’est pas d’élever le débat à ce niveau de généralité : il est beaucoup plus modeste. Il consiste simplement à poser une question : celle de savoir qui, du végan et de l’écologiste, tue réellement le moins d’animaux.

"Cause animale et courage politique", Animal, Santé & Bien-être, 31, mai-juin 2012, p. 10.
La cause animale est un enjeu « important » pour 81% des électeurs français, dont le tiers se dit même prêt à choisir son candidat en fonction de son programme en matière de protection animale (sondage Ifop, décembre 2011). Cela ne l’a pas empêché d’être l’une des grandes absentes de la campagne. Pourquoi les responsables politiques négligent-ils le sort des animaux ?
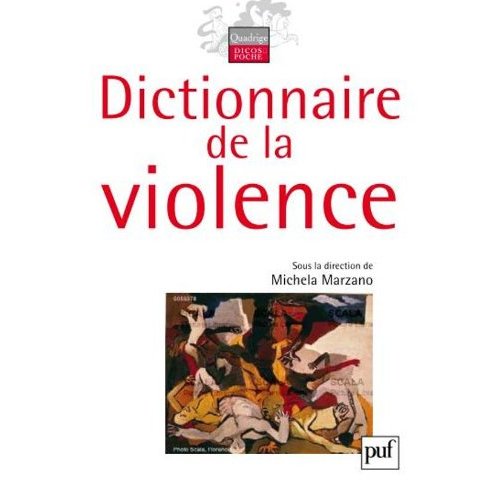
"Animal", in Michela Marzano (dir.), Dictionnaire de la violence, Paris, PUF, 2011, p. 48-52.
Les violences humaines à l’égard des animaux sont considérables, quotidiennes et très diversifiées. Ces comportements suscitent naturellement des interrogations, et c’est ainsi, essentiellement par réaction, que s’est développée l’éthique animale, l’étude du statut moral des animaux, ou de la responsabilité morale des hommes à leur égard.
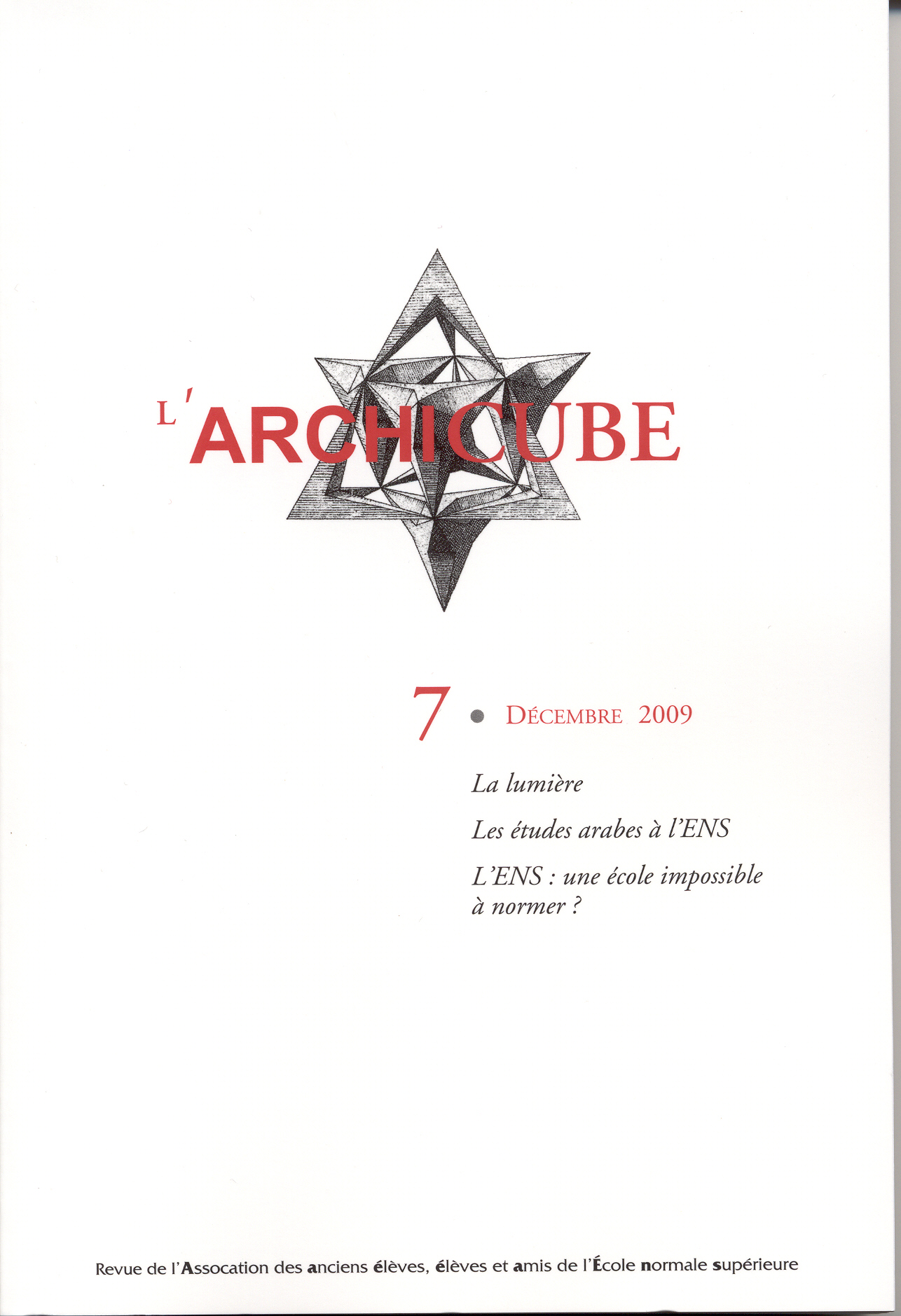
"La vaine rhétorique de la défense "philosophique" de la corrida", L’Archicube. Revue de l’Association des anciens élèves et amis de l’École normale supérieure, 10, mai 2011, p. 209-213.
Il est tout à fait légitime que L’Archicube publie un article de Francis Wolff sur la corrida, en particulier sur la question de savoir si elle peut être considérée comme un sport. Il y a assurément des choses passionnantes à dire sur la corrida, lorsqu’on l’observe en ethnologue. Ce qui est moins légitime, en revanche, est cette manière (d’autant plus difficile à détecter qu’elle est subtile) de glisser du descriptif au normatif. De sous-entendre que, parce que la corrida est intéressante, alors elle est défendable.

"Corrida et argumentation : réfutations sophistiques", in J. Porcher et C. Perreira (dir.), Toréer sans la mort ?, Paris, Quae, 2011, p. 176-188.
Il y a quelques années, à l’Université de Montréal, j’enseignais en même temps deux cours : l’un d’éthique animale, l’autre d’argumentation. Cette coïncidence m’a donné l’occasion de réfléchir sur les stratégies argumentatives – et les sophismes – mis en œuvre dans les discours sur l’animal. La corrida est un cas d’école, un modèle exemplaire, pour ce genre d’exercice. Je me concentre ici sur les justifications philosophiques de la corrida de type espagnol. Cette argumentation, qui consiste à défendre la pratique de la corrida à l’aide de la philosophie, est développée en France par deux philosophes : Alain Renaut et Francis Wolff.

"Les principaux courants en éthique animale", in J.-P. Engélibert, L. Campos, C. Coquio et G. Chapouthier (dir.), La Question animale. Entre science, littérature et philosophie, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2011, p. 79-92.
L’éthique animale peut être définie comme l’étude du statut moral des animaux ou, pour le dire autrement, l’étude de la responsabilité morale des hommes à l’égard des animaux, pris individuellement. Elle pose donc les questions classiques des devoirs de l’homme envers les animaux, des éventuels droits des animaux et, plus généralement, des jugements moraux (c’est-à-dire ceux formulés en termes de bien ou de mal) à porter sur notre traitement actuel des animaux.
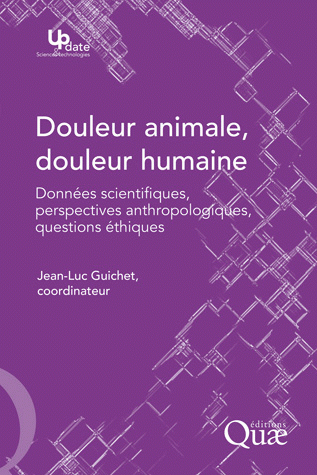
"Le critère de la souffrance dans l’éthique animale anglo-saxonne ", in Jean-Luc Guichet (dir.), Douleur animale, douleur humaine : données scientifiques, perspectives anthropologiques, questions éthiques, Paris, Quae, 2010, p. 191-199.
L’éthique animale est l’étude du statut moral des animaux pris individuellement, c’est-à-dire de la responsabilité des hommes à leur égard. La question est millénaire, mais c’est depuis une trentaine d’années et dans le monde anglo-saxon seulement qu’elle s’est constituée comme une discipline enseignée à l’université et alimentant des milliers de publications.
"La philosophie à l’épreuve de l’animal (éditorial)", Klēsis. Revue philosophique, 16, octobre 2010, p. 1-7.
La question des relations entre humanité et animalité est tellement classique – au sens où elle a toujours été, depuis deux millénaires au moins, l’une des préoccupations philosophiques majeures des hommes – que l’on peut légitimement se demander s’il y a encore des choses intéressantes à dire qui ne figurent pas déjà, et depuis longtemps, dans le gigantesque corpus de ce qui est devenu au fil des siècles un domaine de recherche en soi. Mais c’est sans doute mal poser la question. L’enjeu n’est pas tant la nouveauté des idées, qui ont toutes des racines infiniment diluées dans le continu de l’histoire, que leur utilité. Et il peut être utile, parfois, de rappeler, de développer, de raffiner des propositions anciennes.

"Les sophismes de la corrida", Libération, n°9113, 31 août 2010, p. 18.
Tout est dit dans la loi. La corrida est en France une exception à l’interdiction de pratiquer des « sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux » (art. 521 du Code pénal). Elle est donc, de fait, reconnue par le législateur lui-même comme un sévice grave ou un acte de cruauté, mais qui, à la différence des autres, n’est pas puni. Pourquoi cette impunité ? Parce qu’elle a lieu là où « une tradition locale ininterrompue peut être invoquée ». Voilà donc une pratique punie à Brest, au nom de la sensibilité de l’animal, mais permise à Nîmes, malgré la sensibilité de l’animal.
"L’éthique animale au défi de la diversité", Le Courrier (Suisse), 21 mai 2010, p. 4.
Ancienne mais toujours actuelle, la question des droits des animaux est portée par divers courants de pensée et suscite des passions contradictoires. Cette mutiplicité constitue-t-elle un atout ou un frein à l’avancée de la « cause animale » ?
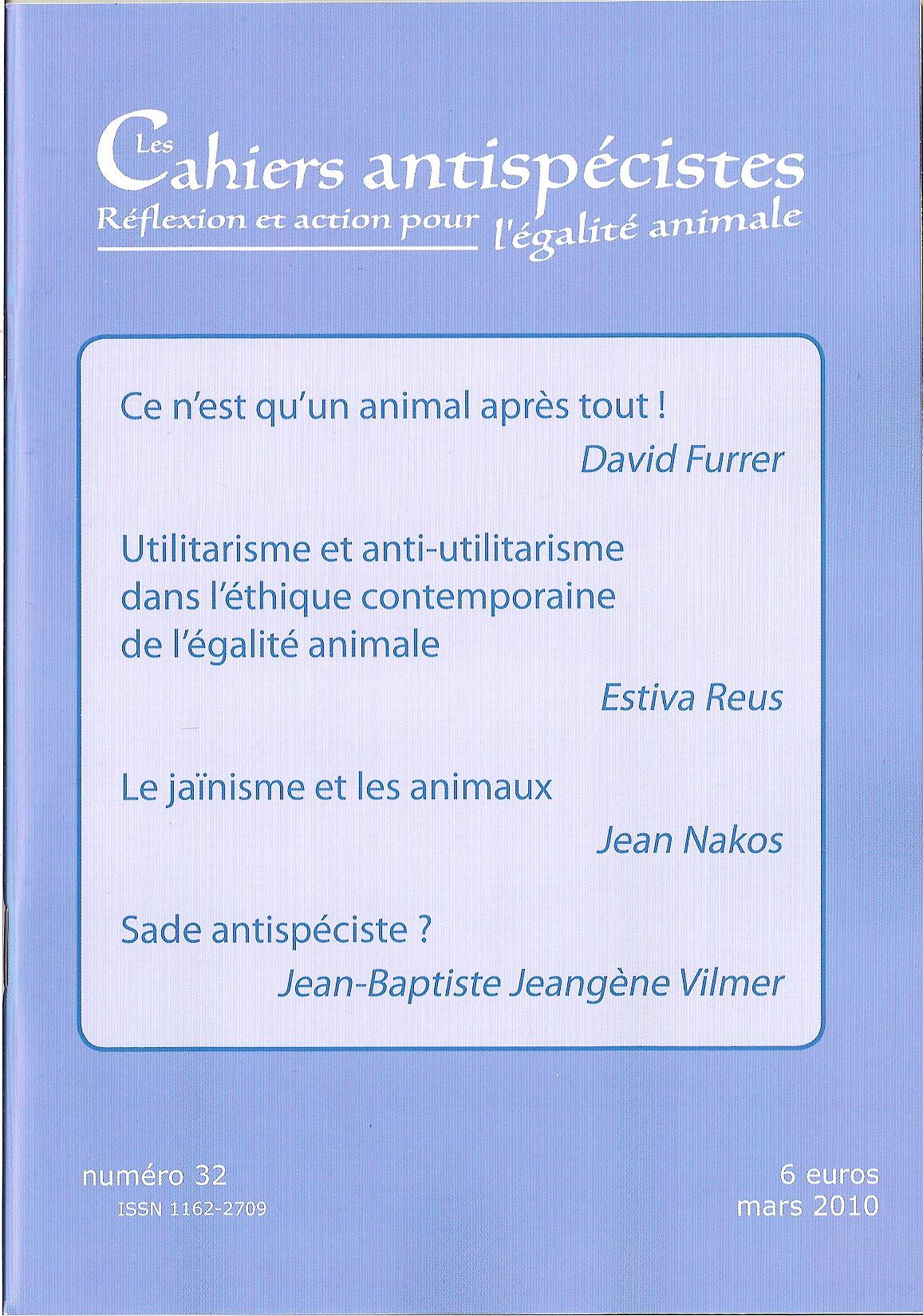
"Sade antispéciste ? ", Cahiers antispécistes, 32, mars 2010, p. 65-82.
Le but de cette modeste note n’est pas de défendre une thèse, qui nécessiterait davantage de matériaux et de développements, mais d’attirer l’attention sur un auteur et de poser une question. Lorsque l’on pense aux origines de l’antispécisme au XVIIIe siècle, on cite invariablement Bentham, parfois Rousseau, Primatt et quelques autres. On ne s’attend pas à trouver quoique ce soit d’intéressant chez le marquis de Sade (1740-1814), pour plusieurs raisons : il n’est généralement pas considéré comme un philosophe mais comme un écrivain, le grand public ne connaît de lui que ses romans les plus scandaleux et la violence extrême qui se dégage de son œuvre semble peu susceptible, a priori, de charrier une quelconque considération morale ou une compassion pour qui que ce soit, les animaux comme les hommes.
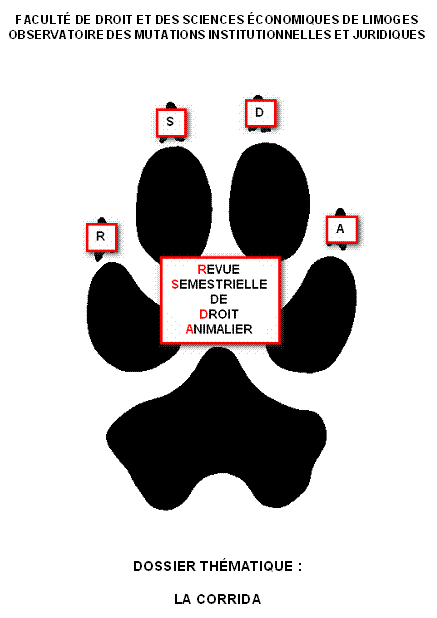
"Les sophismes de la corrida", Revue semestrielle de droit animalier, 2, 2009, p. 119-124.
Cette aberration est fondée sur l’appel à la tradition, qui est un sophisme connu depuis 2000 ans sous le nom d’argumentum ad antiquitam. L’excision est également un rite millénaire, une pratique culturelle, une tradition profondément ancrée. Pourtant, le même législateur l’interdit et fustige ce relativisme culturel, qu’il invoque au contraire quand il s’agit de protéger le « patrimoine » national, dans le cas de la corrida comme dans celui du foie gras. Ce n’est pas parce que l’on fait quelque chose depuis longtemps au même endroit que l’on a raison de le faire. Tous les progrès sociaux ont eu lieu contre les traditions, de l’abolition de l’esclavage au droit de vote des femmes. La tradition en elle-même explique mais ne justifie rien.
italiano
"Animaux dans l’art contemporain : la question éthique", Jeu. Revue de théâtre, 130, mars 2009, p. 40-47.
L’éthique animale est l’étude du statut moral des animaux, c’est-à-dire de la responsabilité des hommes à leur égard . Cette question millénaire, constituée en discipline universitaire depuis une trentaine d’années seulement, couvre la totalité de nos rapports avec les animaux : ceux que l’on mange, ceux que l’on utilise pour faire de la recherche scientifique, ceux qui nous tiennent compagnie, ceux que l’on chasse, pêche ou élève pour leur fourrure, ceux que l’on utilise pour accomplir certaines tâches, civiles ou militaires et, enfin, ceux que l’on utilise pour se divertir. La catégorie des animaux de divertissement, ou qui sont liés à des activités sportives, culturelles ou artistiques, est large et concerne des situations diverses, dont les plus fameuses et les plus problématiques sont les zoos et les cirques, la corrida, les courses, le rodéo et les combats d’animaux. Ces exemples sont bien documentés. L’une de ces situations est moins connue, peut-être parce qu’elle semble poser assez peu de difficultés : l’utilisation d’animaux dans l’art contemporain. L’art ne cesse pas d’être hanté par l’animal, affirment Deleuze et Guattari . Le but de cet article est d’en présenter brièvement les enjeux éthiques.

"Eloge de la tolérance", L’ECHO de la Ligue ROC, 2009-2010
Quel est, quel doit être le rôle de la tolérance dans les stratégies de ceux qui défendent les droits ou les intérêts des animaux ? Pourquoi est-il si important de privilégier l’argumentation rationnelle, dans le respect de l’autre, quel que soit cet autre et quelles que soient ses convictions ?
"Foie gras : pour un débat précis et rigoureux", Le Devoir, 26 juillet 2007
À la suite de l’affaire RAG, le débat sur le foie gras semble s’inviter dans les journaux, notamment dans les pages du Devoir depuis quelques jours. Il est appréciable que l’on puisse discuter librement de ces questions sans attendre les emplettes du mois de décembre. Il est plus fâcheux que la controverse soit truffée au mieux d’imprécisions, au pire de sophismes.
"De l’anti-animalisme primaire ", Le Devoir, 30 mars 2006, p. A7
Il est de bon ton de caricaturer la pensée animaliste et de la réduire à un sentimentalisme incohérent. La récente prestation de Brigitte Bardot en a donné l’occasion à Louis-Gilles Francoeur dans son article « De l’animalisme primaire » (Le Devoir, le 23 mars 2006).
"Les sophismes du foie gras", L’Express, 15 décembre 2005, p. 104
La question n’est pas l’interdiction du foie gras. La France, comme les autres, y viendra. Ce bavardage législatif est d’ailleurs la preuve qu’elle est sur la défensive. La véritable question est celle du débat public, de la discussion qui n’a pas lieu dans une France muselée par les intérêts de quelques-uns et qui accepte sans broncher les sophismes de ceux qui pensent avec leur ventre.
Histoire de la philosophie / métaphysique (2000-2012)
SYNTHESE
- Articles dans Revue de métaphysique et de morale ; Archives de philosophie ; Revue philosophique de Louvain ; Philosophiques ; Dialogue : revue canadienne de philosophie ; Revue des sciences philosophiques et théologiques, L’Irascible, Revue de l’Institut Rhône-Alpes de Sciences Criminelles ; De Philosophia ; La Presse littéraire.
- Chapitre de livre aux Presses universitaires de France (PUF).
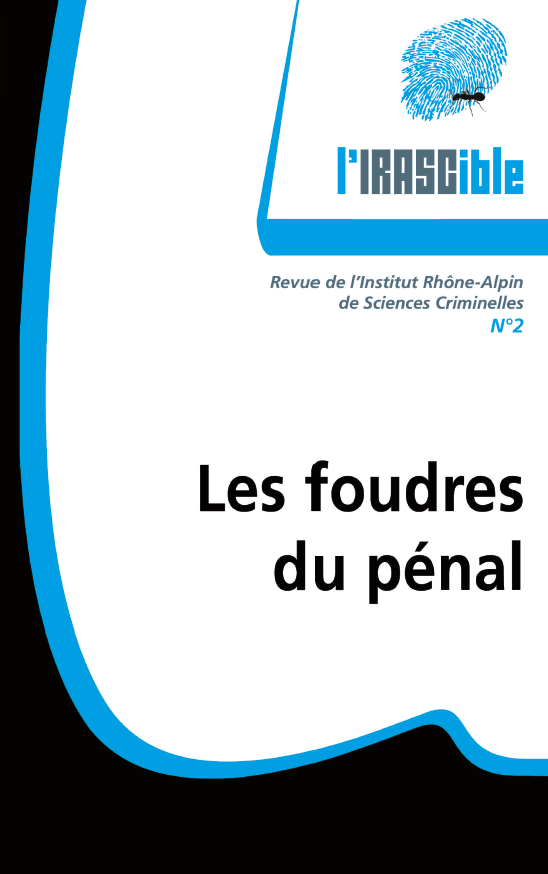
"Sade et la question pénale", L’Irascible, Revue de l’Institut Rhône-Alpes de Sciences Criminelles, 2, 2012, p. 127-152.
Coïncidence. Les dates du marquis correspondent exactement à une période précise de l’histoire du droit français, à savoir la réforme pénale, à l’origine de notre droit contemporain. Sade naît en 1740 ; la réforme du droit pénal, dans les années 1740, avec la critique de plus en plus forte de la justice pénale de l’Ancien Régime, encore réglée par l’ordonnance de 1670. Il meurt en 1814, soit quatre ans après le Code pénal de 1810, sur lequel est basé pour l’essentiel notre Code pénal actuel. Sa vie est celle de la réforme : il naît sous la justice royale, atteint son apogée avec la justice révolutionnaire et le tout premier Code pénal, celui de 1791, et meurt sous le Code napoléonien. L’histoire de la justice et celle de Sade coïncident exactement. Mais il y a mieux : Sade a précisément affaire à la justice pénale. Et il connaît bien les prisons, pour y avoir passé le dernier tiers de sa vie, alors même que les années 1780 à 1815 correspondent à l’émergence de la prison pénale.
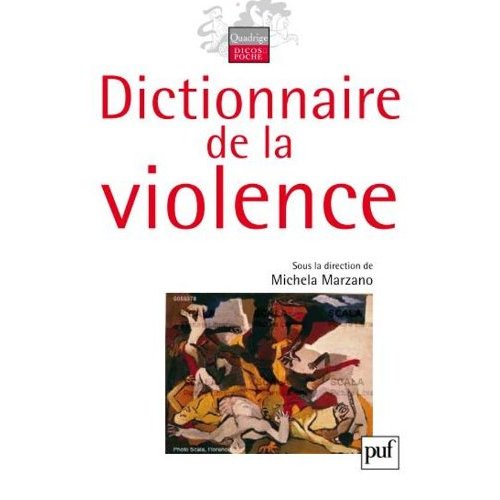
"Sade ", in Michela Marzano (dir.), Dictionnaire de la violence, Paris, PUF, 2011, 1155-1160.
L’œuvre du marquis de Sade est connue pour être l’une des plus violentes jamais écrites. Violente contre la loi, la religion, les conventions, l’ordre établi. Et surtout violente par le moyen du sexe. C’est ce caractère, précisément, qui divise les lecteurs : si cette œuvre si particulière est illisible pour certains et objet d’adoration pour d’autres, c’est parce que le sens de cette violence est différemment compris, et qu’elle suscite en chacun des réactions diverses, mais toujours viscérales. « Je ne m’adresse qu’à des gens capables de m’entendre, et ceux-là me liront sans danger », prévenait déjà l’auteur (Philosophie dans le boudoir). Pour être capable de l’entendre, et surtout de le comprendre, c’est-à-dire pour prétendre avoir des choses à dire non seulement sur le texte mais surtout sur la pensée de Sade, il peut être utile de rappeler trois principes préalables à toute lecture.

"L’indéfini cartésien entre politique et langage", Revue philosophique de Louvain, 109:3, 2011, p. 443-460.
La distinction cartésienne entre infini et indéfini n’a-t-elle que des raisons métaphysiques ? Cet article explore les raisons politiques et langagières qui ont pu pousser Descartes à réserver l’infini (ce qui est positivement sans bornes) à Dieu seul et l’indéfini (ce dont on ne peut prouver les bornes) au monde physique et aux mathématiques. Il montre que cette fameuse distinction est en partie – mais pas exclusivement – politique, en réaction à la pression exercée par l’Ecole et l’Eglise, qui avait eu raison de Galilée quelques années plus tôt. Il en dévoile également les raisons langagières : la distinction est méthodologique et inspirée par l’usage des mots, pour conclure avec Lévinas sur l’importance du discours dans la présentation du transcendant – et par extension dans la philosophie cartésienne.

"réponse à une recension de Sade moraliste", L’Irascible, Revue de l’Institut Rhône-Alpes de Sciences Criminelles, 1, "Les Lumières du pénal", avril 2011, p. 253-259.
Il est rare qu’un auteur ait la possibilité de répondre à la recension d’un de ses ouvrages. Je suis d’autant plus reconnaissant à l’IRASC de me l’avoir proposé que le compte rendu en question – qui comme le dit ce mystérieux DD « est moins une recension qu’une réflexion » – est d’une qualité exceptionnelle. Précis sur le fond, original dans la forme, très bien écrit (le goût immodéré de l’auteur pour les jeux de mots rend même la lecture divertissante), il pose de vraies questions et formule dans sa troisième section quelques objections auxquelles je vais réagir brièvement.

"Descartes et les bornes de l’univers : l’indéfini physique", Philosophiques, 37:2, 2010, p. 299-323.
L’indéfini cartésien, qui désigne ce dont on ne peut prouver les bornes, s’applique à deux domaines : les mathématiques et la physique. Cet article examine son application au monde physique, en deux moments. D’abord, par l’examen de l’indéfinité de l’univers, où l’on montre que l’univers cartésien n’est ni fini ni infini, mais in-défini, à la fois selon l’espace (c’est la question de l’extensio mundi) et selon le temps (c’est la question de l’éternité du monde). Ensuite, par l’examen de l’indéfinité dans l’univers, qui pose le problème de la continuité, à la fois dans l’espace (c’est la question de l’indivisibilité de la matière, c’est-à-dire de l’existence des indivisibles, ou atomes) et dans le temps, où nous défendons une interprétation continuiste et aprioriste selon laquelle le temps cartésien est continu et cette continuité n’est jamais qu’un pour soi.

"Le paradoxe de l’infini cartésien ", Archives de philosophie, 72:3, 2009, p. 1-25.
L’idée de l’infini est, chez Descartes, fort paradoxale : elle est à la fois la plus claire et distincte et la plus incompréhensible que l’on puisse avoir. Le paradoxe atteint même sa positivité, puisque l’in-fini s’énonce négativement. Ce problème a occupé de nombreux contemporains, et aujourd’hui encore certains interprètes y voient une contradiction au plus profond de la pensée cartésienne. Cet article expose le paradoxe de l’infini cartésien, puis montre comment Descartes l’avait déjà résolu et comment la postérité s’en saisira.
English
"La véritable nature de l’indéfini cartésien ", Revue de métaphysique et de morale, 2008-4, p. 501-513.
La distinction que Descartes opère entre infini et indéfini est bien connue et a été abondamment commentée. On se trompe souvent, pourtant, sur la véritable nature de cet indéfini. La plupart des interprètes, du XVIIe siècle à nos jours, le réduisent à un infini en son genre, dont le genre serait l’étendue, qualifié notamment d’infini « en extension », « spatial », « négatif », « potentiel », ou « quantitatif ». Allant à l’encontre d’une telle interprétation, cet article montre que l’indéfini cartésien n’est à proprement parler ni infini, pas même en son genre, ni fini, et que sa véritable nature est l’indétermination.
English
"Descartes. L’infinitude de ma volonté, ou comment Dieu m’a fait à son image", Revue des sciences philosophiques et théologiques, 92:2, 2008, p. 287-312.
Il y a trois manifestations de l’infini chez Descartes : l’infinité de Dieu, l’infinitude de ma volonté et l’indéfinité du monde physique et mathématique. Cet article est consacré à l’infinitude de ma volonté, c’est-à-dire à la contribution de la philosophie pratique à l’idée de l’infini. En trois parties, nous verrons comment l’homme, partant d’une déception du fini, aspire naturellement vers l’infini et que cette volonté d’infini signifie volonté infinie, tellement intime à l’idée de l’infini qu’elle l’est ; comment, ensuite, ma volonté est infinie, notamment parce qu’elle est en porte les signes paradoxaux (positivité et incompréhensibilité) ; comment, enfin, l’infinitude de ma volonté est la marque que Dieu m’a fait à son image, et qu’il est important, par conséquent, de ne pas confondre l’infinité de Dieu et l’infinitude de ma volonté.
English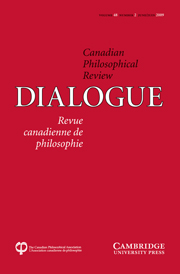
"De la possibilité à l’existence : Kant critique de Leibniz", Dialogue. Revue canadienne de philosophie, 47:2, 2008, 211-234.
Troisième et dernier volet d’une étude consacrée à la possibilité et l’existence chez Leibniz, cet article reconstruit en trois étapes l’évolution kantienne sur ces notions fondamentales, depuis la Nova dilucidatio (1755) jusqu’à la Kritik der reinen Vernunft (1781-7), en passant par le Beweisgrund (1763), afin, d’une part, de mettre en évidence ce que Kant doit directement à Leibniz et, d’autre part, de montrer comment et pourquoi seul le tournant critique a su arracher l’un à l’autre sur le chemin de la possibilité à l’existence, à travers une double rupture, à la fois épistémologique (le rôle de l’expérience) et ontologique (l’éclipse de Dieu).
English
"Argumentation cartésienne : logos, ethos, pathos", Revue philosophique de Louvain, 106:3, 2008, p. 459-494.
Partant de la distinction aristotélicienne entre les trois piliers de l’argumentation, logos, ethos et pathos, nous proposons une analyse de l’argumentation cartésienne, telle qu’elle se dévoile dans l’intégralité de son œuvre et de sa correspondance. Le logos cartésien est fondé sur deux distinctions, logique et dialectique, analyse et synthèse, et par l’insuffisance de la démonstration appelle la persuasion. L’ethos cartésien est socratique : il se dévoile dans une scénographie platonicienne, il consiste notamment en une critique de l’érudition et de nombreux indices rappellent l’attitude de Socrate. Le pathos cartésien révèle un soin à la fois prédiscursif et discursif de l’auditoire, une rhétorique émotionnelle qui vise à toucher les sentiments du lecteur, et un jeu de la polémique qui manie l’art de la flatterie et de l’insulte. La conclusion, qui met en évidence la nature et le rôle de l’argumentation cartésienne vis-à-vis de sa philosophie, pose également la question de la sincérité de l’auteur, avant de livrer quelques suggestions herméneutiques.
English
"La prudence de Descartes face à la question de l’infini en mathématiques", Philosophiques, 34:2, 2007, p. 295-316.
La question de l’infini cartésien est vaste et polymorphe, de la métaphysique à la philosophie des sciences en passant par la philosophie pratique. Mais c’est en mathématiques que l’attitude de l’auteur est la plus ambivalente et paradoxale, car il n’y a pas, chez Descartes, d’infini en mathématiques. Le but de cet article est d’analyser les manifestations et les raisons de cette prudence cartésienne. Pour ce faire, nous procédons en deux temps. D’abord, nous constatons l’absence d’infini en mathématiques à travers l’examen de l’infinitésimal. Ensuite, nous montrons qu’il n’y a, dans les mathématiques cartésiennes, qu’un indéfini, en discutant l’existence et le statut du « plus grand nombre ». Ce parcours dévoilera les deux motifs de la prudence cartésienne : la contrainte métaphysique et la rigueur méthodologique.
English
"L’existence leibnizienne", Archives de philosophie, 70:1, 2007, 249-273.
Deuxième volet d’une étude consacrée à la possibilité et l’existence chez Leibniz, cet article tente de reconstruire la conception leibnizienne de l’existence, notion fondamentale qui soutient toute l’ontologie de l’auteur et qui n’est pourtant ni clairement définie ni systématisée. En trois parties, nous établissons que l’existence leibnizienne est bien un degré de possibilité, un ajout, un complément, mais elle n’ajoute rien de nouveau. Elle n’est pas une perfection, mais une relation comparative de perfections entre elles. Elle n’est pas un prédicat réel, mais un prédicat logique. Elle se définit comme ce qui est distinctement senti, ce qui plaît à un esprit tout en ne déplaisant pas à l’esprit le plus puissant, et ce qui est le plus harmonique. La conception leibnizienne de l’existence a plusieurs couches, et à de nombreux égards préfigure déjà la position kantienne.
English
"Possibilité et existentiabilité chez Leibniz ", Revue philosophique de Louvain, 104:1, 2006, p. 23-45.
On sait que l’ontologie leibnizienne trace, pour ainsi dire, le plus court chemin de la possibilité à l’existence. On mesure moins que cette ligne est parcourue d’étapes dont la première, assurément, est l’existentiabilité des possibles. Cet article examine d’abord la conception leibnizienne de la possibilité, à travers cinq définitions. Il analyse ensuite la nature et le rôle de cette existentiabilité, dans ses rapports à la possibilité d’une part et à l’existence elle-même d’autre part, pour finalement conclure sur l’existentialisme d’un auteur dont on souligne habituellement l’essentialisme. De cette manière, possibilité et existentiabilité permettent de redécouvrir à nouveaux frais tout un pan de la pensée de Leibniz.
English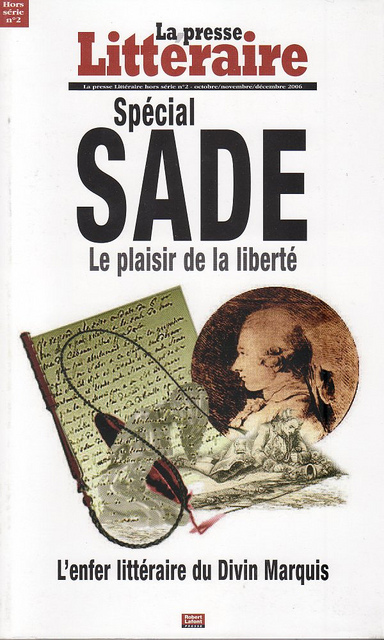
"Sade : l’oeuvre et son contexte", La presse littéraire, Spécial Sade, hors-série 2, octobre-décembre 2006, p. 65-97
Connaître la vie de Sade est une condition sine qua non pour comprendre son œuvre. Avant de dire quoi que ce soit sur lui, avant même d’ouvrir Justine, Juliette ou les Cent vingt journées, lisez deux choses : sa biographie (par Maurice Lever, c’est sans conteste la meilleure) et sa correspondance. Quiconque se lance honnêtement dans cette entreprise comprend très vite que, chez Sade, tout commence avec et par la prison, que tout tourne autour de la pénalité et de la justice.

"Cogito, ergo sum : induction et déduction", Archives de philosophie, 67:1, 2004, p. 51-63
Le « cogito, ergo sum » cartésien apparaît depuis quarante ans comme « inférence et performance » (J. Hintikka). Mais de quelle inférence s’agit-il précisément ? Pour le savoir, cet article poursuit deux objectifs : d’abord, montrer que la question pertinente à laquelle il s’agit de répondre ne concerne pas la relation logique interne qui lie le cogito au sum, et qui est une intuition, mais celle, externe, qui lie le « cogito, ergo sum » tout entier au « quicquid cogitat, est ». Ensuite, montrer que cette dernière relation est tout à la fois une induction et une déduction.
English"Réalité, Vérité et Connaissance. Une alternative à la traditionnelle ‘Justified True Belief’, inspirée de la ‘Wirklichkeit’ du Manuscrit de 1942 de W. Heisenberg", De Philosophia, University of Ottawa, 16:1, 2000, p. 91-112.
De toutes les dichotomies historiques qui divisent la philosophie en différentes traditions protectionnistes, figure en bonne place – et au XXème siècle – celle qui oppose philosophie anglo-saxonne et philosophie continentale. Cet article tente de montrer comment certains des problèmes rencontrés par la traditionnelle épistémologie anglo-saxonne, construite sur la thèse standard qui définit la connaissance comme « Justified True Belief », peuvent être contournés si l’on redéfinit le Fait, la Vérité et, finalement, la Connaissance, à la lumière de la redéfinition de la Réalité opérée par W. Heisenberg dans le Manuscrit de 1942. Les trois parties que sont l’exposé de la thèse standard, sa critique et son alternative, auront ainsi deux enjeux : d’une part, inviter au dialogue entre traditions anglo-saxonne et continentale et, d’autre part, présenter un ouvrage d’Heisenberg relativement méconnu du monde anglo-saxon pour n’avoir pas encore été traduit en anglais.
EnglishHistoire diplomatique (2004-2007)
SYNTHESE
- Articles dans la Revue d’Histoire Ecclésiastique et la Revue historique de droit français et étranger.
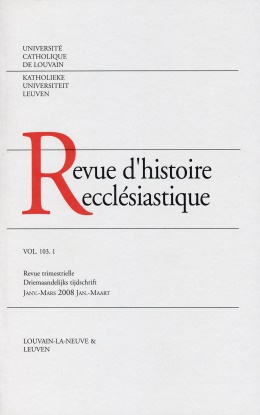
"Commentaire du Concordat de 1801 entre la France et le Saint-Siège", Revue d’Histoire Ecclésiastique, 102:1, 2007, p. 124-154.
Sur un sujet classique et maintes fois discuté, le Concordat de 1801 entre Bonaparte et Pie VII, nous nous livrons ici à l’exercice du commentaire de texte, afin de présenter de manière claire et synthétique les 17 articles qui ont ramené en France la paix religieuse à une époque troublée. En deux parties, nous montrons comment le Concordat est un habile compromis qui satisfait, d’une part, le culte et la République, en reconnaissant que la religion de « la grande majorité des Français » a droit à un culte libre et public dans une République à qui elle doit fidélité tandis que se pose la question de la profession de foi personnelle du souverain et, d’autre part, les personnes et les biens, en renouvelant l’épiscopat et le régime de la propriété ecclésiastique, par une nouvelle circonscription des diocèses, des démissions et des nominations massives, et en convaincant Rome de renoncer aux biens ecclésiastiques aliénés contre la fonctionnarisation du clergé.
English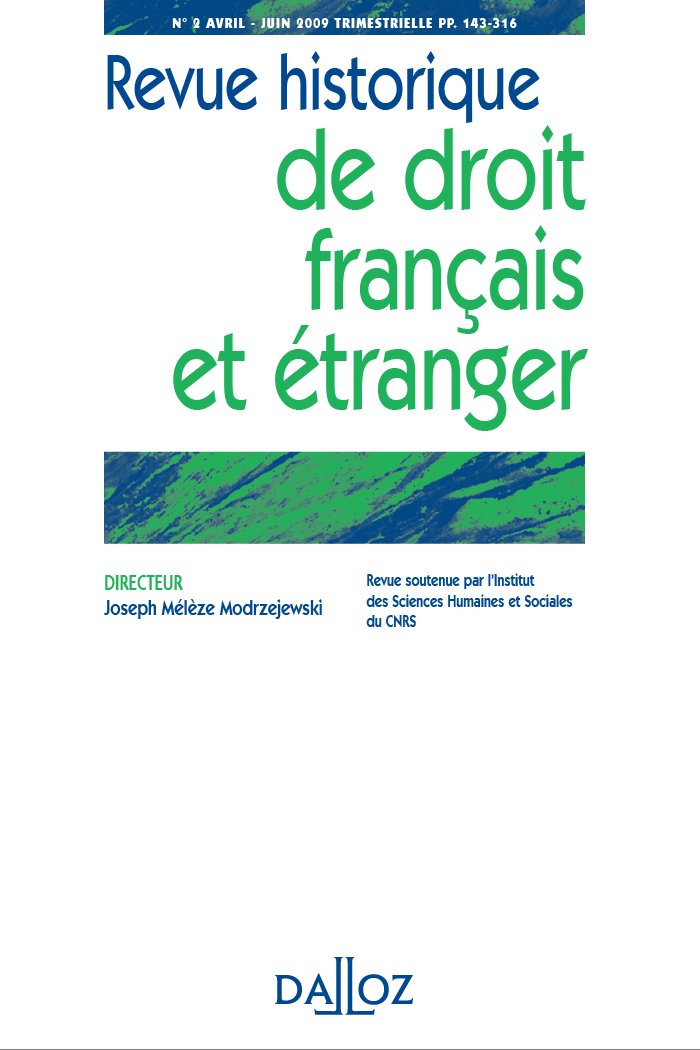
"Lamartine et Pie IX : la France face à la question nationale italienne en 1846-1849", Revue historique de droit français et étranger, 84:1, 2006, 71-85.
L’élection de Pie IX, en juin 1846, est une occasion donnée à l’Italie d’évaluer la solution néo-guelfe de l’unité sous l’égide du Saint-Siège, et la question nationale italienne qui agite alors la péninsule ne laisse pas la France indifférente. De l’autre côté des Alpes, Alphonse de Lamartine, attentif depuis toujours à tout ce qui touche l’Italie et la religion, acteur de la révolution de 1848, comprend aussitôt l’importance des événements italiens pour l’équilibre européen. Il prend position contre le néo-guelfisme et jouera, pendant deux ans, un rôle déterminant dans les relations franco-italiennes. Après avoir présenté la situation de l’Italie de 1846 à 1848 à travers le prisme de Pie IX, du mythe du « pape libéral » à celui de « pape traître », nous analysons les positions respectives de Lamartine et de la diplomatie française sur les affaires d’Italie. D’abord, Lamartine s’oppose à la politique étrangère de Guizot. Ensuite, pendant trois mois au pouvoir en 1848, il soutient la révolution italienne et dresse son « armée des Alpes ». Et, l’année suivante, il défend plus que jamais la République romaine et s’oppose au rétablissement du pouvoir temporel de la papauté.

"Lamartine : les deux vices du gouvernement temporel de la papauté dans l’article du 28 octobre 1847", Revue d’Histoire Ecclésiastique, 99:3-4, 2004, p. 627-657.
En juin 1846, dans l’Italie divisée du Congrès de Vienne, l’élection de Pie IX donne au néo-guelfisme une occasion de poser à nouveaux frais la question de l’unité italienne. Le 28 octobre 1847, à la veille des révolutions romaine et parisienne, Alphonse de Lamartine, qui entretient avec la religion des rapports complexes et ambivalents, rejette alors la solution néo-guelfe et se justifie par une longue et intense critique du pouvoir temporel de la papauté. A travers l’analyse détaillée de la critique lamartinienne, et dans le cadre de l’histoire de la curie romaine depuis la victoire française en Italie jusqu’à l’avènement de Pie IX (1796-1846), nous examinons ce que Lamartine présente comme les deux vices du gouvernement pontifical : sa complexité et son instabilité, c’est-à-dire, en somme, les questions de sa nature et de la continuité de son pouvoir.
English DeutschDivers

"Pourquoi la philosophie s’intéresse-t-elle aux séries télévisées ?", La Cité. Journal bimensuel (Suisse), 20, 22 juin - 6 juillet 2012, p. 17.
C’est en mettant ce contexte en évidence, en montrant ce que la série dit de nous, de la société dans laquelle on vit, des dilemmes auxquels nous sommes confrontés, que l’analyse philosophique et, plus largement, des sciences humaines, peut être utile.

"Savoir s’en servir", in A Quoi sert le savoir ?, Paris, PUF, 2011, p. 171-173.
Se demander à quoi sert le savoir présuppose déjà qu’il doit servir à quelque chose. On n’imagine pas répondre « à rien », mais on est bien incapable de dire « à quoi », car la réponse est tout simplement « cela dépend ».
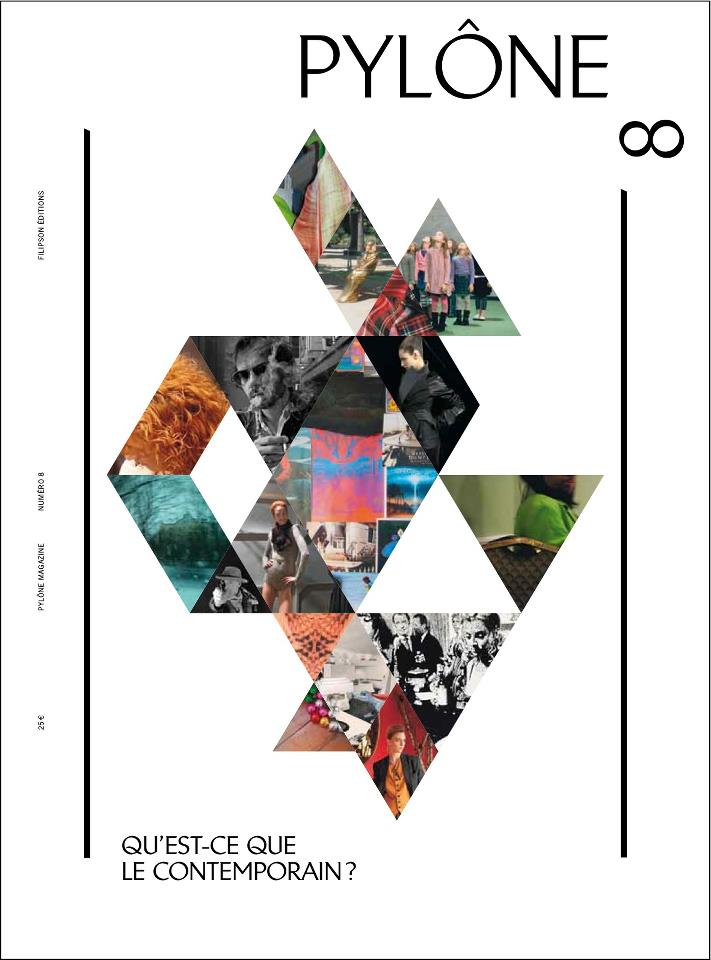
"Le contemporain n’existe pas", Pylône. Revue de philosophie, d’art et de littérature, 8, automne 2011, p. 120-121.
Le contemporain est ce qui est du même temps, et la question est de savoir de quoi : d’un objet quelconque ou de l’énonciateur lui-même. La contemporanéité est la simultanéité d’existence, soit de deux choses entre elles, soit de la chose dont on parle et de l’expérience de celui qui parle.


