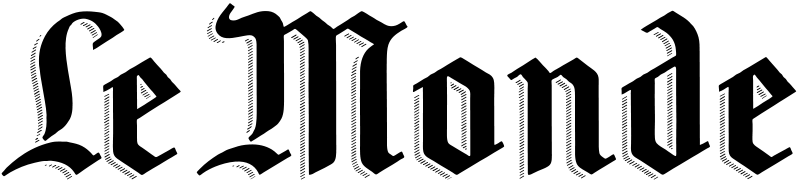
En demandant que la France fasse "pour Houla et Homs, ce qu’elle a fait pour Benghazi et Misrata" (Le Monde du 29 mai), Bernard-Henri Lévy se fait l’écho d’une critique répandue, celle du "deux poids, deux mesures", qu’on appelle aussi le problème de la sélectivité. Pourquoi intervenir ici et pas là, quand les exactions sont similaires ? Y aurait-il donc de bonnes et de mauvaises victimes ? Non. Mais il y a de bonnes et de mauvaises opportunités d’intervenir : celles qui permettraient de secourir, et d’autres qui sacrifieraient trop. La sélectivité s’explique et même se justifie. Elle s’explique en premier lieu parce que les Etats n’interviennent que là où ils ont un intérêt à le faire. C’est-à-dire que l’intervention n’est jamais purement humanitaire : ses motivations sont toujours plurielles. Tant que les Etats auront des intérêts, les interventions seront sélectives.
En russe : http://www.inosmi.ru/asia/20120608/...
En demandant que la France fasse "pour Houla et Homs, ce qu’elle a fait pour Benghazi et Misrata" (Le Monde du 29 mai), Bernard-Henri Lévy se fait l’écho d’une critique répandue, celle du "deux poids, deux mesures", qu’on appelle aussi le problème de la sélectivité. Pourquoi intervenir ici et pas là, quand les exactions sont similaires ? Y aurait-il donc de bonnes et de mauvaises victimes ? Non. Mais il y a de bonnes et de mauvaises opportunités d’intervenir : celles qui permettraient de secourir, et d’autres qui sacrifieraient trop. La sélectivité s’explique et même se justifie. Elle s’explique en premier lieu parce que les Etats n’interviennent que là où ils ont un intérêt à le faire. C’est-à-dire que l’intervention n’est jamais purement humanitaire : ses motivations sont toujours plurielles. Tant que les Etats auront des intérêts, les interventions seront sélectives.
La sélectivité s’explique aussi par la couverture médiatique - les crises sont plus ou moins télégéniques, suscitant une influence variable sur la politique étrangère (c’est ce qu’on a appelé l’"effet CNN") - et par l’absence de consensus : exiger que l’intervention ait lieu dans tous les cas où elle est justifiée, c’est oublier qu’il n’existe pas de critères universellement acceptés de ce qu’est une intervention justifiée. Voilà donc pourquoi la sélectivité est un phénomène normal et inévitable.
Pourquoi, maintenant, peut-on même soutenir qu’elle est souhaitable ? Car la critique du "deux poids, deux mesures" présuppose une sorte de principe de cohérence - il faudrait intervenir soit partout, soit nulle part -, ce qui est à la fois immoral et dangereux. Immoral, car il commanderait de laisser mourir certaines victimes, au motif qu’on ne peut pas les sauver toutes. Dangereux car, à le suivre, il aurait fallu faire la guerre à la Russie pour la Tchétchénie et à la Chine pour le Tibet. C’est donc que la légitimité d’une intervention ne dépend pas seulement de sa cause (un massacre en cours ou imminent), mais aussi de ses conséquences probables. L’intervention doit sauver davantage qu’elle ne tue.
Or, si l’on compare la Syrie à la Libye, que constate-t-on ? Que ces deux contextes sont assez différents pour exiger un traitement différentiel. En Libye, l’opposition était forte et contrôlait une partie du territoire, l’armée régulière était faible et le risque d’embrasement régional quasi nul. En Syrie, c’est le contraire : l’opposition est courageuse mais faible et, à moins de prendre Alep, elle ne contrôle pas une partie du territoire qui lui permettrait de se ravitailler ; l’armée régulière, équipée par les Russes, est forte et la situation du pays, au coeur d’une poudrière géopolitique, rend le risque d’embrasement régional très élevé. Si nous n’intervenons pas en Syrie comme nous l’avons fait en Libye, ce n’est pas seulement pour des raisons légalistes (absence d’autorisation du Conseil de sécurité), mais surtout pour ces raisons prudentielles.
Que faire alors ? Entre la guerre ouverte et l’inaction coupable, il y a plusieurs options. Laurent Fabius, ministre des affaires étrangères, a bien identifié les priorités. Premièrement, durcir les sanctions. Le renvoi simultané des ambassadeurs syriens dans une douzaine de démocraties occidentales est symbolique, mais va dans le bon sens. Etendre le gel des avoirs peut aussi contribuer à affaiblir l’exécutif. Il faut également saisir la Cour pénale internationale - sans toutefois avoir la naïveté de croire qu’un éventuel mandat d’arrêt suffira à dissuader Bachar Al-Assad.
Deuxièmement : travailler avec la Russie, qui est la clé d’une solution. Si Bachar Al-Assad se sent suffisamment fort pour massacrer en présence des observateurs onusiens, et même de Kofi Annan, c’est parce qu’il est soutenu par Vladimir Poutine. Convaincre la Russie de ne plus le faire est possible : tout dépend de ce que nous sommes prêts à céder en échange. Les Etats-Unis en ont les moyens en faisant des concessions sur la défense antimissile européenne.
Troisièmement, il faut soutenir l’opposition, y compris en la formant et en l’armant clandestinement. Certains, comme le Qatar, le font déjà. On oppose généralement plusieurs arguments à cette proposition. Cela ferait glisser le pays "dans la guerre civile" craint Laurent Fabius. Mais n’est-ce pas déjà le cas ? La Syrie est en état de guerre civile, et le départ de Bachar Al-Assad est inéluctable. La seule question est de savoir quand et à quel prix.
On objecte aussi que l’on ignore tout de cette opposition. Il faut en effet mieux la connaître - c’est le travail du renseignement - et surtout la rassembler. Et qu’une fois Assad tombé, ce qui le remplacera ne sera pas forcément mieux. C’est vrai, mais toute chute d’un régime dictatorial donne lieu à une période d’incertitude politique. Surtout, le peuple aura pris conscience qu’il peut renverser son tyran : s’il n’est pas satisfait par ce qui lui succède, il saura qu’il peut le renverser à nouveau. C’est la pression de la place Tahrir qui pèse toujours sur les militaires égyptiens, par exemple.
Ce qui distingue cette approche de l’appel de Bernard-Henri Lévy relève de la philosophie. En défendant un principe abstrait sans se soucier des conséquences, il s’inscrit dans ce que le sociologue allemand Max Weber [1864-1920] appelait l’éthique de la conviction, qui défend une croyance de façon doctrinale sans se soucier des conséquences, et donne la priorité aux intentions sur les résultats. Je défends au contraire une éthique de la responsabilité, qui tient compte des conséquences dans l’évaluation morale et donne la priorité aux résultats sur les intentions.
Cette différence en est aussi une en théorie des relations internationales. En s’appuyant sur la "responsabilité de protéger", qui serait "dans les obligations des Nations unies", et sur les devoirs de la communauté internationale, Bernard-Henri Lévy s’inscrit dans le libéralisme, dont le risque est d’être naïf. La responsabilité de protéger n’est pas une obligation juridique, mais un appel moral et politique que chacun interprète à l’aune de ses propres intérêts.
Et la communauté internationale comme les Nations unies désignent davantage des objectifs louables (former une communauté, être unis) que des réalités. En étant sceptique à cet égard, je m’inscris dans le réalisme, dont le risque est d’être cynique. Le but est alors de trouver l’équilibre entre les deux : défendre des objectifs moraux, mais le faire en gardant les pieds sur terre.


