Jusqu’où aller dans nos relations avec les dictatures ?
Le Monde, 23 février 2010
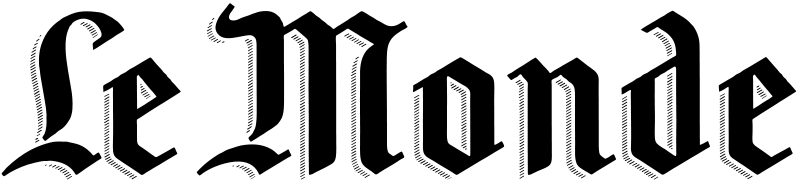
La récente visite officielle du président turkmène à Paris, reçu à l’Élysée le 1er février 2010, a soulevé une question récurrente mais à laquelle personne, finalement, ne répond : dans quelle mesure la France doit-elle avoir des relations avec des dictatures ? La France, c’est-à-dire à la fois l’État français, dans ses relations diplomatiques, économiques, culturelles ; le peuple français, qui se trouve, par le biais de la démocratie, engagé dans ces relations ; et les entreprises françaises : dans quelle mesure doivent-elles travailler dans ces pays, signer des contrats avec des régimes autoritaires, dont on sait qu’ils violent quotidiennement les droits de l’homme les plus fondamentaux ?
Les exemples ne manquent pas, qui suscitent régulièrement ces interrogations, de la présence de Total en Birmanie aux Jeux olympiques en Chine, en passant par la visite de Kadhafi à Paris ou la vente d’un navire de guerre à la Russie. Bien sûr, chaque cas est différent, et il faut commencer par distinguer entre des pays qui sont sous embargo et d’autres qui ne le sont pas, mais la question reste la même.
Deux réponses simplistes et opposées sont populaires. La première, idéaliste, s’indigne que la France-patrie-des-droits-de-l’homme puisse même parler à "ces gens-là", et préconise l’absence totale de relations. La seconde, cynique, rappelle laconiquement que "business is business" et qu’il faut laisser la morale à la porte des intérêts. Ces deux pôles étalonnent pour ainsi dire un débat qui d’ailleurs n’existe pas.
Pourquoi écarter, premièrement, la réponse idéaliste ? Pourquoi la solution ne serait-elle pas de n’avoir pas de relations avec les dictatures ? D’abord, parce que cela renforcerait leur isolement, qui leur permet d’agir en toute impunité. Les liens sont des leviers : les supprimer nous permettrait sans doute de prétendre n’avoir "rien à voir" avec les exactions commises dans ces pays, mais ces exactions seraient pires, car elles ne seraient limitées par aucune contrainte externe, et nous perdrions du même coup tout moyen de pression. Ensuite, parce que, quoi qu’on dise du rôle parfois contestable des entreprises étrangères, elles contribuent au développement du pays et, dans certains cas, elles ont un impact non négligeable sur l’emploi et la qualité de vie des habitants. Leur présence peut également faciliter l’accès à l’éducation, réduire l’opacité financière – car l’État hôte est contraint de donner des informations aux entrepreneurs – et créer de la polémique, qui permet de faire connaître les problèmes.
La réponse idéaliste qui consiste à dire que l’on devrait cesser d’avoir des liens avec les dictatures est le fait d’une bonne intention, mais elle a des effets pervers. Elle reste pourtant populaire – l’indignation trouve toujours un écho dans la bonne conscience de la population – donc utilisée par la communication politique. Il faut ici rappeler que Nicolas Sarkozy, alors candidat à la présidentielle, déclarait au congrès de l’UMP du 14 janvier 2007 : "Je ne crois pas à la "realpolitik" qui fait renoncer à ses valeurs sans gagner des contrats. (…) Le silence est complice. Je ne veux être le complice d’aucune dictature à travers le monde". Trois ans plus tard exactement, il recevait à l’Élysée le président turkmène, dans un silence assourdissant.
Pourquoi écarter, deuxièmement, la réponse cynique ? Pourquoi ne pas laisser la morale aux philosophes et faire affaire là où il y a des affaires à faire, quel que soit le type de régime dont il s’agit ? Pour au moins deux raisons. D’une part, parce que la tendance est à la moralisation des relations internationales. Les États occidentaux, dans leurs décisions, doivent de plus en plus prendre en compte le poids croissant des opinions domestiques et des acteurs non étatiques. Ils veillent donc à justifier moralement leurs politiques, et développent une rhétorique de promotion de la démocratie et de protection des droits de l’homme qui correspond non seulement à leurs valeurs, mais aussi voire surtout à leurs intérêts, c’est-à-dire à l’image qu’ils souhaitent donner d’eux. Peu importe d’ailleurs que cet usage soit instrumental ou hypocrite car le résultat est le même : la morale compte.
D’autre part, parce que l’abandon de la morale ne nuirait pas qu’à l’État : ce serait aussi mauvais pour les affaires. En dépit de leur apparence de stabilité, les dictatures sont des États fragiles, souvent opaques et très corrompus, dans lesquels les décisions sont arbitraires puisqu’elles dépendent de l’humeur et des caprices d’un ou de plusieurs hommes. Ces conditions ne sont guère propices aux affaires. De ce point de vue, promouvoir la démocratie et le respect des droits de l’homme revient, à terme, à améliorer les conditions dans lesquelles on travaille.
La réponse cynique qui prétend qu’on peut se laisser guider par le seul intérêt dans les affaires sans se soucier de la morale n’est donc pas plus réaliste que la précédente. En renvoyant dos à dos ces deux positions, on montre d’ailleurs que, contrairement à une idée fort répandue, en relations internationales réalisme et morale ne s’opposent pas mais sont interdépendants. La morale a besoin du réalisme pour dépasser le stade de la seule élucubration, c’est-à-dire pour que les solutions qu’elle envisage puissent exister sans devenir des désillusions. Inversement, le réalisme a besoin de la morale, exactement pour les mêmes raisons, c’est-à-dire pour être réaliste dans un monde où l’image morale compte.
Dans quelle mesure, donc, la France doit-elle avoir des relations avec des dictatures ? Dans la mesure où cela peut contribuer à la fois à ses intérêts et à ceux de la population des États en question. La borne est fixée là où les conséquences de la coopération entre l’État ou une entreprise française et le régime autoritaire sont néfastes pour la population, c’est-à-dire participent à l’oppression au lieu de la soulager.
Il faut savoir également dans quelle mesure l’entreprise peut être contrainte de participer à la propagande, et il faut alors distinguer entre celles qui le font pour plaire et rentrer sur le marché, comme Public System qui organise les célébrations du quarantième anniversaire de la prise de pouvoir de Kadhafi, mobilisant plusieurs centaines de danseurs et figurants français dans un spectacle pharaonique à la gloire du "guide", et celles qui le font pour maintenir leur présence, parce que le dictateur en fait une condition. On a reproché à Bouygues au Turkménistan, par exemple, d’avoir traduit le second volume du Roukhnama, le livre "sacré" du président. Mais cela s’est fait à la demande des autorités, à un moment où la société n’avait pas remporté de contrats depuis deux ans, et cette décision a été vécue comme une nécessité pour rester dans le jeu.
On pourrait invoquer une règle générale : nous pouvons avoir des relations avec les dictatures dans la mesure où cela ne nuit pas à la population locale, nous pouvons poursuivre nos intérêts dans la mesure où ils ne contredisent pas ceux des habitants, nous devons même le faire lorsque cette présence les soulage, et nous devons ne pas le faire lorsque, au contraire, elle renforce l’oppression dont ils sont les victimes.
Mais la ligne de démarcation est floue, il est possible que la coopération à la fois soulage la population et renforce la dictature – c’est d’ailleurs ce qui se passe dans la plupart des cas – et tout dépend alors d’un calcul imprécis des conséquences probables, et de la temporalité dont on parle puisqu’une présence ou un lien qui soulage à court terme peut avoir l’effet pervers de renforcer l’oppression à long terme. Il n’y a donc pas de solution générale à ce qui n’est jamais qu’une suite de cas particuliers. Et c’est tout le défi de la politique que d’y trouver, à chaque fois, une réponse juste.


