La vaine rhétorique de la défense "philosophique" de la corrida
L’Archicube. Revue de l’Association des anciens élèves et amis de l’École normale supérieure, 10, mai 2011, p. 209-213.
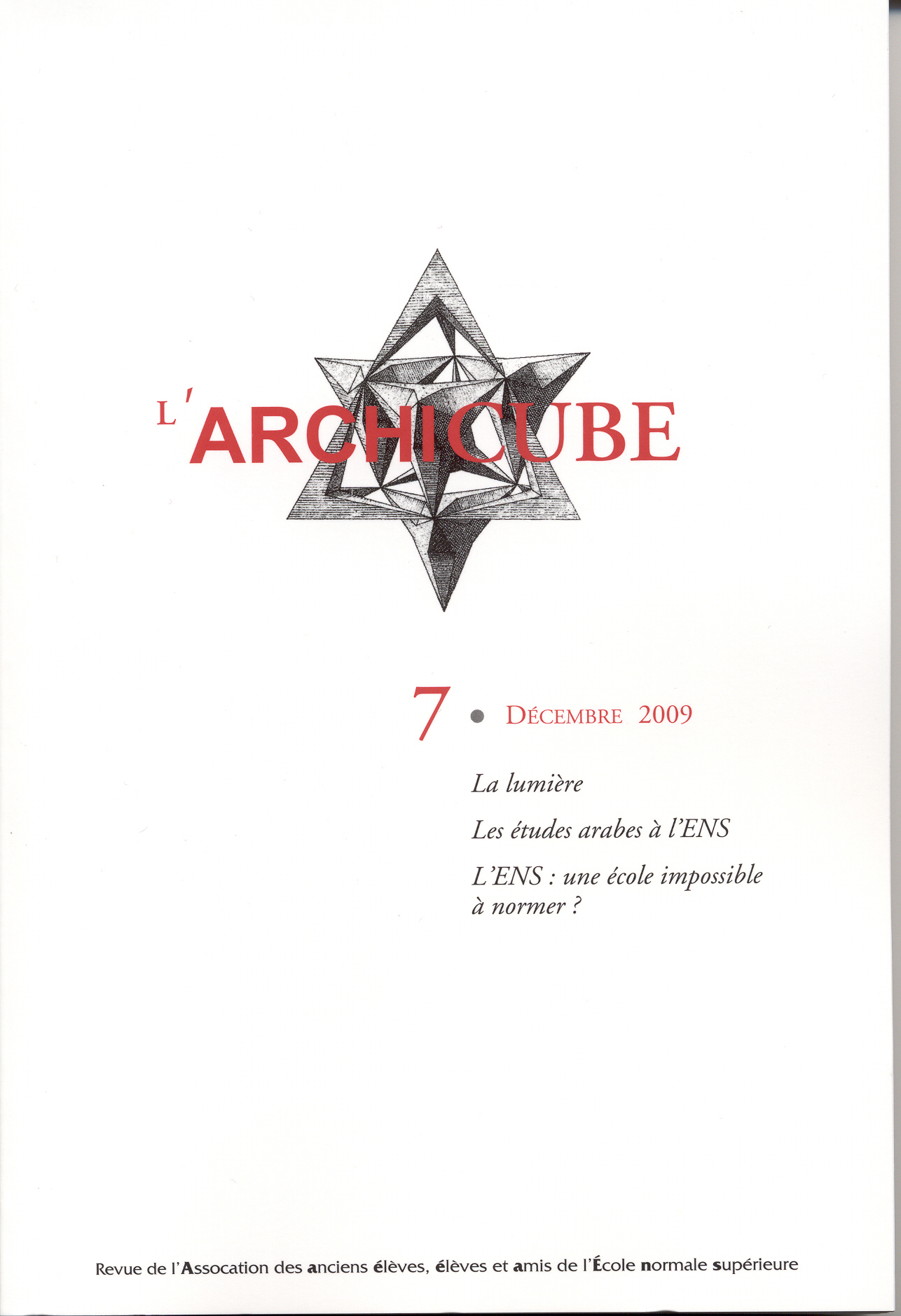
Il est tout à fait légitime que L’Archicube publie un article de Francis Wolff sur la corrida, en particulier sur la question de savoir si elle peut être considérée comme un sport. Il y a assurément des choses passionnantes à dire sur la corrida, lorsqu’on l’observe en ethnologue. Ce qui est moins légitime, en revanche, est cette manière (d’autant plus difficile à détecter qu’elle est subtile) de glisser du descriptif au normatif. De sous-entendre que, parce que la corrida est intéressante, alors elle est défendable.
Réponse à l’article de Francis Wolff, "Des tauromachies sportives à la corrida rituelle", L’Archicube, 6, juin 2009, p. 85-93.
Il est tout à fait légitime que L’Archicube publie un article de Francis Wolff sur la corrida, en particulier sur la question de savoir si elle peut être considérée comme un sport. L’auteur est compétent, l’article est intéressant. Il faudrait être de mauvaise foi pour dire que la corrida n’a pas de riches enjeux anthropologiques qui ne méritent pas d’être analysés. Il y a assurément des choses passionnantes à dire sur la corrida, lorsqu’on l’observe en ethnologue. Wolff est en outre équilibré sur la qualification de sport, donnant autant de raisons de considérer que la corrida est un sport que le contraire, et cette prudence est appréciable.
Ce qui est moins légitime, en revanche, est cette manière (d’autant plus difficile à détecter qu’elle est subtile) de glisser du descriptif au normatif. De sous-entendre que, parce que la corrida est intéressante, alors elle est défendable. Tous les auteurs qui développent le premier point ne glissent pas vers le second mais, chez Wolff, il est difficile de penser que son article a un autre objectif, ne serait-ce que parce que les arguments qui y sont développés sont textuellement repris dans son petit livre 50 raisons de défendre la corrida. Wolff, en effet, n’est pas un ethnologue ayant l’ambition d’analyser de manière neutre une pratique. Il est un afficionado, un militant pro-corrida intervenant régulièrement dans les médias pour en faire l’apologie. C’est son droit le plus strict, mais c’est aussi le droit des lecteurs de L’Archicube de le savoir et de pouvoir lire, sur un sujet aussi polémique, qui divise autant la population, un autre point de vue.
Francis Wolff et moi avons déjà eu l’occasion d’en débattre dans les médias. Je ne reviendrai pas ici sur un certain nombre d’arguments que j’ai identifiés ailleurs comme des « sophismes » [1]. Je donnerai plutôt quelques exemples de problèmes plus subtils, qui sont propres à toute défense « philosophique » de la corrida.
Premièrement, il y a celui qui consiste à glisser du descriptif au normatif, du fait que la corrida soit intéressante à certains égards, à celui qu’elle doive par conséquent continuer d’exister. Je ne conteste pas que la corrida soit intéressante et j’ai moi-même éprouvé de l’intérêt à lire l’article de Wolff. Mais cela ne suffit pas à la rendre légitime, et ceux qui la défendent le savent bien puisqu’ils condamneraient sans doute, comme la plupart des gens, un grand nombre d’autres pratiques traditionnelles, tout aussi « identitaires » pour certains peuples et tout aussi « intéressantes » pour l’analyse anthropologique. On peut notamment penser aux combats de chiens, ou à ce qu’on fait subir à certains animaux en raison des croyances véhiculées par la médecine traditionnelle chinoise et, dans le référentiel humain, aux mutilations génitales féminines ou à la torture en général – qui elle aussi inspire l’art depuis des siècles. Le fait qu’une pratique soit importante pour un peuple ou qu’elle ait « inspiré artistes et poètes », comme le dit Wolff au sujet de la corrida, n’implique strictement rien quant à sa légitimité. Les artistes et les poètes ont la liberté de s’inspirer de tout, même du pire.
Deuxièmement, il y a la question de l’universalité. La corrida souffre de localisme : limitée à la péninsule ibérique, au sud de la France et à une partie de l’Amérique latine, le reste du monde n’y comprend rien. Les aficionados tentent donc de montrer qu’à défaut d’être géographiquement universelle, elle l’est culturellement. On veut gommer l’aspect « fête de village » et le remplacer par un discours pompeux sur l’homme et l’animal, la culture et la nature.
Wolff a donc recours à une liste « impressionnante de ceux pour qui elle a constitué une source essentielle » : 24 noms, de personnalités toutes disparues, « pour ne rien dire des vivants ». Le but de la manœuvre est de montrer que la corrida a su « s’imposer et conquérir sinon le monde du moins les plus grands esprits ». Y aurait-il donc là une preuve d’universalité ? Absolument pas, pour au moins deux raisons. D’une part, parce que les personnes citées sont quasi toutes issues du même référentiel culturel occidental, ancré dans les traditions chrétienne et humaniste, dont l’anthropocentrisme et le rapport très hiérarchisé au monde animal est loin d’être partagé par toutes les cultures. Si des milliards de musulmans, de bouddhistes, d’hindouistes, d’Africains, d’Asiatiques, d’Océaniens, ne comprennent rien à la corrida, c’est qu’elle n’a aucun titre à présenter à l’universalité – à moins bien sûr d’adopter un point de vue néo-colonialiste et de charger l’occident d’une mission civilisatrice.
D’autre part, au sein même du référentiel occidental, Wolff « oublie » de citer tous ces autres grands esprits qui, à la même époque et aujourd’hui, militent contre la corrida. De George Clemenceau à Théodore Monod, en passant par Mark Twain et Georges Courteline, on pourrait trouver bien davantage que 24 personnalités s’y opposant. La corrida est polémique depuis son origine : il y a toujours eu quelques personnes pour la défendre et quelques autres pour réclamer son abolition. Il ne sert donc à rien de dresser des listes de noms.
Si par ailleurs on s’intéresse à l’ensemble de la population, et pas seulement aux « plus grands esprits », on trouvera que ceux qui défendent la corrida sont bien minoritaires, non seulement à l’échelle nationale, où 66% des Français sont favorables à son abolition (sondage Ifop, mai 2010), mais même dans les départements où Wolff affirme qu’elle est « inséparable d’une identité régionale » : 71% des habitants du Gard, par exemple, ne sont pas de cet avis puisqu’ils déclarent n’être pas attachés à la corrida (Ipsos, juillet 2010). Dire qu’une pratique aussi polémique et minoritaire est universelle relève purement et simplement de la falsification.
Troisièmement, il y a cette prétention d’instruire le taureau : « Comme le dressage, explique Wolff, elle humanise la bête, mais elle met à mort l’animal aussitôt qu’instruit ». Voilà une affirmation à l’emporte-pièce qui n’a strictement aucun sens mais donne une apparence de profondeur. Car il faudrait l’expliquer – ce que l’auteur ne fait pas – et répondre aux questions suivantes : d’une part, à quoi éduque-t-on exactement ? Qu’apprend-on au taureau ? On parle d’une bête instruite, sans jamais préciser de quoi. Je demande de quoi on instruit la bête en lui plantant des lames dans le corps. D’autre part, en admettant qu’il y ait instruction de quelque chose, à quoi cela sert-il d’instruire pour tuer ?
Quatrièmement, Wolff dénonce les conditions de vie des animaux d’élevage en batterie et il a bien raison. Mais il a tort d’en déduire que, parce que le taureau de combat jouit, lui, d’une bonne qualité de vie, alors cela légitime ou excuse cette manière de le tuer qu’on appelle corrida. Car il n’y a pas de lien logique entre ces deux propositions, et une simple comparaison suffit à le montrer. Prenons un chat, par exemple. Peut-on justifier le fait de lui mettre un pétard dans la gueule un 14 juillet (n’est-ce pas « la gratuité du jeu, la légèreté du divertissement » dont parle Wolff ?) par le fait qu’il a été particulièrement bien soigné durant sa vie ? Peut-on élever un chat dans des conditions idéales pour le tuer de cette manière – ou de n’importe quelle autre manière qui n’est pas justifiée par le « besoin vital » dont parle Wolff lorsqu’il évoque la nécessité pour l’homme de tuer des animaux, et qui en outre ne cherche pas à minimiser sa souffrance ?
Qu’on ne réponde pas que le taureau, contrairement au chat, est une espèce destinée à l’alimentation. Car, d’une part, ce serait une fois de plus occidentalo-centré : certains asiatiques mangent des chats (et des chiens) – et ils les battent même à mort parce qu’ils sont convaincus que cela rend leur viande plus tendre. Les aficionados justifient-ils cette pratique dans le cas d’un chat qui, avant d’être massacré à coups de bâton sur un marché chinois, a eu une vie la plus heureuse possible ? Probablement pas. D’autre part, il est trompeur de comparer le sort des taureaux de combats à celui des bovins de l’élevage industriel, comme si les deux étaient destinés à ce « besoin vital » qu’est l’alimentation et que la seule différence était que le premier a joui d’une bien meilleure vie. Car on ne tue pas le taureau de combat pour le manger, on le mange parce qu’on le tue pour une autre raison, qui relève davantage de « la gratuité du jeu, la légèreté du divertissement » que du « besoin vital ».
Cinquièmement, il est également faux de dire, comme le fait Wolff, que le taureau de combat « est tout le contraire d’une chose que l’on peut traiter à sa guise ». Faux et contradictoire, puisqu’il explique plus tôt que l’issue du combat est déterminée (il n’y a pas d’incertitude, c’est l’une des raisons pour lesquelles on ne peut pas parler de sport). Et elle est voulue par l’homme : elle n’est pas déterminée par une loi de la nature, mais par la volonté humaine. Or, une pratique dans laquelle la mort d’un animal est à la fois déterminée (ce qui n’est pas le cas de la chasse, par exemple) et voulue par l’homme est par définition une pratique dans laquelle l’homme peut traiter l’animal à sa guise.
Ce que montrent ces quelques exemples est que la défense « philosophique » de la corrida n’est en réalité qu’un vernis dont le but est de donner une apparence de légitimité à une pratique injustifiable. Ce vernis ne résiste pas à l’ongle qui le gratte. Il faut gratter ces affirmations grandiloquentes, comme celle selon laquelle l’homme doit tuer des taureaux dans une arène pour « donner un sens à propre vie », la « reconquérir » et lui donner « un sens véritablement humain ». 99,99% des humains n’éprouvent pas le besoin de planter des lames dans le corps d’un être vivant sensible pour donner un sens à leur vie. Et c’est plutôt rassurant.
[1] Voir « Les sophismes de la corrida » et « Descartes, la corrida et l’animal-machine », Libération, 31 août 2010, p. 18 et 18 octobre 2010, p. 26.


