Les sophismes de la corrida
Revue semestrielle de droit animalier, 2, 2009, p. 119-124.
PDF Riassunto
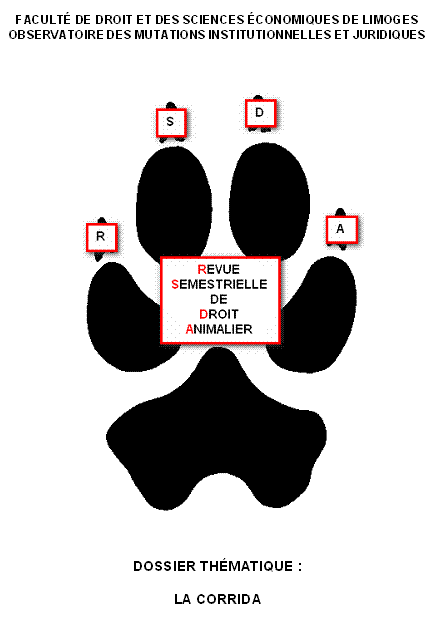
Cette aberration est fondée sur l’appel à la tradition, qui est un sophisme connu depuis 2000 ans sous le nom d’argumentum ad antiquitam. L’excision est également un rite millénaire, une pratique culturelle, une tradition profondément ancrée. Pourtant, le même législateur l’interdit et fustige ce relativisme culturel, qu’il invoque au contraire quand il s’agit de protéger le « patrimoine » national, dans le cas de la corrida comme dans celui du foie gras. Ce n’est pas parce que l’on fait quelque chose depuis longtemps au même endroit que l’on a raison de le faire. Tous les progrès sociaux ont eu lieu contre les traditions, de l’abolition de l’esclavage au droit de vote des femmes. La tradition en elle-même explique mais ne justifie rien.
Tout est dit dans la loi. La corrida est en France une exception juridique, une exception à l’interdiction de pratiquer des « sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux » (art. 521 du Code pénal). Elle est donc, de fait, reconnue par le législateur lui-même comme un sévice grave ou un acte de cruauté, mais qui, à la différence des autres, n’est pas puni. Pourquoi cette impunité ? Parce qu’elle a lieu là où « une tradition locale ininterrompue peut être invoquée ». Voilà donc une pratique punie à Brest, au nom de la sensibilité de l’animal, mais permise à Nîmes, malgré la sensibilité de l’animal.
Cette aberration est fondée sur l’appel à la tradition, qui est un sophisme connu depuis 2000 ans sous le nom d’argumentum ad antiquitam. L’excision est également un rite millénaire, une pratique culturelle, une tradition profondément ancrée. Pourtant, le même législateur l’interdit et fustige ce relativisme culturel, qu’il invoque au contraire quand il s’agit de protéger le « patrimoine » national, dans le cas de la corrida comme dans celui du foie gras. Ce n’est pas parce que l’on fait quelque chose depuis longtemps au même endroit que l’on a raison de le faire. Tous les progrès sociaux ont eu lieu contre les traditions, de l’abolition de l’esclavage au droit de vote des femmes. La tradition en elle-même explique mais ne justifie rien.
Justement, dira-t-on, n’avez-vous pas mieux à faire qu’à vous occuper des taureaux ? Francis Wolff conseille aux militants de la cause animale de se saisir « de la Tchétchénie, de l’Irak, du Darfour », « des enfants qui crèvent de faim ou meurent sous les bombes » [1]. C’est encore un raisonnement fallacieux, connu sous le nom de « sophisme du pire ». Il consiste à dire que X n’est pas un problème puisqu’il y a pire que X, et que l’on devrait donc concentrer toute son énergie sur ce pire que X. Non seulement ceux qui professent ce genre de conseil seraient bien en mal de l’appliquer eux-mêmes – consacrent-ils tout leur temps à la résolution de ce qu’il y a de pire sur terre ? – mais ils présupposent une contradiction qui dans les faits n’existe pas. S’occuper du bien-être des taureaux empêche-t-il de prendre soin des hommes ? En réalité, ce sont souvent ceux qui citent les enfants du tiers-monde comme un prétexte pour ne pas se soucier des animaux qui ne font strictement rien ni pour les uns ni pour les autres, alors qu’une grande partie de ceux qui se soucient du bien-être des animaux militent également contre la misère humaine, parce que l’humanitarisme intelligent passe la frontière des espèces [2].
Pourtant, insiste-t-on, les matadors, les toréadors et les aficionados sont des gens comme vous et moi, qui ne sont pas « moins sensibles à la souffrance que les autres » [3]. Ils éprouvent à l’égard du taureau un respect profond, et sa souffrance, hors de l’arène, notamment dans les couloirs de l’abattoir, leur est insupportable. J’en ai rencontré certains, dont je ne doute pas de la sincérité. Le problème n’est pas là. Il est dans le passage du jugement selon lequel ces personnes sont bien intentionnées à celui selon lequel la pratique qu’elles défendent ne peut pas être mauvaise – puisqu’elles sont bien intentionnées. C’est un « sophisme de la bonne intention ». Que le but de la corrida ne soit pas de faire souffrir n’implique aucunement qu’elle ne fasse pas souffrir. La moralité d’une action ne se juge pas à l’aune des intentions des acteurs. De bonnes intentions ne garantissent pas de bons résultats et, réciproquement, de mauvaises intentions n’excluent pas de bons résultats.
Mais si les acteurs sont de grandes personnalités ? On rappelle volontiers que Goya, Delacroix, Picasso et d’autres étaient des aficionados passionnés. Une manière de dire : si ces grands hommes ont été inspirés par la corrida, c’est donc qu’elle a une valeur, c’est donc qu’il faut la défendre. On donne ainsi l’impression que la corrida a joué un rôle dans leur génie et donc, d’une certaine manière, que Goya, Delacroix et Picasso n’auraient pas été Goya, Delacroix et Picasso sans elle. Ce qui signifie, pour nous, aujourd’hui : si vous interdisez la corrida, vous nuisez au développement du potentiel humain dans une mesure qui reviendrait à tuer dans l’œuf des Goya, des Delacroix, des Picasso. C’est un autre sophisme, qui porte le nom d’« appel à l’autorité ».
Il est ici doublé d’un « sophisme de la bonne compagnie », puisque l’on fait référence non seulement à de grandes personnalités (autorité), mais encore à des gens dotés d’un ethos respectable, d’une image positive, donc insoupçonnables d’être associés à de mauvaises pratiques. D’où ce genre d’argumentation : « Pensez-vous vraiment que Lorca, Hemingway, Leiris, Bataille, Cocteau se plaisaient à voir mourir des bêtes ? » [4]. Le raisonnement sous-jacent est celui-ci : Lorca, Hemingway, Leiris, Bataille et Cocteau sont des hommes bons. Or, ils aiment la corrida. Donc, la corrida est bonne. Sophisme, bien entendu, puisqu’il n’y a aucun lien logique entre la sympathie que peut susciter une personne et la légitimité des pratiques qu’elle apprécie. Les personnes citées sont bonnes pour écrire, peindre, composer, pas forcément pour avoir des jugements éthiques valables. Qu’une pratique soit une inspiration pour l’art n’en fait pas forcément une bonne pratique. L’art s’inspire de tout, y compris du pire, et heureusement qu’il a cette liberté.
Le sophisme de la bonne compagnie tente donc de rendre la corrida sympathique en l’associant à des pro-taurins sympathiques. Mais l’on trouve aussi la stratégie inverse, le « sophisme de la mauvaise compagnie », qui tente de rendre la corrida sympathique en dénigrant les anti-taurins. Les exemples sont nombreux, où l’on dresse le portrait terrible de ces « animalistes » absurdes, ridicules, et surtout dangereux, à grands coups d’amalgame, d’ignorance et de mauvaise foi.
La défense habituelle de la corrida, d’autant plus faible qu’elle est criblée de sophismes, est renforcée depuis quelques années par le développement d’une argumentation philosophique [5], plus subtile, mais non moins fallacieuse. La corrida est présentée comme un symbole. Pour Alain Renaut, elle symbolise « le combat de l’homme avec la nature », pour exprimer « la soumission de la nature brute (c’est-à-dire de la violence) au libre arbitre humain, victoire de la liberté sur la nature ». C’est à la fois un art et l’expression de l’humanisme, « c’est-à-dire la désignation de la culture comme la tâche propre de l’homme », la culture étant définie comme arrachement à la nature [6]. Francis Wolff renchérit : « L’humanité contre la tauréité. Homo sapiens vulnérable mais serein face à la force vaine de bos taurus ibericus. Nature lucide contre nature aveugle » [7].
L’explication est simpliste, pour au moins deux raisons. D’une part, parce que si tout ce que montre la corrida est ce vieux dualisme que tous les philosophes depuis Descartes ont dépassé, alors elle décrit un monde et un système de pensée qui ne sont plus les nôtres depuis trois siècles. D’autre part, parce que si le taureau symbolise la nature, il est bien loin dans les faits d’être la nature, c’est-à-dire d’être naturel, comme le reconnaît Renaut lui-même [8]. Le taureau de combat est un produit extrêmement calibré, contrôlé, maîtrisé, un chef-d’œuvre de l’élevage, donc de la culture. La « naturalité brute » qu’il dégage malgré tout n’est rien d’autre que l’interprétation que nous avons de son comportement. Elle n’est pas tant en lui que dans notre regard, qui trouve ce qu’il cherche.
Mais le problème essentiel est ailleurs. Il y a une confusion générale, un glissement sémantique de l’explication à la justification. Lorsque Renaut et Wolff mettent au jour ce que symbolise la corrida, ils ne le font pas pour enrichir de manière neutre les catalogues anthropologiques. Ils le font pour la défendre ! Ils passent donc du fait à la valeur, d’une explication à une justification. Or, ce n’est pas parce qu’une pratique peut être expliquée qu’elle est juste. Il serait aisé de réunir une trentaine d’intellectuels internationaux pour trouver à l’excision, l’infibulation ou à n’importe quelle torture, scarification ou violence traditionnelle une importante dimension symbolique, rituelle, esthétique, sociologique, psychanalytique et tout ce que l’on voudra. La rencontre peut être passionnante sur le plan intellectuel mais cela ne change rien au fait que ces pratiques sont condamnables et doivent être abolies.
Ces philosophes qui défendent la corrida soulignent son rôle éducatif : « Comme le dressage, elle humanise la bête, mais elle met à mort l’animal sitôt instruit » [9]. De là, deux questions. D’une part, à quoi éduque-t-on exactement ? Qu’apprend-on au taureau ? On parle d’une bête instruite, sans jamais préciser de quoi. Je demande de quoi on instruit la bête en lui plantant des lames dans le corps. D’autre part, en admettant qu’il y ait instruction de quelque chose, à quoi cela sert-il d’instruire pour tuer ? Quelle est cette pédagogie qui ne permet pas à l’élève de vivre suffisamment longtemps pour jouir de son instruction ?
Curieusement, la bête qui tout à l’heure était l’incarnation de la nature brute, l’antithèse de la culture humaine, est maintenant instruite comme un enfant. L’anthropomorphisme est même la base de la philosophie de la corrida de Wolff, qui repose entièrement sur l’attribution au taureau d’un certain nombre de qualités : la bravoure, le courage, la noblesse, l’héroïsme, l’excellence [10]. Il y a d’ailleurs une contradiction, puisqu’en même temps qu’il lui attribue ces qualités sophistiquées, il refuse au taureau la simple capacité de vouloir qui, selon lui, serait « contraire à sa nature » [11]. Comment un taureau qui ne veut pas, qui n’est donc qu’une machine, pourrait-il faire preuve d’héroïsme ?
Mais ce qui frappe est que ces qualités sont évidemment humaines. Ce n’est pas le taureau qui voit ce que les hommes appellent un combat comme un « combat ». Ce n’est pas lui qui fait preuve de noblesse dans un coup de corne, d’héroïsme ou de bravoure lorsqu’il continue de se défendre tout en se vidant de son sang. Ce sont les hommes qui lui attribuent ces qualités humaines, pour rendre la comparaison possible. La philosophie de la corrida repose sur une négation de l’altérité. Le taureau est « humanisé » pour pouvoir être mis sur la même échelle de valeurs que l’homme qui le combat – et permettre ainsi la comparaison, dans le seul but de pouvoir affirmer la supériorité humaine, qui n’aurait aucun mérite si l’adversaire ne partageait pas les mêmes « vertus cardinales » [12].
Pourquoi faut-il, en fin de compte, tuer le taureau ? Wolff parle d’« une vérité aveuglante », d’un impératif catégorique : « il faut que le taureau meure ! » [13]. Mais pourquoi ? La raison n’en est énoncée clairement nulle part. L’auteur explique que la manière de le faire justifie le fait de le faire. La mise à mort est codifiée, ritualisée, elle est une cérémonie. Cela suffit à la défendre : « Dans toutes les civilisations où le taureau a été combattu et mis à mort de façon formalisée, il a été admiré, loué, célébré et plutôt chanté comme un dieu que traité comme une bête » [14]. « Après la mort, enfin, la dépouille du taureau combatif est souvent acclamée. Parfois même, elle recueille un tour d’honneur au pas lent des mules, et la foule se lève et se découvre à son passage » [15].
Le raisonnement sous-jacent est celui-ci : la corrida formalise la mise à mort. Or, toutes les civilisations qui ont fait de même ont traité le taureau comme un dieu. Donc, la corrida traite le taureau comme un dieu. Donc, elle le respecte. Donc, elle est légitime. Raisonnement typiquement anthropocentrique : le taureau se moque bien d’être respecté comme un dieu s’il souffre et meurt dans l’arène. De la même manière, je ne peux pas justifier l’enlèvement et le meurtre sacrificiel d’une jeune vierge par le fait que la codification de la pratique manifesterait mon respect à son égard. Le fait d’avoir des règles, des rites, un déguisement et, éventuellement, un grand respect pour sa victime, n’excuse ni ne justifie en rien ce qu’on lui fait subir.
Quant aux hommages rendus à une dépouille, ils n’ont de sens que pour les survivants. Celui qu’on enterre dans un cimetière se moque bien d’avoir des fleurs fraîches sur sa tombe. De la même manière, le tour d’honneur de la dépouille du taureau n’a strictement aucun sens pour le bovin mort ou pour ceux qui sont encore aux champs : c’est l’homme encore et toujours qui se fait plaisir. Si l’on pense que la corrida se justifie par ce plaisir que peuvent éprouver certains hommes à y assister, qu’on le dise franchement. Mais qu’on cesse de dissimuler derrière un écran de fumée métaphysique des raisons qui sont en réalité beaucoup plus brutes.
[1] Francis Wolff, « Gare à l’idéologie ‘animaliste’ », L’Humanité hebdo, 15 septembre 2007, p. 18.
[2] Jean-Baptiste Jeangène Vilmer, Ethique animale, Paris, PUF, 2008, p. 137-138.
[3] Francis Wolff, « Gare à l’idéologie ‘animaliste’ », op. cit.
[4] Ibid.
[5] Voir Alain Renaut, « L’esprit de la corrida », La règle du jeu, 7, 1992, p. 84-109 et « L’humanisme de la corrida », Critique, 723-724, 2007, p. 552-560 ; et Francis Wolff, « Le statut éthique de l’animal dans la corrida », Cahiers philosophiques, 101, 2005, p. 62-91 et Philosophie de la corrida, Paris, Fayard, 2007.
[6] Alain Renaut, « L’esprit de la corrida », op. cit., p. 94 et « L’humanisme de la corrida », op. cit., p. 557.
[7] Francis Wolff, Philosophie de la corrida, op. cit., p. 76.
[8] Alain Renaut, « L’humanisme de la corrida », op. cit., p. 558.
[9] Pedro Cordoba et Francis Wolff, Critique, 723-724, 2007, p. 550. Voir aussi Renaut, « L’humanisme de la corrida », op. cit., p. 557.
[10] Francis Wolff, Philosophie de la corrida, op. cit., p. 78.
[11] Ibid., p. 74.
[12] Ibid., p. 82. Voir Elisabeth Hardouin-Fugier, « Surhomme et sous-bête, le toro de corrida », in Boris Cyrulnik (dir.), Si les lions pouvaient parler. Essais sur la condition animale, Paris, Gallimard, 1998, p. 1286-1295.
[13] Francis Wolff, op.cit., p. 97.
[14] Ibid., p. 66-67.
[15] Ibid., p. 69.


