Pourquoi intervenir ? Le critère de la cause juste dans la théorie de l’intervention humanitaire armée
Critique internationale, 54, 2012, p. 145-168.
PDF Abstract
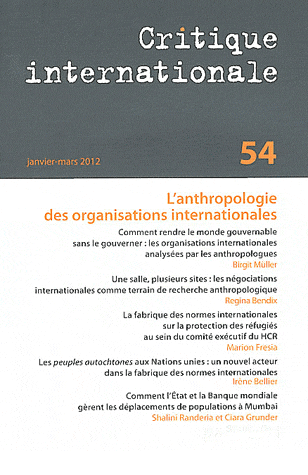
La théorie de l’intervention militaire justifiée par des raisons humanitaires reprend en général les critères de la doctrine traditionnelle de la guerre juste : cause juste, autorité légitime, bonne intention, effet positif, dernier recours et proportionnalité. En ce qui concerne le premier de ces critères, la cause juste, il y a au moins trois manières de l’aborder. Certains auteurs utilisent une formulation en termes de droits : puisque l’intervention humanitaire est définie comme celle visant à prévenir ou à mettre fin à des violations massives de droits de l’homme, déterminer la cause juste revient finalement à dire de quels droits il s’agit. La plupart des auteurs utilisent une formulation en termes d’exactions : ils dressent une liste des crimes qui, selon eux, constituent des causes justes d’intervention. La troisième approche consiste à formuler la question en termes de dommage, sans nécessairement préciser quels sont les droits violés et quels sont les crimes causant ces dommages. Cette position s’inscrit dans une perspective conséquentialiste.
S’il est un acte, dans le champ des relations internationales, qui reflète à lui seul toute l’ambivalence de la nature humaine, c’est bien celui qui consiste à utiliser la violence au nom de l’humanité. S’il est un comportement par définition extrême, c’est bien celui qui consiste à répondre à ce qui se fait de pire sur le plan national – le massacre de masse, le génocide, le crime contre l’humanité – par ce qui se fait de pire sur le plan international – la guerre – au nom de principes moraux. Comme l’intervention est armée, elle fera des victimes civiles. Et son ambiguïté morale s’exprime alors par cette formule lapidaire : tuer des civils pour sauver des civils.
Au fil du temps et au gré des contextes, différentes appellations ont été utilisées pour désigner, plus ou moins correctement, cette pratique érigée en doctrine : intervention d’humanité au XIXe siècle, intervention humanitaire (humanitarian intervention) dans la tradition anglophone, « droit » ou « devoir d’ingérence » en France, « responsabilité de protéger » (R2P) depuis quelques années. La multiplicité des appellations trahit déjà la confusion dans laquelle se trouvent les observateurs face à une réalité dont la gravité, l’ampleur et la complexité mobilisent autant qu’elles découragent.
Qu’ils soient interventionnistes ou anti-interventionnistes, ces observateurs s’attachent en général à discuter les mêmes critères, qui sont ceux de la doctrine traditionnelle de la guerre juste : cause juste, autorité légitime, bonne intention [1], effet positif, dernier recours et proportionnalité. Nous traiterons ici du premier de ces critères, la cause juste, dont la proximité avec le critère de la bonne intention justifie que nous insistions d’emblée sur ce qui les différencie.
La cause juste est un phénomène : violations massives des droits de l’homme, génocide, nettoyage ethnique, massacre de grande ampleur... La bonne intention est un état d’esprit qui s’exprime en principe dans un discours sur la cause juste. C’est la raison pour laquelle la cause juste et la bonne intention sont étroitement liées.
Dire que l’on intervient pour mettre fin à un massacre en cours est censé témoigner d’une bonne intention parce que la cause semble juste. Or, contrairement à la cause qui est empiriquement accessible et vérifiable – on peut s’entendre sur l’existence d’un massacre –, l’intention est inaccessible à tous ceux qui n’appartiennent pas aux instances dirigeantes de l’État intervenant. C’est en raison de ces contraintes épistémiques que nous avons ailleurs rejeté ce critère de la bonne intention, et proposé de reconstruire une théorie de l’intervention humanitaire armée sans lui [2]. Le critère de la cause juste rencontre également des problèmes, mais qui ne sont pas rédhibitoires.
On intervient, disait L. Oppenheim, pour mettre fin à ce qui « choque la conscience de l’humanité » [3]. La formule est séduisante, mais imprécise. Elle présuppose, d’une part, que l’humanité est un invariable, d’autre part, qu’elle a une « conscience », laquelle, également invariable, reste à définir. Il est pourtant évident que la définition de ce que sont l’humanité et la conscience humaine varie selon le contexte, le moment et le lieu. Pour intervenir « au nom de l’humanité », il faut déjà savoir qui est humain, qui est digne d’être sauvé. Cette définition a évolué au cours des siècles [4], comme en témoigne la construction du droit international humanitaire [5] : l’Europe du XIXe siècle ne concevait pas l’humanité de la même manière que l’Europe du XXe siècle, et leurs conceptions étaient encore différentes de celle des peuples non occidentaux. P. Singer observe que ce que l’on appelle la « conscience » de l’humanité a été et est encore choqué par des choses telles que les relations sexuelles interraciales, l’athéisme et les bains mixtes. Bien sûr, ajoute-t-il aussitôt, « lorsque les juristes internationaux parlent d’actes qui choquent la conscience de l’humanité ils ne pensent pas à ces choses-là, mais à quoi pensent-ils au juste ? » [6]. Là est tout le problème.
R. J. Vincent, lui aussi, parle de « crimes choquant la conscience » [7], N. J. Wheeler, d’« urgences humanitaires suprêmes » [8], T. W. Pogge, de « violations massives des droits de l’homme » [9], B. D. Lepard, simplement de « violations des droits de l’homme » [10], C. Greenwood, de « morts et de souffrances à grande échelle » [11], et M. Finnemore, de « violence humaine » [12]. Toutes ces formulations sont bien trop vagues. Qui détermine ce qui constitue une urgence ? Comment distinguer une urgence suprême d’une urgence qui ne le serait pas ? De la violation de quels droits parle-t-on ? De quelle souffrance ? À partir d’où commence la « grande échelle » ? Toutes les « violences humaines » sont-elles concernées ? La définition de S. Caney est encore plus vague : « Une intervention peut être définie comme humanitaire si l’un de ses principaux objectifs est de protéger le bien-être des membres d’un autre État » [13].
Ce manque de précision n’est pas seulement une frustration pour les chercheurs et une aubaine pour les politiciens, il augmente également les risques d’abus. Car si l’on ne dit pas quels droits de l’homme sont concernés, si l’on ne précise pas la nature et surtout l’ampleur de la « violence humaine » dont on parle, si l’on n’explique pas en quoi une urgence peut être « suprême » et une autre non, alors presque n’importe quelle intervention peut se déclarer « humanitaire », et c’est la porte ouverte à l’usage prétextuel du concept qui nuit tant à sa crédibilité.
Il est donc important de procéder à une analyse détaillée de ce que devrait être la juste cause d’une intervention militaire justifiée par des raisons humanitaires. Certains auteurs utilisent une formulation en termes de droits : puisque l’intervention humanitaire est définie comme visant à prévenir ou à mettre fin à des violations massives de droits de l’homme, déterminer la cause juste revient finalement à dire de quels droits il est question. La plupart des auteurs cependant ont recours à une formulation en termes d’exactions : ils dressent une liste des crimes qui, selon eux, constituent des causes justes d’intervention. Ces deux approches sont possibles et nous les explorerons, mais elles posent un certain nombre de problèmes. Nous défendrons donc une troisième approche, qui consiste à formuler la question en termes de dommage, sans nécessairement préciser quels sont les droits violés et quels sont les crimes causant ces dommages.
En considérant que ce n’est pas le crime lui-même mais sa conséquence qui doit être le critère de considération morale, nous nous inscrivons dans la tradition conséquentialiste, selon laquelle une action est bonne si elle produit de bonnes conséquences. L’utilitarisme en est une version, qui affirme qu’une action est bonne lorsqu’elle maximise le bonheur (utilitarisme hédoniste) ou la satisfaction des préférences (utilitarisme des préférences) de l’ensemble des individus concernés. Le conséquentialisme s’oppose aux deux autres grandes traditions en éthique : le déontologisme (paradigme kantien), selon lequel une action est moralement bonne si elle est accomplie par devoir ou par respect d’une norme, et l’éthique de la vertu, qui évalue davantage le caractère moral de l’agent (son ethos selon Aristote).
En éthique des relations internationales, le conséquentialisme est associé la plupart du temps à la tradition réaliste, de Machiavel à Kenneth Waltz, et à la tradition de la guerre juste, voire à la justification du terrorisme [14] et, en retour, de la torture dans le cadre de la guerre contre le terrorisme [15]. Nous avons défendu ailleurs une approche réaliste de l’intervention humanitaire armée [16], mais il n’est pas nécessaire d’être réaliste pour être conséquentialiste en relations internationales puisqu’une partie de ceux qui, comme P. Singer, défendent un paradigme cosmopolitique sont aussi conséquentialistes [17]. L’approche par le dommage que nous proposons peut donc s’inscrire dans différents cadres conceptuels.
I- La formulation en termes de droits
Ce que l’on désigne par « droits de l’homme » est un ensemble très vaste et diversifié de droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, qui ne correspondent pas tous à ceux auxquels on pense pour justifier une intervention militaire. C’est pourquoi il est préférable de définir l’intervention humanitaire comme visant à prévenir ou à arrêter des violations graves et massives des droits les plus fondamentaux, c’est-à-dire applicables à tous et partout.
En droit international des droits de l’homme (DIDH), cette hiérarchie est discutable. Le consensus porte plutôt sur le fait qu’il n’y a pas de hiérarchie des droits de l’homme, qu’ils sont indivisibles. La pratique a toutefois tendance à montrer le contraire. La notion de jus cogens par exemple, c’est-à-dire de « droit contraignant », qui désigne une norme impérative de droit international porteuse d’une valeur universelle d’intérêt vital (art. 53 de la Convention de Vienne), n’est formellement reconnue que pour l’interdiction de la torture [18]. En tout, seuls quatre droits sont considérés comme indérogeables par le DIDH et figurent dans les trois principales conventions (art. 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques-PIDCP ; art. 27 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme-CADH et art. 15 de la Convention européenne des droits de l’homme-CEDH) : le droit à la vie, le droit de ne pas être torturé ou de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants, le droit de ne pas être tenu en esclavage ou servitude et le droit à la non-rétroactivité de la loi pénale.
Il convient de faire ici plusieurs remarques. D’une part, le fait d’avoir le statut de droit indérogeable n’implique pas nécessairement l’obtention du statut de jus cogens. Les droits indérogeables peuvent faire l’objet de réserves, puisque l’interdiction de dérogation ne vaut pas interdiction de réserve – laquelle réserve est incompatible avec le statut de jus cogens. D’autre part, indérogeable ne signifie pas absolu, comme le montre l’art. 2 de la CEDH dans le cas du droit à la vie : la mort peut être infligée légalement, en vertu de la législation (peine de mort) ou de la nécessité du recours à la force (légitime défense, arrestation, évasion, émeute, insurrection).
En fait, il n’existe pas de liste précise de droits – les quatre droits susmentionnés semblant seulement plus fondamentaux que les autres – en vertu desquels un État peut légitimement intervenir dans un autre État. L’intervention humanitaire n’est pas un droit au sens positif du terme, elle n’a pas de règles d’engagement précisant quels sont les droits visés, elle n’a pas de cause objective et n’est pas une réponse se déclenchant automatiquement à chaque fois qu’un certain droit est violé dans le monde. Elle résulte plutôt d’une appréciation subjective d’une situation donnée.
Le droit le plus fondamental qui a motivé les interventions considérées comme « humanitaires » dans l’histoire est le droit à la vie. Ce n’est pas au nom de la liberté d’expression, du droit à la propriété privée ou à l’instruction qu’un État envoie des troupes dans un autre État. L’intervention militaire coûtera des vies humaines, et cela ne peut se justifier que si elle en sauve davantage. La question est alors de savoir à partir de combien de meurtres, et de quels types de meurtres, on peut parler de massacre et intervenir au nom de ce droit particulier à la vie qu’est celui de ne pas être massacré. Dans quelle mesure, même, les nombres doivent-il compter dans l’évaluation juridique et morale d’une situation ? C’est un débat classique en philosophie morale [19], qui trouve d’ailleurs une application dans le cas de la qualification de génocide, puisqu’elle ne dépend pas tant du nombre des victimes que de l’intention des meurtriers (mens rea) [20].
II- La formulation en termes d’exactions
L’intervention humanitaire s’appuie sur les critères traditionnels de la guerre juste, dont l’effet positif et le dernier recours : en raison des risques liés à toute opération militaire, les États acceptent l’idée d’une intervention « uniquement dans les cas extrêmes » [21]. La seule manière de garantir l’effet positif est effectivement de n’intervenir qu’en dernier recours, lorsque la situation est telle qu’elle ne pourrait être pire [22]. C’est la raison pour laquelle les articles 138 et 139 du document final du Sommet mondial de 2005 limitent la responsabilité de protéger à quatre situations seulement : « le génocide, les crimes de guerre, le nettoyage ethnique et les crimes contre l’humanité ».
Le noyau dur des causes justes
Pour la société internationale, et surtout pour l’opinion publique, le génocide représente le pire des crimes, le stade ultime des violations graves et massives des droits de l’homme. Il n’y a pourtant pas de hiérarchie des crimes internationaux les plus graves, et il n’y a aucune raison de considérer que, si le génocide est une cause juste, les crimes contre l’humanité d’une manière générale ne puissent pas en être une aussi. Comme l’a bien expliqué la Commission internationale d’enquête sur le Darfour, le fait de ne pas qualifier une situation de génocide n’est pas une destitution car « des crimes internationaux comme les crimes contre l’humanité ou les crimes de guerre à grande échelle peuvent être aussi graves et odieux que le génocide » [23].
Cette position, assez consensuelle, sur les quatre situations qui constituent le noyau dur des causes justes d’une intervention est minimaliste en ce qu’elle privilégie les cas les plus exceptionnels. C’est ce que nous défendons, mais certains veulent élargir le cercle des causes justes pouvant légitimement donner lieu à une intervention, et cette logique extensionniste les amène à intégrer des causes beaucoup plus discutables.
Le seuil est parfois si bas et les limites du cercle si floues que l’intervention humanitaire est confondue avec les guerres préventives ou préemptives. Une guerre est préventive si un État attaque un autre État parce qu’il craint lui-même d’être attaqué à moyen terme ; elle est préemptive s’il estime que sa sécurité nationale est menacée à très court terme. Juridiquement, la guerre préventive est clairement illégale, la guerre préemptive, elle, est au mieux discutable, selon l’interprétation que l’on a de l’article 51 de la Charte des Nations unies. Philosophiquement, l’une et l’autre peuvent être défendues comme des guerres justes à certaines conditions [24], mais, dans tous les cas, elles n’ont rien à voir avec l’intervention humanitaire puisqu’elles reposent sur la légitime défense, c’est-à-dire la défense de soi, et non celle des autres.
L’intervention humanitaire est préventive, puisque sa raison d’être est de prévenir ou d’arrêter certaines exactions. M. W. Doyle peut donc établir des liens entre ces deux notions, mais cela ne les rend pas équivalentes, comme l’a bien montré H. Koh qui parle d’une « fausse analogie » [25].
La tyrannie
L’élargissement le plus commun du cercle des causes justes – M. Walzer parle d’une « expansion significative de la doctrine du jus ad bellum » [26] – consiste à aller au-delà des violations extra-ordinaires pour englober celles, ordinaires, des tyrans. À ces derniers on ne reproche plus de commettre telle ou telle exaction, mais d’imposer un type de régime, dont la nature même est condamnée soit parce qu’elle va à l’encontre de certaines valeurs (déontologisme), soit parce qu’elle augmente considérablement le risque de violations des droits de l’homme (conséquentialisme). Ceux qui pratiquent cet élargissement déplacent la doctrine traditionnelle de l’intervention humanitaire vers l’intervention politique. N. J. Wheeler et J. Morris les appellent les « nouveaux interventionnistes libéraux » [27].
Bien sûr, ces derniers ne sont pas si nouveaux que cela, puisque la confusion entre intervention humanitaire et intervention politique existe depuis des millénaires [28]. Mais, aujourd’hui, leur compréhension large de ce que doivent être les droits protégés par l’éventualité d’une intervention conduit ces interprètes à considérer, par exemple, que le droit de participer à des élections libres ou celui d’être libéré d’une tyrannie constitue, au même titre qu’un génocide, un motif légitime d’intervention [29]. F. R. Tesón appelle « humanitaire » toute intervention visant à provoquer la chute d’un tyran, à condition que le but soit de remplacer le régime honni par un régime démocratique [30]. La fameuse urgence humanitaire, imminente ou en cours, n’est plus nécessaire : la nature du régime politique suffit. Les critères de légitimité interne déterminent « les critères de légalité externe » [31] – lien qui existe depuis longtemps mais qui, cette fois, justifie la suspension du principe de non-intervention [32].
Les tenants de ce genre d’argumentation commettent une grave confusion. Tout d’abord, F. R. Tesón confond la nature du régime et les actes perpétrés sur son territoire, lesquels peuvent être attribuables non au caractère propre du régime mais à sa seule impuissance, comme ce fut le cas en Somalie et au Rwanda [33]. Ensuite et surtout, il confond l’intervention humanitaire avec l’intervention politique menée unilatéralement pour promouvoir la démocratie, comme ce fut le cas à Grenade en 1983 et au Panama en 1989. Contrairement à ce que présuppose la rhétorique de la libération, l’intervention politique ne concerne qu’indirectement et partiellement la population, car la volonté de renverser un régime peut être motivée par d’autres raisons que la protection d’une population opprimée par un tyran sanguinaire. Dans son projet de remodelage d’un « Grand Moyen-Orient », l’administration américaine a une perspective globale de stabilité régionale et internationale, dont le but est d’abord de protéger les États-Unis, d’étendre leur sphère d’influence et de leur ouvrir de nouveaux marchés. En l’occurrence, il n’est guère question de la population locale : « L’objectif poursuivi est plutôt de réformer certains types de gouvernements jugés indésirables, non de porter secours de manière ciblée à des victimes de génocides ou de crimes de masse » [34].
En théorie, il est facile de distinguer l’intervention humanitaire à proprement parler de l’intervention pro-démocratique, et l’on se doit de le faire. Mais, dans la pratique, n’y a-t-il pas des cas où les deux types d’intervention coïncident, voire fusionnent ? De fait, les urgences humanitaires apparaissent souvent dans des États non démocratiques, et l’on peut, en général, établir un lien de causalité entre la nature du régime et les exactions dont est victime la population, soit parce que le régime les commet lui-même, soit parce qu’il les laisse faire ou n’a pas le pouvoir de les empêcher. Quelle serait l’efficacité d’une intervention qui ne s’attaquerait qu’aux symptômes en arrêtant les massacres en cours, puis se retirerait, augmentant ainsi la probabilité d’une rechute ? Si la cause de l’urgence humanitaire est un gouvernement tyrannique, intervenir pour répondre à cette urgence humanitaire – et non pour renverser le gouvernement – passe dans les faits par son renversement, non comme une fin, mais comme un moyen nécessaire [35]. Autrement dit, l’intervention humanitaire peut être « l’occasion d’une démocratisation forcée et justifiable » [36].
Prenons le cas de l’intervention de l’OTAN en Libye [37]. Officiellement, il s’agissait d’une intervention « seulement » humanitaire, la résolution du Conseil de sécurité n’autorisant les États intervenants à prendre « toutes les mesures nécessaires » que « pour protéger les populations et les zones civiles menacées d’attaque ». Il n’était apparemment pas question de renverser un dictateur, encore moins d’imposer la démocratie, et les responsables politiques et militaires se sont bien gardés, en général, de prétendre le contraire. Or, tout en reconnaissant la limite de leur mandat, ils étaient unanimes à souhaiter le départ de Mouammar Kadhafi. Comment comprendre ce paradoxe ?
L’intervention est humanitaire dans sa fin mais politique dans ses moyens. Les sceptiques demanderont : est-ce bien l’intervention humanitaire qui est l’occasion d’une intervention politique, ou l’inverse ? L’État intervenant ne peut-il pas profiter d’une crise humanitaire pour renverser le régime en cause en se servant des victimes comme d’un moyen, et non comme d’une fin ? Sans doute. Mais cela ne semble pas avoir été le cas en Libye. Les États intervenants faisaient hier encore des affaires avec Kadhafi et n’avaient aucun intérêt à renverser un si bon client. Il a fallu un « printemps arabe » pour que le dictateur jusque-là fréquentable redevienne « sanguinaire ».
Dès lors, Kadhafi devait partir. Dire cela, ce n’était pas être un faucon néoconservateur faisant du changement de régime une cause juste en soi. C’était au contraire considérer ledit changement comme un moyen de servir la cause juste, à savoir la protection des civils. La question était simple : pouvait-on protéger les civils sans renverser Kadhafi alors même qu’il avait ordonné le bombardement des manifestants à Tripoli, menacé de « nettoyer » Benghazi, et même d’attaquer des objectifs civils en Méditerranée ? Non, puisqu’il était à l’origine de la menace qui pesait sur eux.
Le renversement de Kadhafi était donc l’une des « mesures nécessaires » autorisées par la résolution du Conseil de sécurité. Ce n’était pas une fin en soi – c’est en cela qu’il ne s’agissait pas d’une intervention pro-démocratique – mais un moyen. D’ailleurs, rien ne garantit que le nouveau régime sera démocratique. On peut toutefois supposer qu’il le sera davantage, et cela suffit à le préférer.
Une dernière question mérite d’être soulevée : celle de la sincérité des États intervenants. Dans le cas de l’Irak par exemple, les États-Unis et leurs alliés ont « utilisé » le label humanitaire pour « vendre » l’invasion de ce pays en 2003. En effet, les justifications humanitaires sont devenues prioritaires après l’invalidation patente des raisons « préventives » (armes de destruction massive (ADM) et lien avec Al-Qaïda) et la révélation d’une totale manipulation de la part des États-Unis. S’il avait existé une vraie sollicitude à l’égard du peuple irakien, celle-ci se serait manifestée beaucoup plus tôt. Or, premièrement, les États-Unis n’ont pas réagi lors du massacre des Kurdes en 1988 (cette passivité pouvant au demeurant s’expliquer par le contexte de la guerre froide et la menace du fondamentalisme iranien) ; deuxièmement, c’est la population irakienne qui a souffert en priorité des sanctions prises à l’égard du régime (ce qui peut également s’expliquer si l’on considère que le but était de pousser cette population à la révolte contre le régime, et que, sans ces sanctions, Saddam Hussein aurait pu se procurer les composants indispensables à la fabrication des ADM) ; troisièmement, des violations du droit international humanitaire ont eu lieu pendant l’intervention elle-même ; quatrièmement, les affaires relatives au traitement des prisonniers irakiens pendant l’occupation (torture, humiliation, etc.) ont achevé de réduire à néant l’image « humanitaire » que la coalition voulait donner à son intervention.
La suspicion quant à la sincérité de ces dirigeants est donc justifiée, mais il serait faux de se fonder sur une telle posture pour prétendre qu’il n’y avait chez eux aucune ambition « humanitaire ». Comme N. J. Wheeler et J. Morris, nous rejetons cette accusation de manipulation qui semble être une conviction populaire [38]. D’abord, parce que la dimension humanitaire n’a jamais été la raison principale avancée officiellement par la coalition pour lancer l’intervention. Cet argument n’était au début que subsidiaire. Ainsi, même s’il était intimement convaincu de sa validité, T. Blair s’est bien gardé de faire de ce type de justification la position officielle du Royaume-Uni [39]. Ensuite et surtout, parce que cette accusation de manipulation présuppose que les dirigeants en question n’étaient eux-mêmes pas convaincus que renverser le régime de Saddam Hussein eût été un acte « humanitaire ». Or, et c’est bien là tout le problème, l’analyse de leurs discours révèle qu’ils l’étaient. Les dirigeants de la coalition font en effet partie de ceux qui, pour des raisons idéologiques, confondent en toute sincérité intervention humanitaire et intervention pro-démocratique. Pour ces néoconservateurs et « nouveaux interventionnistes libéraux », l’intervention humanitaire est synonyme de promotion des valeurs libérales, donc de la démocratie. Le problème ne réside donc pas dans une éventuelle volonté de manipulation, mais plutôt dans la compréhension de ce qu’est l’« humanitaire ».
Les catastrophes naturelles
Compte tenu du fait que, la plupart du temps, le gouvernement d’un pays touché par une catastrophe naturelle donne son consentement à l’intervention de l’aide internationale sur son territoire, les catastrophes naturelles ne font généralement pas partie des causes justes de l’intervention humanitaire, même si cette assistance peut être délivrée par des moyens militaires (logistique, corridors). En revanche, si le pays touché est également le théâtre d’un conflit armé, ou s’il est dirigé par un régime autoritaire, le gouvernement est beaucoup plus réticent à donner son consentement à une intervention étrangère, qui risque davantage d’interférer avec ses propres objectifs politiques [40]. Pour certains, l’assistance délivrée en cas de catastrophe naturelle est d’ailleurs l’occasion de tester le caractère soi-disant humanitaire des motivations des États potentiellement intervenants [41]. B. Clinton n’a-t-il pas dit au sujet de la Somalie : « Sauf si la tragédie humaine est causée par une catastrophe naturelle, il n’y a pas d’entreprise purement humanitaire » [42] ?
Selon la distinction de B. Reichenbach, les maux naturels sont causés soit par des agents non humains, soit involontairement par des agents humains. Catastrophes naturelles, épidémies ou effets involontaires de l’activité humaine sont en tout cas moralement « neutres », tandis que les agents humains causant volontairement des souffrances doivent être tenus pour moralement responsables de leurs actes [43].
Imprégnée sans le savoir de cette distinction, l’opinion publique sépare les victimes innocentes, prises par hasard dans la tourmente de la catastrophe, des victimes coupables, qui méritent sans doute leur sort, du moins s’en persuade-t-on. Dans le domaine de l’humanitaire civil, cette discrimination a des conséquences évidentes : « Les Nations unies ont reçu davantage en une semaine pour les victimes du tsunami que pendant toute l’année 2004 pour le Darfour et la République démocratique du Congo » [44]. « Les catastrophes naturelles alimentent manifestement davantage la collecte de fonds que les conflits politiques, pourtant souvent plus meurtriers. (…) Simplement parce que le concept de victime, qui suscite le sentiment de pitié, apparaît plus clairement pour les premières que pour les seconds [45]. »
En réalité, la frontière entre catastrophes naturelles et catastrophes causées par la main de l’homme est floue, voire relativement artificielle. Les dommages, déjà, peuvent être exactement les mêmes. Une catastrophe naturelle peut tuer et déplacer autant de personnes qu’un nettoyage ethnique. Mais, surtout, il peut y avoir une implication réciproque : les crises écologiques peuvent être à l’origine de conflits, et les conflits peuvent à leur tour aggraver les crises écologiques [46].
La notion de « catastrophe naturelle » elle-même est ambiguë. En effet, si une action naturelle a des conséquences catastrophiques, c’est souvent en raison des (mauvais) choix qui ont été effectués par les humains dans un contexte à risque. Nombre de catastrophes dites « naturelles » résultent de la confrontation entre ces choix et un événement relativement prévisible. Si nous persistons à les qualifier ainsi, c’est pour mieux écarter la question embarrassante de la responsabilité humaine. Ce processus a bien été décrit, entre autres, par K. Booth, au sujet de l’ouragan Katrina [47].
C’est donc avec ces nuances qu’il faut aborder la question de savoir ce qu’il faut faire de ces victimes, lorsque l’État sur le territoire duquel la catastrophe a eu lieu ne consent pas à recevoir l’aide internationale. Peut-on considérer la catastrophe naturelle, ou plutôt ses conséquences, comme une cause juste d’intervention militaire ? Oui, répond la CIISE, « lorsque l’État concerné ne peut pas, ou ne veut pas, y faire face ou demander de l’aide, et que d’importantes pertes en vies humaines se produisent ou risquent de se produire » [48]. Il faut donc deux conditions cumulatives : un dommage important en termes de vies humaines et l’inaction des autorités du pays concerné, qui ont toujours, en vertu du principe de souveraineté, la priorité – mais non l’exclusivité – dans la réponse à apporter à la crise. Si elles laissent mourir la population, et même si elles ne sont pas à l’origine de la catastrophe, elles deviennent responsables de l’aggravation de la situation et leur passivité peut être assimilée à un crime de masse. Cette position de la CIISE n’a pas été reprise dans le document final du Sommet mondial de 2005 : du point de vue onusien, la R2P ne s’applique pas aux catastrophes naturelles. Une partie des observateurs, en revanche, pensent qu’elle devrait le faire [49].
La question s’est posée de façon concrète lorsque le cyclone Nargis a ravagé la Birmanie le 2 mai 2008, tuant plus de 133 000 personnes et faisant 2,5 millions de victimes environ. Le gouvernement fut incapable de faire face au désastre mais il n’accepta l’aide internationale qu’au compte-gouttes et sur la base d’accords bilatéraux, ce qui limitait fortement l’accès aux victimes. Ce n’est que le 9 mai, une semaine après le drame, que la junte déclara officiellement qu’elle acceptait l’aide, à condition que celle-ci soit limitée à des contributions financières, des livraisons de nourriture et de médicaments, et qu’aucun humanitaire ou militaire étranger ne soit présent sur le territoire. Ces exigences provoquèrent une aggravation considérable de la situation des victimes, certains observateurs n’hésitant pas à parler de « génocide » [50], preuve, s’il en est, que le mot continue d’être utilisé à tort et à travers parce que l’on est convaincu qu’il est le seul à pouvoir déclencher une action.
La France fut le premier pays, et à peu près le seul, à invoquer le concept de R2P. Le 7 mai, B. Kouchner annonçait que la France aller tenter de faire passer au Conseil de sécurité une résolution utilisant la R2P pour contraindre la Birmanie à recevoir de l’aide. Sa proposition n’était pas très claire puisqu’il déclara que « forcer militairement n’[était] pas possible, et pas envisageable » [51], mais qu’il s’agissait bien d’« imposer » [52] le passage de l’aide humanitaire au gouvernement birman. Or comment imposer quoi que ce soit à un État non consentant sans utiliser la force militaire ? En réalité, il était bien question d’intervention militaire ; au cours des jours qui suivirent, B. Kouchner fit d’ailleurs le parallèle avec la Somalie et la Bosnie.
Examinée à New York les 7 et 8 mai, la proposition française se heurta immédiatement à une vive opposition. Huit pays membres, dont deux permanents (la Chine et la Russie), s’opposèrent à l’implication du Conseil. L’un des motifs invoqués était que celui-ci devait se limiter aux menaces pour la paix et la sécurité internationales. L’approche de B. Kouchner fut également rejetée par Edward Luck, le conseiller spécial du Secrétaire général des Nations unies pour la R2P, qui l’accusa de détourner le concept, de lui donner une « application erronée » pour « faire les gros titres », et d’avoir causé « des dégâts considérables au sein de l’ONU » [53] ; par John Holmes, Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires, qui qualifia l’initiative française d’« inutilement conflictuelle » [54] ; par Douglas Alexander, secrétaire d’État britannique au Développement international, qui la trouva « incendiaire » [55], et par John Sawers, ambassadeur britannique aux Nations unies, qui rappela que la R2P ne s’appliquait pas aux catastrophes naturelles [56].
Le 13 mai, la question fut soumise aux ministres européens chargés du Développement, réunis à Bruxelles : la proposition française, jugée trop agressive et contre-productive, fut là encore rejetée. B. Kouchner ne faiblit pas et parla dans les médias français d’un « risque » de crime contre l’humanité [57]. Desmond Tutu fut plus affirmatif : dans une lettre adressée à trois chefs d’État (G. W. Bush, G. Brown et N. Sarkozy), l’ancien président de la Commission de la vérité et de la réconciliation d’Afrique du Sud accusa la Birmanie de « commettre des crimes contre l’humanité » [58]. B. Kouchner invoqua « le devoir et de droit d’ingérence », et la R2P dont il souhaitait élargir le champ d’application aux catastrophes naturelles [59] – extension qui avait été d’ailleurs défendue par le pape Benoît XVI devant l’Assemblée générale le 18 avril, deux semaines avant le cyclone [60]. Déplorant que le concept de R2P ne s’applique qu’aux conflits armés, B. Kouchner s’appuya donc « sur le seul respect des droits de l’homme et sur la résolution 43-131 » [61].
Les raisons pour lesquelles ces vibrants appels du ministre français n’ont pas fonctionné sur la scène internationale sont simples et nous les connaissons : le droit d’ingérence n’existe pas – selon le bon mot de F. Mitterrand lui-même –, la résolution 43-131, qui consacre le principe de libre accès aux victimes, ne permet aucunement la violation de la souveraineté de l’État concerné et les corridors humanitaires qu’elle autorise doivent être mis en place avec le consentement de ce dernier [62]. Or, en l’occurrence, la Birmanie ne consentait pas. Il n’y avait donc aucune base juridique à la proposition de B. Kouchner, comme l’a rappelé la directrice juridique de Médecins sans frontières [63].
D’un point de vue politique, le but étant de convaincre les autorités birmanes d’ouvrir plus grand les portes du pays, la menace française du recours à la force risquait de produire exactement l’effet inverse. Elle fut donc discréditée comme étant potentiellement contre-productive [64]. Les interventionnistes modérés lui reprochèrent de nuire au concept de R2P, en étendant son domaine d’application au-delà de ce qui est accepté par l’ONU, ce qui risquait à la fois de contribuer à la banalisation du concept et de provoquer la crainte d’un certain nombre de pays en voie de développement que le concept en question soit utilisé comme un « cheval de Troie » pour dissimuler des motivations politiques [65].
G. Evans, l’ancien coprésident de la CIISE, eut une position plus nuancée. Tout en rappelant que, selon l’expression que lui avait donnée le Sommet mondial de 2005, la R2P n’incluait pas les situations de catastrophes naturelles – donc ne s’appliquait pas en principe au cas birman –, il reconnut que « la situation était ambiguë » [66], puisque refuser de sauver des centaines de milliers de personnes en danger de mort pourrait être assimilé à un crime contre l’humanité, qui, lui, permettrait d’activer la R2P [67]. G. Evans rappela que, dans le Statut de Rome ou plus généralement dans le droit coutumier, la définition de ces crimes contre l’humanité n’excluait pas systématiquement les cas de catastrophes naturelles. Le problème était qu’il semblait difficile d’appliquer ici le critère de la mens rea, l’intention criminelle, car rien ne prouvait que les généraux birmans avaient l’intention de nuire à leur population [68].
D’autres paramètres rendaient plutôt fantaisiste le fait de qualifier la situation birmane de « crime contre l’humanité ». Tout d’abord, il aurait fallu, en vertu de l’article 7.1 du Statut de Rome, que l’acte eût été « commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque », ce qui n’était pas le cas. Ensuite, les autorités birmanes ne bloquaient pas toute l’aide humanitaire : J.-M. Ripert, ambassadeur français, représentant permanent auprès des Nations unies, qui défendait la proposition de B. Kouchner, reconnut lui-même que fin mai « 41 % de la population affectée par le cyclone avaient reçu une aide » [69]. Cela était certes insuffisant pour les victimes, mais suffisant pour infirmer l’existence d’une mens rea de la part du gouvernement birman et pour discréditer l’accusation de crime contre l’humanité [70].
La famine
Un million de morts en Éthiopie en 1984, 200 000 à 3,5 millions en Corée du Nord en 1996, 70 000 au Soudan en 1998, une dizaine de millions de personnes touchées par la crise alimentaire dans la corne de l’Afrique en 2011… Nous ne parlons pas ici de la malnutrition ordinaire, endémique dans certains pays et qui, sur le long terme, tue davantage encore, mais contre laquelle une intervention ponctuelle ne peut rien. Nous parlons de la famine, qui est par définition violente [71]. La famine tue plus que les génocides. Pourquoi la responsabilité d’agir est-elle impérative dans le second cas et non dans le premier ? Si laisser des gens se faire tuer est qualifié de non-assistance à personne en danger et donne lieu à d’intenses débats sur le droit et le devoir d’intervenir, en quoi les laisser mourir de faim est-il plus tolérable ? [72]
En d’autres termes, pourquoi a-t-on tendance à intervenir dans les cas de catastrophes humaines brutales, qui tuent en grand nombre et en peu de temps, et de manière démonstrative, et non dans les cas de catastrophes dites « naturelles », comme la famine, qui font pourtant davantage de victimes ? Parce que dans le premier cas le ou les coupables sont clairement identifiés, et surtout par l’observateur occidental, qui peut donc se poser en juge et intervenir. Dans le second cas en revanche, la responsabilité est non seulement beaucoup plus diffuse mais elle concerne aussi l’observateur occidental : si l’Africain meurt de faim, c’est qu’il y a un problème structurel, économique, de justice distributive, auquel participe pleinement l’Occident – pour ne pas dire qu’il en est la cause.
Les droits fondamentaux que distingue H. Shue incluent non seulement le droit à la sécurité, mais aussi des droits positifs, tels que le droit à la subsistance [73]. Certains auteurs envisagent donc de ne pas limiter la cause juste à la violation des seuls droits négatifs, et l’étendent au droit à une nourriture suffisante, suggérant ainsi l’hypothèse d’un autocrate empêchant délibérément son peuple d’avoir accès à des médicaments et à de la nourriture. Il y aurait là une justification à intervenir militairement [74].
D’autres auteurs montrent que le fait de créer ou de prolonger une famine peut être considéré comme un crime international [75]. D. Marcus distingue dans l’attitude des gouvernements quatre degrés de comportement « faminogène » : le premier consiste à assister, impuissant, à une crise alimentaire devenant famine ; le deuxième, à ne rien faire, par indifférence, pour lutter contre le problème alors qu’il y aurait des moyens d’agir. Cette indifférence est généralement considérée comme une « mauvaise gestion » du pays qui ne témoigne pas forcément d’une intention de nuire (mens rea) et n’est donc pas constitutive d’une responsabilité en droit pénal international ; le troisième, à continuer, par imprudence ou par témérité, à mettre en œuvre des politiques tout en sachant qu’elles causent ou augmentent le risque de famine ; le quatrième, à utiliser la famine comme un moyen d’exterminer certaines populations. Selon D. Marcus, les deux derniers comportements peuvent être qualifiés de crimes contre l’humanité et engagent donc la responsabilité de leurs auteurs au regard du droit pénal international [76].
Cette distinction est intéressante mais elle concerne davantage le travail de la justice, après les exactions, que la question de l’intervention, qui viserait à y mettre fin ou à les prévenir. Que la famine puisse, dans certains cas, être considérée comme un crime permet certainement de l’envisager a priori comme une cause juste d’intervention, mais, l’intervention dont on parle étant militaire, la question est de savoir si elle peut constituer une réponse adéquate, non pour capturer ou punir les responsables, mais pour sauver la population.
Or, lorsque la CIISE évoque « les cas d’effondrement de l’État qui laissent la population massivement exposée à la famine et/ou à la guerre civile » [77], il apparaît, d’une part, que ce n’est pas la famine en tant que telle qui est qualifiée de cause juste mais l’effondrement de l’État qui en est à l’origine (ce qui crée une condition d’intervention supplémentaire), d’autre part, que l’on parle d’une cause juste d’activer la R2P, qui ne se limite pas à l’intervention militaire [78]. On ne peut donc pas en déduire que la CIISE pense qu’une intervention armée puisse être d’une quelconque utilité pour lutter contre la famine.
En Somalie, en 1992, la guerre, conjuguée à la sécheresse, provoqua une famine qui ajouta plusieurs centaines de milliers de victimes à celles que faisaient déjà les combats. La résolution 767 (27 juillet 1992) évoqua les « populations de Somalie menacées en masse par la famine » [79], mais une lecture de toutes les résolutions concernées (751, 767, 775, 794, 814, 837, 885, 886) montre que le Conseil de sécurité était motivé, comme il se doit, par le « maintien de la paix et de la sécurité internationales ».
La famine en tant que telle est une cause légitime de préoccupation et d’action, mais elle ne peut être une cause juste d’intervention armée que si la force militaire a une « chance raisonnable de succès », pour reprendre l’expression traditionnelle de la doctrine de la guerre juste, et cela n’arrive généralement que dans les situations où les autorités du pays concerné ne sont pas consentantes, soit parce qu’il y a une quelconque mens rea en jeu (voir les comportements « faminogènes » selon D. Marcus), soit parce qu’il y a un conflit en cours, et que l’on aura donc toujours d’autres raisons d’intervenir que pour la famine seulement. Autrement dit, la famine ne peut être une cause juste d’intervention armée qu’indirectement, lorsque l’assistance humanitaire se heurte à des obstacles qui nécessitent que les corridors soient sécurisés par une force militaire. Or il y aura toujours un risque que cette présence mette le feu aux poudres et aggrave le conflit, donc le nombre de victimes, comme cela s’est produit en Somalie.
III- La formulation en termes de dommage
La formulation traditionnelle en termes d’exactions, qui consiste à dresser une liste des crimes constituant des causes justes d’intervention, est problématique pour deux autres raisons. La première est que cette liste ne peut pas être exhaustive, et que la rigidité dont on fait preuve en tentant de la dresser ne correspond pas à la diversité des situations réelles. La seconde est que, si l’intervention a une prétention humanitaire et non punitive, elle ne doit pas être déclenchée par la nature d’un crime, mais par un dommage aux victimes. Quelle différence cela fait-il, de ce point de vue, que les 100 000 victimes dont on parle soient tombées sous les coups de meurtriers ayant ou n’ayant pas d’intention génocidaire, ou à cause de la négligence d’un gouvernement face à une catastrophe naturelle ? Il peut paraître indécent de faire ces distinctions subtiles [80].
L’approche par la nature du crime peut donc être avantageusement remplacée par une approche en termes de nature du dommage. Le crime cause un dommage et c’est la nature de ce dommage qui devrait justifier ou non l’intervention, pas le type de crime qui en est à l’origine, dans les classifications du droit pénal international. La CIISE écrit que l’élément « juste cause » est satisfait si l’une des deux conditions suivantes, ou les deux, sont réalisées : « Des pertes considérables en vies humaines, effectives ou appréhendées, qu’il y ait ou non intention génocidaire, qui résultent soit de l’action délibérée de l’État, soit de sa négligence ou de son incapacité à agir, soit encore d’une défaillance dont il est responsable [ou d’]un “nettoyage ethnique” à grande échelle, effectif ou appréhendé, qu’il soit perpétré par des tueries, l’expulsion forcée, la terreur ou le viol » [81].
Le second point relève de l’approche par la nature du crime, puisque l’on identifie un type d’exaction en particulier, mais le premier s’inscrit, dans sa généralité, dans ce que nous entendons par l’« approche par la nature du dommage ». Il y a cause juste d’intervenir lorsqu’il y a des pertes humaines considérables dues à l’action, la négligence ou la défaillance d’un État. Mais ce n’est là qu’un aspect de la cause juste. Il y en a d’autres. En premier lieu, puisque l’on parle de pertes « considérables », il faut examiner la question de l’ampleur du dommage.
L’ampleur du dommage
Lorsqu’elle parle en termes de droits de l’homme, la doctrine évoque des violations « graves et massives ». En termes de crimes, elle n’en retient que certains, les pires, dont la définition contient les mêmes adjectifs. Lorsqu’elle parle en termes de nature du dommage, elle évoque des pertes « considérables » en vies humaines. Dans tous les cas, la question de l’ampleur est présente. À partir de quel seuil la violation est-elle considérée comme insupportable et pourquoi ? À partir de combien de morts un meurtre devient-il un massacre ? À partir de quelle quantité parle-t-on de « grande échelle » ? À ces questions classiques il n’existe pas de réponse satisfaisante, pour au moins trois raisons.
D’abord, il semble difficile de fixer un seuil déclencheur d’intervention de manière non arbitraire. M. E. O’Hanlon et S. J. Solarz, par exemple, proposent de l’établir à cinq fois le nombre de meurtres aux États-Unis [82], ce qui, selon eux, ne serait arrivé « que » 8 fois entre 1992 et 1999 (chiffre contesté par A. J. Kuperman, qui a identifié au moins 17 situations relevant de ce cas) [83].
Ensuite, tout critère impliquant de « compter les morts » serait un aveu d’échec puisque « la communauté internationale se retrouverait dans la situation, moralement injustifiable, où elle devrait attendre qu’un génocide commence avant de prendre des mesures pour y mettre fin » [84]. La plupart des auteurs adoptent une approche par la nature du crime qui identifie la cause juste au noyau dur évoqué plus haut – génocide, crimes de guerre, nettoyage ethnique, crimes contre l’humanité, pour lesquels le critère quantitatif est soit absent (il ne fait pas partie de la définition du génocide, par exemple), soit flou (le crime contre l’humanité doit faire partie d’une « attaque généralisée ou systématique », le crime de guerre doit être « commis sur une grande échelle »).
Enfin, toute définition d’un seuil déterminé pourrait être facilement exploitée par les criminels. Rappelons le mot bien connu d’un diplomate serbe à Javier Solana, alors secrétaire général de l’OTAN : « A village a day keeps NATO away » (un village par jour maintient l’OTAN à distance). Dans l’hypothèse d’un génocide ou d’un nettoyage ethnique, les criminels pourraient mener à bien leur projet avec un succès quasi certain en veillant à ne jamais dépasser le seuil au-delà duquel une intervention pourrait être enclenchée. Le seuil aurait alors l’effet pervers de permettre les exactions.
Le dommage doit-il être commis délibérément ?
E. A. Heinze considère l’intentionnalité comme un critère pertinent et ne réserve l’intervention humanitaire que dans ces cas [85]. Il a raison lorsqu’il dit, non sans ironie, que si personne n’a proposé de lancer une intervention contre la France lorsque la canicule de l’été 2003, dont les effets sur les personnes vulnérables étaient relativement prévisibles, a fait 15 000 victimes (soit deux fois plus que le massacre de Srebrenica [86] !), c’est parce qu’il manquait l’intention de nuire. Mais son raisonnement est tout de même faux car, si l’intervention n’était pas indiquée dans ce cas, outre la raison prudentielle qui, de toute façon, ne l’indique jamais contre une puissance militaire importante (pas plus la France que la Russie ou la Chine), c’est plus simplement parce qu’une intervention n’a de sens que dans les situations où une force armée, dont la mission est de se battre, peut vaincre la cause du problème. En l’occurrence, des avions de chasse et des régiments n’auraient rien pu faire contre la chaleur, ce qu’il fallait c’était des unités d’air conditionné et le respect de certaines mesures de santé publique.
Ce critère de l’intentionnalité peut laisser sceptique car de même qu’il est difficile, voire impossible, de prouver la bonne intention de l’État intervenant, de même il est difficile de prouver la mauvaise intention de l’État ou du groupe à l’origine du dommage [87]. C’est une des raisons pour lesquelles nous rejetons ce critère de mauvaise intention. Une autre est que l’intervention humanitaire n’est pas punitive et que son rôle n’est pas d’établir une culpabilité. C’est à la justice de faire ce travail, c’est elle qui aura recours à l’élément psychologique, la mens rea, et l’on voit mal en quoi cette dimension serait utile pour constater qu’une crise humanitaire quelconque nécessite une intervention. Que 100 000 personnes soient massacrées avec telle ou telle intention, ou même sans intention particulière, par négligence ou par défaillance, ne change strictement rien à l’indignation qui va déclencher l’intervention.
La question de l’intention ne se pose que pour déterminer l’imminence d’un massacre potentiel. Lorsqu’il est en cours, la cause juste légitimant l’intervention est l’existence même du dommage, c’est-à-dire des victimes, indépendamment de la question de savoir qui les a tuées et dans quelle intention précise.
Le dommage doit être imminent ou en cours
Le dommage ne doit pas seulement être d’une certaine nature et d’une certaine ampleur, il doit également être en train d’avoir lieu. Affirmer, comme le fait généralement la doctrine, que le dommage doit être imminent ou en cours revient finalement à dire que l’intervention dont on parle n’est pas punitive, c’est-à-dire qu’elle ne concerne pas le passé. Cette distinction entre intervention humanitaire et intervention punitive est ressassée depuis le XIXe siècle. Le but de l’intervention humanitaire est d’arrêter ou de prévenir des violations des droits de l’homme, tandis que celui de l’intervention punitive – qui peut prendre la forme d’assassinats ciblés, de procès ou d’un changement de régime – est d’infliger un dommage en réponse à une violation des normes de la société internationale [88]. Les deux types d’intervention violent la souveraineté de l’État cible mais, tandis que l’intervention punitive vise l’État lui-même ou un agent particulier, l’intervention humanitaire vise la protection de la population.
Malheureusement, il arrive souvent dans les sphères politiques et médiatiques que l’on confonde les deux, et que l’on réclame la « punition » de tel ou tel dictateur ou régime par une intervention qui serait « humanitaire ». On a pu voir cette ligne d’argumentation dans le cas irakien. La logique punitive est pourtant contre-productive, comme le montre bien le conflit israélo-palestinien, et le risque est d’idéologiser l’intervention [89].
Même si elle est probablement la moins mauvaise des approches, la formulation en termes de dommage demeure imprécise, ce qui est à la fois inévitable et souhaitable. L’imprécision du critère, dans une limite raisonnable, est ce qui lui permet de fonctionner et de s’adapter à des situations diverses. Le dommage est une conséquence. Privilégier cette approche revient donc à adopter une perspective conséquentialiste. En éthique, cette tradition se divise en deux branches. La plupart des utilitaristes classiques, à l’exception sans doute de J. S. Mill, défendent un conséquentialisme de l’acte selon lequel la moralité d’une action particulière n’est déterminée que par ses conséquences, tandis que le conséquentialisme de la règle maintient qu’une action est morale lorsqu’elle respecte une règle ou des règles qui, lorsqu’elles sont suivies, ont les meilleures conséquences globales.
Le conséquentialisme dont il est question ici est celui de la seconde branche. L’approche par le dommage doit être guidée par la règle suivante : la cause est juste lorsque le dommage fait plus de victimes que n’en ferait l’intervention [90]. Il ne s’agit donc pas de fixer un seuil absolu au-delà duquel la cause serait juste, puisque ce seuil dépend du risque que va faire peser l’intervention sur les populations qu’elle entend protéger, et sur les autres. Le problème est qu’au moment de la décision d’intervenir, on ignore ce que seront les conséquences réelles de l’intervention comme d’ailleurs de la non-intervention. Le système est donc probabiliste. La décision d’intervenir repose sur une estimation des conséquences probables de l’intervention [91]. C’est la question de l’effet positif, des chances raisonnables de succès, qui relève du critère de la proportionnalité mais qui est donc étroitement liée à celui de la cause juste. Le pari conséquentialiste étant risqué, la solution que nous proposons est mixte et repose sur une double évaluation : une combinaison de mécanismes ex ante et ex post que nous avons présentée dans un article précédent [92].
Ce qu’il faut retenir, c’est ce que le principe conséquentialiste nous dit concrètement de la cause juste : la situation doit être telle qu’elle ne puisse empirer du fait de l’intervention. Ce qui signifie que seuls les cas extrêmes, où l’on tue un million de personnes en cent jours, par exemple comme au Rwanda, constituent des causes justes claires et assez peu discutables, puisqu’il semble difficile de concevoir qu’une intervention militaire visant à arrêter les massacres ait l’effet pervers de les aggraver. Nous défendons donc une conception minimale de la cause juste, qui ne laisse passer que les exactions les plus graves, sans préciser lesquelles a priori – ce serait bien trop rigide – mais, encore une fois, à la condition que ces exactions soient telles que la situation ne puisse être pire.
Ce faisant, notre préoccupation est d’éviter l’élargissement qui fait discrètement glisser l’intervention humanitaire sur le terrain politique pour inclure la promotion de la démocratie et son corollaire, la guerre aux tyrans. C’est cette confusion qui était à l’œuvre en Irak. Pour l’éviter, il faut insister, outre sur l’interprétation minimale de la cause juste, sur le fait que l’intervention humanitaire a un but négatif, c’est-à-dire qu’elle n’est pas là pour promouvoir les droits de l’homme, la démocratie ou autre chose. De ce point de vue, P. Hassner a raison de dire qu’« il vaudrait mieux, souvent, parler d’intervention contre l’inhumanité » (nous soulignons) [93]. Le problème demeure toutefois, puisque l’extension que l’on donnera à l’« inhumanité » sera variable, et que rien n’empêchera ceux qui le souhaitent d’y inclure la tyrannie. La vigilance sur l’utilisation du label humanitaire est plus que jamais d’actualité, surtout lorsqu’il est invoqué pour justifier le recours à la force armée.
[1] . Jean-Baptiste Jeangène Vilmer, « Éthique et politique de l’intervention humanitaire armée », Critique internationale, 39, avril-juin 2008, p. 161-182.
[2] . J.-B. Jeangène Vilmer, « Humanitarian Intervention and Disinterestedness », Peace Review : A Journal of Social Justice, 19 (2), 2007, p. 207-216.
[3] . Hersch Lauterpacht, International Law and Human Rights, New York, Praeger, 1950, p. 32. Lawrence Oppenheim utilisait cette expression dans son International Law depuis 1905. En 1949, le président de séance de la 15e assemblée de la CDI nota qu’elle était utilisée dans plusieurs instruments internationaux et qu’elle avait été approuvée lors de la Conférence de La Haye de 1907 (UN Doc. A/CN.4/SR.15, 4 mai 1949, § 50).
[4] . Martha Finnemore, The Purpose of Intervention : Changing Beliefs about the Use of Force, Ithaca, Cornell University Press, 2003, p. 60.
[5] . Ruti G. Teitel, Humanity’s Law, Oxford, Oxford University Press, 2011.
[6] . Peter Singer, One World : The Ethics of Globalization, 2e édition, New Haven, Yale University Press, 2004, p. 123. Sauf indication contraire, nous traduisons l’ensemble des citations en anglais de cet article.
[7] . Raymond John Vincent, Human Rights and International Relations, Cambridge, Cambridge University Press, 1986, p. 126-127.
[8] . Nicholas J. Wheeler, Saving Strangers : Humanitarian Intervention in International Society, Oxford, Oxford University Press, 2000, p. 34.
[9] . Thomas W. Pogge, « Preempting Humanitarian Interventions », dans Aleksandar Jokic, Burleigh Wilkins (eds), Humanitarian Intervention : Moral and Philosophical Issues, Peterborough, Broadview Press, 2003, p. 93.
[10] Brian D. Lepard, Rethinking Humanitarian Intervention : A Fresh Approach Based on Fundamental Ethical Principles in International Law and World Religions, University Park, Pennsylvania State University Press 2002, p. XI.
[11] . Christopher Greenwood, « Is There a Right of Humanitarian Intervention ? », The World Today, 49 (2), 1993, p. 34.
[12] . M. Finnemore, The Purpose of Intervention : Changing Beliefs about the Use of Force, op. cit., p. 53.
[13] . Simon Caney, « Humanitarian Intervention and State Sovereignty », dans Andrew Valls (ed.), Ethics in International Affairs : Theories and Cases, Lanham, Rowman & Littlefield Publishers, 2000, p. 119.
[14] . Alex J. Bellamy, Just Wars. From Cicero to Iraq, Cambridge, Polity Press, 2006, p. 141-142.
[15] . Michel Terestchenko, Du bon usage de la torture, ou comment les démocraties justifient l’injustifiable, Paris, La Découverte, 2008.
[16] . J.-B. Jeangène Vilmer, « Humanitarian Intervention and Disinterestedness », art. cité.
[17] . P. Singer, One World : The Ethics of Globalization, op. cit..
[18] . Voir la jurisprudence des chambres de première instance du TPIY (1998, 2001), de la Chambre des Lords britannique (arrêt Pinochet du 24 mars 1999) et de la Cour européenne des droits de l’homme : « L’interdiction de la torture est devenue une règle impérative du droit international » (arrêt Al Adsani c/Royaume-Uni du 21 novembre 2001, § 61).
[19] . John M. Taurek, « Should the Numbers Count ? », Philosophy and Public Affairs, 6 (4), 1977, p. 293-316.
[20] . J.-B. Jeangène Vilmer, « La responsabilité de protéger et le débat sur la qualification de génocide au Darfour », dans La responsabilité de protéger, Actes du 41e colloque annuel de la Société française pour le droit international (SFDI), Paris, Pédone, 2008, p. 233-241.
[21] . Commission internationale de l’intervention et de la souveraineté des États (CIISE), La responsabilité de protéger, Ottawa, Centre de recherches pour le développement international, 2001, p. 35.
[22] J.-B. Jeangène Vilmer, « Quand intervenir ? Le critère du dernier recours dans la théorie de l’intervention humanitaire armée », Raisons politiques, 2012 (à paraître).
[23] . Report of the International Commission of Inquiry on Darfur to the United Nations Secretary-General, Genève, 25 janvier 2005, § 522.
[24] . Ariel Colonomos, Le pari de la guerre. Guerre préventive, guerre juste ?, Paris, Denoël, 2009, p. 76-106.
[25] . Harold Koh, « Comment », dans Michael W. Doyle, Striking First. Preemption and Prevention in International Conflict, Princeton, Princeton University Press, 2008, p. 106.
[26] . Michael Walzer, Guerres justes et injustes : argumentations morales avec exemples historiques, Paris, Gallimard, 2006, p. 592.
[27] . Nicholas J. Wheeler, Justin Morris, « Justifying the Iraq War as a Humanitarian Intervention : The Cure is Worse than the Disease », dans Ramesh Thakur, Waheguru Pal Singh Sidhu (eds), The Iraq Crisis and World Order : Structural, Institutional and Normative Challenges, Tokyo, United Nations University Press, 2006, p. 445.
[28] . J.-B. Jeangène Vilmer, « L’intervention humanitaire armée en Chine antique », Revue des deux mondes, janvier 2006, p. 152-173.
[29] . Anthony D’Amato, « The Invasion of Panama Was a Lawful Response to Tyranny », American Journal of International Law, 84, 1990, p. 519. Voir également Michael W. Reisman, « Coercion and Self-Determination : Construing Charter Article 2(4) », American Journal of International Law, 78, 1984, p. 642, et la réponse d’Oscar Schachter, « The Legality of Pro-Democratic Invasion », ibid., p. 645.
[30] . Fernando R. Tesón, « Ending Tyranny in Iraq », Ethics & International Affairs, 19 (2), 2005, p. 1-20.
[31] . Ryoa Chung, « Approches normatives des relations internationales », dans Ludivine Thiaw-Po-Une (dir.), Questions d’éthique contemporaine, Paris, Stock, 2006, p. 684.
[32] . N. J. Wheeler, « The Humanitarian Responsibilities of Sovereignty : Explaining the Development of a New Norm of Military Intervention for Humanitarian Purposes in International Society », dans Jennifer M. Welsh (ed.), Humanitarian Intervention and International Relations, Oxford, Oxford University Press, 2003, p. 36.
[33] . Kok-Chor Tan, « The Duty to Protect », dans Terry Nardin, Melissa Williams (eds), Humanitarian Intervention, Nomos XLVII, New York, New York University Press, 2006, p. 93.
[34] . Stéphane Courtois, « La guerre en Irak peut-elle être justifiée comme un cas d’intervention humanitaire ? », Les ateliers de l’éthique, 1 (1), 2006, p. 10.
[35] . Tom J. Farer, « An Inquiry into the Legitimacy of Humanitarian Intervention », dans Lori Fisler Damrosch, David J. Scheffer (eds), Law and Force in the New International Order, Boulder, Westview Press, 1991, p. 198.
[36] . M. Walzer, Guerres justes et injustes : argumentations morales avec exemples historiques, op. cit., p. 589.
[37] . J.-B. Jeangène Vilmer, « Écarter le tyran pour protéger la population », Le Temps, 6 avril 2011.
[38] . N. J. Wheeler, J. Morris, « Justifying the Iraq War as a Humanitarian Intervention : The Cure is Worse than the Disease », cité, p. 445.
[39] . Speech by Prime Minister Tony Blair at Labour’s local government, women’s and youth conferences, 15 février 2003.
[40] . Taylor B. Seybolt, Humanitarian Military Intervention : The Conditions for Success and Failure, Oxford, Oxford University Press, 2007, p. 6-7.
[41] . Daniele Archibugi, « Cosmopolitan Guidelines to Humanitarian Intervention », Alternatives : Global, Local, Political, 29 (1), 2004, p. 18.
[42] . Bill Clinton, Remarks to the White House Conference on Africa, 27 juin 1994, Weekly Compilation of Presidential Documents, 30 (26), 4 juillet 1994, p. 1364.
[43] . Bruce Reichenbach, « Natural Evils and Natural Laws : A Theodicy for Natural Evils », International Philosophical Quarterly, 16 (2), 1976, p. 179.
[44] . Thérèse Delpech, L’ensauvagement. Le retour de la barbarie au XXIe siècle, Paris, Grasset, 2005, p. 40, note 2.
[45] . Christiane Vollaire, Humanitaire, le cœur de la guerre, Paris, L’insulaire, 2007, p. 32.
[46] . Craig Calhoun, « A World of Emergencies : Fear, Intervention, and the Limits of Cosmopolitan Order », Canadian Review of Sociology and Anthropology, 41 (4), 2004, p. 383.
[47] . Ken Booth, Theory of World Security, Cambridge, Cambridge University Press, 2007, p. 189.
[48] . CIISE, La responsabilité de protéger, op. cit., p. 38, § 4.20.
[49] . Gareth Evans, The Responsibility to Protect : Ending Mass Atrocity Crimes Once and For All, Washington, D. C., Brookings Institution Press, 2008, p. 65-68 ; Eric A. Heinze, Waging Humanitarian War : The Ethics, Law, and Politics of Humanitarian Intervention, Albany, State University of New York Press, 2009, p. 47.
[50] . Tim Ogden, « When Do We Start Calling It Genocide ? », Philanthropy Action, 26 mai 2008 (http://www.philanthropyaction.com/n...).
[51] . Bernard Kouchner, France 2, journal de 20h, 7 mai 2008.
[52] . Conférence de presse conjointe de Monsieur Bernard Kouchner, ministre des Affaires étrangères et européennes, et de Madame Heidemarie Wieczorek-Zeul, ministre allemande de la Coopération économique et du Développement, 7 mai 2008.
[53] . Le Monde, 15 mai 2008, p. 4.
[54] . Ramesh Thakur, Thomas G. Weiss, « R2P : From Idea to Norm - and Action ? », Global Responsibility to Protect, 1 (1), 2009, p. 48.
[55] . BBC News, 9 mai 2008.
[56] . The Guardian, 9 mai 2008.
[57] . B. Kouchner, « À vous de juger », France 2, 15 mai 2008, et, pour une précision de son propos, Europe 1, 19 mai 2008.
[58] . Le Point, 17 mai 2008.
[59] . B. Kouchner, « À vous de juger », cité.
[60] . UN Doc. AG/10705, 18 avril 2008.
[61] . Le Monde, 20 mai 2008, p. 16.
[62] . J.-B. Jeangène Vilmer, « De la mythologie française du droit d’ingérence à la responsabilité de protéger : une clarification terminologique », Annuaire français de relations internationales, 13, 2012 (à paraître).
[63] . Françoise Bouchet-Saulnier, Le Monde, 22 mai 2008, p. 18.
[64] . R. Thakur, T. G. Weiss, « R2P : From Idea to Norm - and Action ? », art. cité, p. 48-49.
[65] . A. J. Bellamy, « The Responsibility to Protect and the Problem of Military Intervention », International Affairs, 84 (4), 2008, p. 617.
[66] . G. Evans, « La responsabilité de protéger ne doit pas être l’apanage des seuls grands pays occidentaux », Le Temps, 12 mars 2009.
[67] . G. Evans, « Facing Up to Our Responsibilities », The Guardian, 12 mai 2008.
[68] . G. Evans, « La responsabilité de protéger ne doit pas être l’apanage des seuls grands pays occidentaux », art. cité.
[69] . Jean-Maurice Ripert, déclaration à la presse, 7 mai 2008.
[70] . Asia-Pacific Centre for the Responsibility to Protect, Cyclone Nargis and the Responsibility to Protect, Myanmar/Burma Briefing n°2, 16 mai 2008 (http://www.r2pasiapacific.org/docum...), p. 8.
[71] . Amartya Sen, Poverty and Famines : An Essay on Entitlement and Deprivation, Oxford, Oxford University Press, 1981, p. 40.
[72] . Nigel Dower, « Violent Humanitarianism - An Oxymoron ? », dans Alexander Moseley, Richard Norman (eds), Human Rights and Military Intervention, Aldershot, Ashgate, 2002, p. 89.
[73] . Henry Shue, Basic Rights : Subsistence, Affluence, and U.S. Foreign Policy, Princeton, Princeton University Press, 1980.
[74] . Seumas Miller, « Collective Responsibility and Armed Humanitarian Intervention », dans Tony Coady, Michael O’Keefe (eds), Righteous Violence : The Ethics and Politics of Military Intervention, Melbourne, Melbourne University Press, 2005, p. 54.
[75] . David Marcus, « Famine Crimes in International Law », American Journal of International Law, 97 (2), 2003, p. 245-281.
[76] . Ibid., p. 247.
[77] . CIISE, La responsabilité de protéger, op. cit., p. 37, § 4.20.
[78] . La R2P est beaucoup plus large que la notion d’ingérence ou d’intervention. D’abord, il ne s’agit pas seulement d’intervenir mais, insiste la CIISE, de prévenir, intervenir et reconstruire. Ensuite, l’intervention n’est, le cas échéant, pas nécessairement militaire, elle ne l’est même qu’en dernier recours. Dans son rapport de 2009 sur la mise en œuvre de la R2P, le Secrétaire général identifie trois « piliers » et l’intervention militaire ne concerne que le troisième, intitulé « Réaction résolue en temps voulu », pas les deux premiers, qui sont respectivement « Les responsabilités de l’Etat en matière de protection » et « Assistance internationale et renforcement des capacités » (UN Doc. A/63/677, 12 janvier 2009).
[79] . UN Doc. S/RES/767, 1992, § 2.
[80] . R. Thakur, « To Invoke or not to Invoke R2P in Burma », The Hindu, 20 mai 2008.
[81] . Ibid., p. 37, § 4.19.
[82] . Michael E. O’Hanlon, Stephen J. Solarz, « Deciding When to Go », The Washington Post, Outlook Section, 7 février 1999, p. B1, et S. J. Solarz, M. E. O’Hanlon, « Humanitarian Intervention : When Is Force Justified ? », The Washington Quarterly, 20 (4), 1997, p. 3-14.
[83] . Alan J. Kuperman, « Transnational Causes of Genocide : Or How the West Inadvertently Exacerbates Ethnic Conflict », dans Raju G. C. Thomas (ed.), Yugoslavia Unraveled : Sovereignty, Self-Determination, Intervention, Lanham, Lexington Books, 2003, p. 74 et p. 84, note 60.
[84] . Barbara Harff, Genocide and Human Rights : International Legal and Political Issues, Denver, Graduate School of International Studies, University of Denver, 1984, p. 12 ; CIISE, La responsabilité de protéger, op. cit., p. 38, § 4.21.
[85] . E. A. Heinze, Waging Humanitarian War : The Ethics, Law, and Politics of Humanitarian Intervention, op. cit., p. 46.
[86] . Ibid., p. 49.
[87] . J.-B. Jeangène Vilmer, « La responsabilité de protéger et le débat sur la qualification de génocide au Darfour », cité.
[88] . Anthony Lang, Punishment, Justice and International Relations : Ethics and Order after the Cold War, Londres, Routledge, 2008, p. 59-62.
[89] . K. Booth, « Military Intervention : Duty and Prudence », dans Lawrence Freedman (ed.), Military Intervention in European Conflicts, Oxford, Blackwell, 1994, p. 68.
[90] . E. A. Heinze, Waging Humanitarian War : The Ethics, Law, and Politics of Humanitarian Intervention, op. cit., p. 44-45.
[91] . Kenneth R. Himes, « The Morality of Humanitarian Intervention », Theological Studies, 55 (1), 1994, p. 82-105, et Stanley Hoffmann, « The Politics and Ethics of Military Intervention », Survival, 37 (4), 1995-1996, p. 29-51.
[92] . J.-B. Jeangène Vilmer, « Éthique et politique de l’intervention humanitaire armée », art. cité, p. 177-181.
[93] . Pierre Hassner, « Des dilemmes de l’action aux contradictions des institutions : les ambiguïtés de l’ordre », dans Gilles Andréani, Pierre Hassner (dir.), Justifier la guerre ? De l’humanitaire au contre-terrorisme, Paris, Presses de Sciences Po, 2005, p. 339, et P. Hassner, La violence et la paix. De la bombe atomique au nettoyage ethnique, Paris, Le Seuil, 2000, p. 320.


