L’Afrique face à la justice pénale internationale
Le Monde.fr, 12 juillet 2011
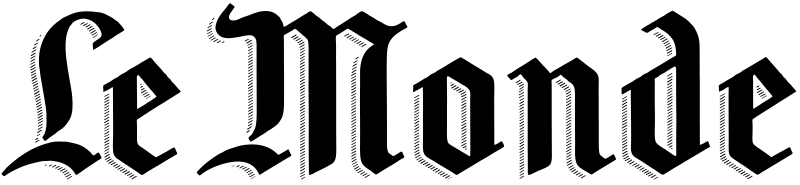
L’Afrique a trente et un Etats parties au Statut de Rome, qui ont donc l’obligation de coopérer avec la Cour. Lorsque celle-ci est saisie par le Conseil de sécurité, cette obligation est même étendue à tous les Etats membres de l’ONU. La résistance de l’Afrique est un révélateur d’au moins deux des problèmes auxquels la justice pénale internationale est aujourd’hui confrontée.
Dans une résolution du 1er juillet 2011, l’Union africaine (UA) "décide que les Etats membres ne coopéreront pas à l’exécution du mandat d’arrêt" contre Kadhafi et demande au Conseil de sécurité de l’ONU d’"annuler le processus de la CPI [Cour pénale internationale] sur la Libye". Ce faisant, elle poursuit une politique entamée exactement deux ans plus tôt en réaction au mandat d’arrêt émis contre le président soudanais. Plusieurs Etats africains parties au Statut de Rome avaient alors accueilli Omar Al-Bashir au lieu de l’arrêter (Tchad, Kenya, Djibouti).
Comment comprendre ce camouflet fait à la justice pénale internationale ? L’Afrique a trente et un Etats parties au Statut de Rome, qui ont donc l’obligation de coopérer avec la Cour. Lorsque celle-ci est saisie par le Conseil de sécurité, cette obligation est même étendue à tous les Etats membres de l’ONU. La résistance de l’Afrique est un révélateur d’au moins deux des problèmes auxquels la justice pénale internationale est aujourd’hui confrontée.
Le premier est le dilemme classique de la paix et de la justice. En sortie de conflit armé, ceux avec lesquels il faut négocier pour obtenir un cessez-le-feu sont souvent les mêmes qui ont commis des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité, voire un génocide. Il faut alors choisir entre les poursuivre, au nom de la justice, ou les intégrer au processus de transition, au nom de la paix. On assiste généralement à l’affrontement de deux écoles.
D’un côté, les politiques, les diplomates et les négociateurs donnent la priorité à la paix : ils craignent notamment que des poursuites judiciaires à l’encontre des personnes soupçonnées d’avoir commis des crimes nuisent à l’obtention d’un cessez-le-feu. Ils leur proposent donc des amnisties officielles ou des arrangements secrets. De l’autre, les défenseurs des droits de l’homme et les représentants des institutions judiciaires internationales donnent la priorité à la justice : ils pensent qu’une paix achetée par l’impunité est illusoire et provisoire, et que la justice peut avoir un effet pacificateur, en dissuadant des crimes futurs.
En résistant à la CPI, l’UA se situe clairement dans la première catégorie. Dans un cas comme dans l’autre, au Soudan comme en Libye, elle se justifie en invoquant la priorité de la paix sur la justice. L’inculpation d’Al-Bashir était décrite en 2009 comme "une action contre-productive qui ne fera pas avancer le processus de paix" et qui pouvait même accroître "le risque de coup d’Etat militaire et d’anarchie généralisée au Soudan". Aujourd’hui, l’UA justifie son opposition à la CPI dans les mêmes termes : "le mandat d’arrêt (…) complique sérieusement les efforts visant à trouver une solution politique négociée à la crise en Libye." C’est une vieille rengaine qu’on nous sert depuis les tribunaux ad hoc des années 1990. Les politiques craignaient que l’arrestation de Milosevic déclenche des "torrents de sang", que celle de Mladic provoque des "attentats terroristes". Le TPIY (Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie) était perçu par beaucoup comme une grave menace contre la paix et la sécurité.
Ce qui est intéressant est qu’il avait été créé par ces mêmes Etats au nom de la paix et de la sécurité. Voilà donc le paradoxe : d’un côté, on crée des tribunaux parce que la justice contribuerait à la paix, parce qu’il n’y aurait "pas de paix sans justice". De l’autre, on les empêche de fonctionner parce que la justice nuirait à la paix, parce qu’il n’y aurait "pas de justice sans paix".
L’histoire a donné tort aux alarmistes : le TPIY n’a pas transformé les Balkans en bain de sang et le mandat d’arrêt contre Al-Bashir n’a pas déclenché de guerre civile au Soudan. La menace que la justice ferait peser contre la paix est largement exagérée, car elle dissimule en réalité d’autres motifs. La solidarité panafricaine qui s’est développée autour d’Al-Bashir n’est pas le résultat d’une indignation sincère mais d’une crainte commune d’être les prochains sur la liste.
Le second problème que révèle la résistance de l’UA est le sentiment que la justice pénale internationale est biaisée, qu’elle est une justice des vainqueurs, des puissants sur les faibles, voire des Blancs sur les Noirs.
Le fait que les six situations actuellement devant la CPI sont africaines conjugué aux efforts entrepris par les occidentaux pour immuniser leurs propres troupes suscite une grande méfiance en Afrique. Quid des crimes commis par la Russie en Tchétchénie, par les Etats-Unis et l’Angleterre en Irak et en Afghanistan, par Israël en Palestine et au Liban ? Le président de la Commission de l’UA vient de répéter ce qu’il avait déjà dit suite à l’inculpation d’Al-Bashir : "[Le Procureur] ne condamne que des Africains, il ne juge que des Africains. (…) Il n’y a qu’en Afrique qu’il y a des problèmes ?". C’est une question légitime, même s’il est certain qu’une partie au moins des chefs d’Etat africains manipule l’épouvantail du néocolonialisme pour décrédibiliser le glaive qui les menace.
Reprocher au procureur de ne s’en prendre qu’aux Africains est exagéré puisqu’il n’est à l’origine que d’une des six situations devant la Cour. Ce sont les Etats africains eux-mêmes qui ont saisi la CPI dans la majorité des autres situations. Les sondages montrent d’ailleurs que, si leurs dirigeants sont frileux, la population africaine soutient largement le travail de la justice pénale internationale.
Quoiqu’il en soit, cette suspicion d’une justice biaisée existe et permet aujourd’hui à l’UA de justifier son absence de coopération. Il faut la prendre au sérieux et, sans détourner la Cour du continent africain, faire en sorte qu’elle s’intéresse à d’autres lieux. Il devient urgent d’ouvrir des enquêtes contre des nationaux non africains, y compris des occidentaux si des preuves existent contre eux, pour renforcer la légitimité de la CPI. La justice internationale doit paraître juste pour être efficace.


