Les interventions militaires en débat 3/4 : L’intervention en Libye (2011)
La Chronique. Mensuel d’Amnesty International France, mars 2012, p. 22-23.
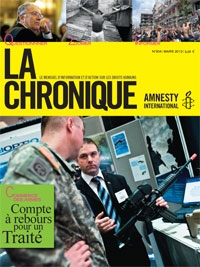
En dépit des réticences de certains Etats et d’une partie de l’opinion, l’intervention en Libye marque la fin de l’éclipse de l’intervention humanitaire de la première décennie du XXIe siècle, et constitue la première intervention humanitaire au sens classique du terme, c’est-à-dire sans le consentement de l’Etat cible, depuis le Kosovo.
En mettant les démocraties occidentales au pied du mur, le printemps arabe de 2011 a ravivé l’interventionnisme humanitaire. Suite à l’utilisation d’armes lourdes par le régime libyen contre sa population, notamment pour bombarder les manifestants à Tripoli le 21 février 2011, le Conseil de sécurité dans sa résolution 1970 du 26 février estime « que les attaques systématiques et généralisées » commises « contre la population civile pourraient constituer des crimes contre l’humanité » et il saisit la Cour pénale internationale (CPI). Deux semaines et demi plus tard, il vote la résolution 1973 autorisant les Etats membres qui en ont fait la demande « à prendre toutes mesures nécessaires (…) pour protéger les populations et les zones civiles menacées d’attaque en Jamahiriya arabe libyenne, y compris Benghazi, tout en excluant le déploiement d’une force d’occupation étrangère sous quelque forme que ce soit et sur n’importe quelle partie du territoire libyen ». Ce qui a surpris bien des observateurs est la rapidité de réaction du Conseil de sécurité, surtout si on la compare avec le cas du Darfour, et le fait qu’une résolution autorisant une intervention armée soit passée sans susciter aucun vote contre – seulement cinq abstentions – et en particulier aucun veto des deux Etats traditionnellement anti-interventionnistes, la Chine et la Russie. Cela s’explique en partie par le soutien de la Ligue arabe et le fait que trois Etats africains membres du Conseil de sécurité (Nigéria, Gabon et Afrique du Sud) aient voté pour en dépit du communiqué du Conseil de paix et de sécurité de l’Union Africaine qui, seulement sept jours plus tôt, rejetait « toute intervention militaire étrangère, quelle qu’en soit la forme ».
En dépit des réticences de certains Etats et d’une partie de l’opinion, l’intervention en Libye marque la fin de l’éclipse de l’intervention humanitaire de la première décennie du XXIe siècle, et constitue la première intervention humanitaire au sens classique du terme, c’est-à-dire sans le consentement de l’Etat cible, depuis le Kosovo.
Elle reste toutefois l’exception plutôt que la norme, pour au moins trois raisons. La première est la grande clarté de la menace : depuis le Rwanda, l’intention de commettre des crimes contre l’humanité ne s’était pas énoncée aussi clairement que lorsque Kadhafi annonce publiquement que « des officiers ont été déployés dans toutes les tribus et régions pour purifier toutes les décisions de ces cafards », que « tout Libyen qui prendra les armes contre la Libye sera exécuté » et, le jour même de la résolution du Conseil de sécurité, appelle ses supporters à « nettoyer la ville de Benghazi ». Il est crédible, étant donné son bilan en matière de violations des droits de l’homme depuis des décennies et le fait que les violences auraient déjà fait entre 1 000 et 10 000 victimes en quelques semaines. La mens rea est rarement aussi limpide.
La deuxième raison est la nature imprévisible et précipitée des exactions. Paradoxalement, les crises identifiées et surveillées mobilisent moins car elles surprennent moins. Personne n’avait prévu que des crimes de masse pourraient avoir lieu en Libye dans un délai si court et le Conseil de sécurité a voté la résolution autorisant l’intervention sous la pression de l’imminence d’un assaut annoncé sur Benghazi. La troisième raison est le consensus, et en particulier le soutien des Etats du Conseil de coopération du Golfe, de l’Organisation de la coopération islamique et de la Ligue arabe.
La nature exceptionnelle du cas libyen découle de l’improbabilité que ces trois facteurs soient de nouveau réunis. Et quand bien même le seraient-ils en tout ou partie, la conjoncture politique, les intérêts des Etats potentiellement intervenants et les risques causés par l’intervention seraient, eux, probablement différents, et pourraient donc motiver une réaction différente comme en témoigne le cas syrien. Nous sommes donc toujours dans une approche au cas par cas plutôt que dans l’inéluctable construction d’une norme interventionniste.
Officiellement, l’intervention de l’OTAN en Libye (24 mars – 31 octobre 2011) était « seulement » humanitaire. La résolution du Conseil de sécurité n’autorisait les Etats intervenants à prendre toutes les mesures nécessaires que « pour protéger les populations et zones civiles menacées d’attaque ». Il n’était pas question de renverser un dictateur, encore moins d’imposer la démocratie, et en général les responsables politiques et militaires se gardaient bien de prétendre le contraire. Mais, en même temps qu’ils reconnaissaient la limite de leur mandat, ils étaient également unanimes pour souhaiter le départ de Kadhafi. Comment comprendre cette articulation ?
L’intervention est humanitaire dans sa fin mais politique dans son moyen. Les Etats intervenants faisaient hier encore des affaires avec Kadhafi et n’avaient aucun intérêt à renverser un si bon client. Il a fallu que le printemps arabe s’en mêle pour que le dictateur devenu fréquentable redevienne « sanguinaire ». Il fallait donc que Kadhafi parte. Dire cela, ce n’était pas être un faucon néo-conservateur faisant du changement de régime une cause juste en soi. C’était au contraire le considérer comme un moyen de satisfaire la cause juste, qui était la protection des civils. La question était simple : pouvait-on protéger les civils sans renverser Kadhafi ? Après qu’il ait ordonné le bombardement des manifestants à Tripoli, menacé de « nettoyer » Benghazi, et même d’attaquer des objectifs civils en Méditerranée ? Non, puisqu’il était à l’origine de la menace qui pesait sur eux.
La résolution autorisait les intervenants à prendre « toutes les mesures nécessaires » pour protéger les civils. Le renversement de Kadhafi était l’une de ces mesures nécessaires. Pas comme une fin en soi – c’est pourquoi il ne s’agissait pas d’une intervention pro-démocratique – mais comme un moyen. D’ailleurs rien ne garantit que le régime suivant sera démocratique. On peut toutefois supposer qu’il le sera davantage, et cela suffit à le préférer.
[encadré] La mort de Kadhafi
Le rôle de l’OTAN dans la mort de Kadhafi le 20 octobre 2011 a suscité de nombreuses interrogations. On a cru, dans un premier temps, alors que les informations arrivaient au compte-gouttes, que Kadhafi avait été tué par un raid de l’OTAN qui aurait donc été un assassinat ciblé – comme dans le cas de Ben Laden. Ce n’était pas le cas puisqu’il est mort dans les mains du CNT. Reste qu’il ne serait peut-être pas tombé ce jour-là si son convoi n’avait pas été attaqué par les avions français. Et que penser de ce tir ? Le mandat de l’OTAN était de protéger les civils. Mais, dans un pays conquis à 99% par le CNT, ces quelques fuyards loyalistes faisaient-ils courir un risque important à la population ? C’est une chose de tirer sur une colonne de blindés qui se dirigent vers une ville pour la « nettoyer », selon les propres mots du colonel. C’en est une autre de tirer sur une colonne de véhicules qui fuient une ville. Pour que le tir soit légal, il faudrait pouvoir prouver qu’il était une « mesure nécessaire » pour protéger la population. C’est ici que l’interprétation extensive de la résolution 1973 est utile, en affirmant que neutraliser Kadhafi est indirectement une mesure nécessaire pour protéger la population. Voilà comment l’exemple libyen montre que le changement de régime peut être un moyen, non une fin, de l’intervention humanitaire.


