Lamartine et Pie IX : la France face à la question nationale italienne en 1846-1849
Revue historique de droit français et étranger, 84:1, 2006, 71-85.
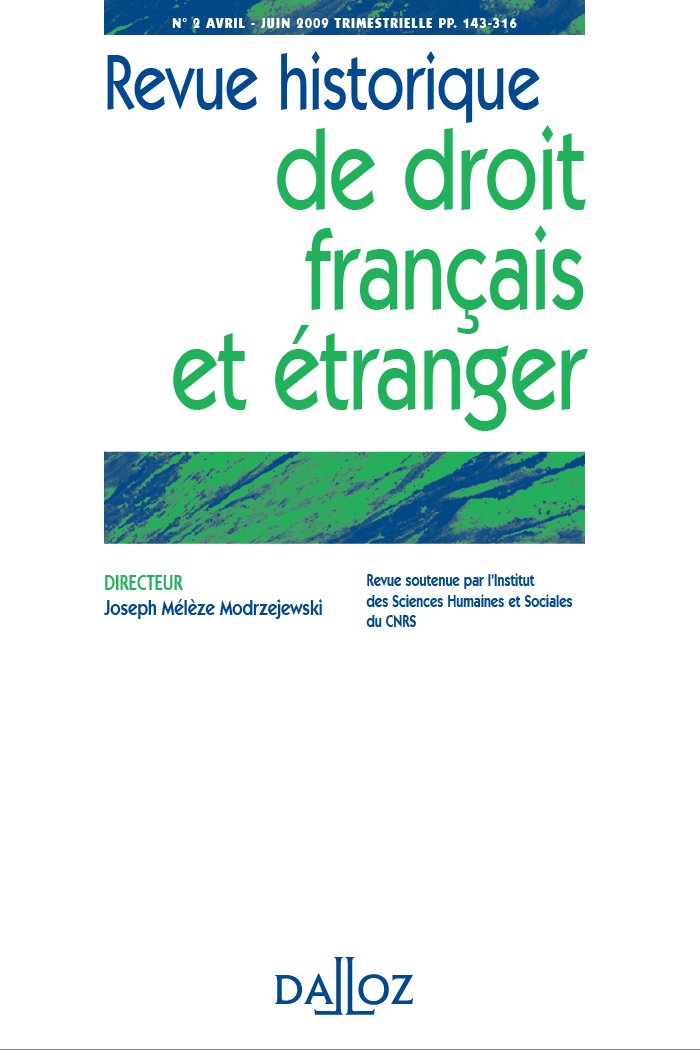
L’élection de Pie IX, en juin 1846, est une occasion donnée à l’Italie d’évaluer la solution néo-guelfe de l’unité sous l’égide du Saint-Siège, et la question nationale italienne qui agite alors la péninsule ne laisse pas la France indifférente. De l’autre côté des Alpes, Alphonse de Lamartine, attentif depuis toujours à tout ce qui touche l’Italie et la religion, acteur de la révolution de 1848, comprend aussitôt l’importance des événements italiens pour l’équilibre européen. Il prend position contre le néo-guelfisme et jouera, pendant deux ans, un rôle déterminant dans les relations franco-italiennes. Après avoir présenté la situation de l’Italie de 1846 à 1848 à travers le prisme de Pie IX, du mythe du « pape libéral » à celui de « pape traître », nous analysons les positions respectives de Lamartine et de la diplomatie française sur les affaires d’Italie. D’abord, Lamartine s’oppose à la politique étrangère de Guizot. Ensuite, pendant trois mois au pouvoir en 1848, il soutient la révolution italienne et dresse son « armée des Alpes ». Et, l’année suivante, il défend plus que jamais la République romaine et s’oppose au rétablissement du pouvoir temporel de la papauté.
A la chute de l’Empire français, dans une Europe disloquée, désordonnée et encore fumante des guerres napoléoniennes, le Congrès de Vienne de 1815 divise l’Italie en huit États, dont quatre sont sous l’influence de l’Autriche. En cette période de trouble, les idées fédératives progressent rapidement. Un prêtre piémontais, exilé à Bruxelles depuis 1833, Vincenzo Gioberti, publie en 1843 un ouvrage qui aura une certaine influence : Del primato morale e civile degli Italiani. L’idée est de fédérer les souverains italiens sous la présidence du pape, avec l’appui militaire du Piémont pour s’affranchir de l’Autriche. Le nom de « néo-guelfe » est donné à cette solution – une référence à la résistance face à l’envahisseur germanique qui n’est pas anodine alors que l’Autriche occupe le nord de la Péninsule. Il ne manque plus à cette solution néo-guelfe de l’unité sous l’égide du Saint-Siège que le pape à la hauteur du projet : et c’est précisément ce qui arrive, pense-t-on, avec l’avènement de Pie IX en juin 1846. Populaire et jouissant d’une réputation de libéral, on voit volontiers en lui le futur dirigeant d’une fédération italienne. L’idée prend corps. Lamartine prend position.
Lorsqu’il quitte Paris le 24 juin 1847, Alphonse de Lamartine est l’un des hommes les plus populaires de France : la parution des deux premiers volumes de son Histoire des Girondins le 20 mars eut un succès historique. Le pays est en ébullition. La campagne des banquets, auxquels sont conviés des députés réformistes, commence et va conduire à l’effondrement du régime. Le 18 juillet, Lamartine, radical, est invité sur ses terres, à Mâcon, où il prédit la « Révolution du mépris ». Fin août, à Marseille, il fait sept discours en une semaine. L’année 1847 est celle de la veillée d’arme. Sa plume, cependant, à l’aube de la révolution de 1848, n’est pas toute à la France. Lamartine, poète, homme d’État et diplomate, regarde de l’autre côté des Alpes. Il observe en Europe l’orage avancer, et couche sur le papier des réflexions crépusculaires.
Celles qui nous occupent ici interrogent l’articulation complexe entre l’Église et la modernité. La question se pose depuis un demi-siècle. L’Église catholique peut-elle s’adapter aux libertés civiles et religieuses posées par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ? L’Église catholique et le monde issu de la Révolution sont-ils conciliables ? L’élection de Pie IX, en 1846, est l’occasion d’y répondre. Lamartine, naturellement, s’y intéresse. Le thème, en effet, est à la croisée de deux domaines privilégiés dans la pensée de l’auteur : l’Italie et la religion. Le diplomate, qui avait déjà séjourné quatre fois dans la Péninsule avant 1847 et dont l’italianisme est connu, se définit lui-même comme « un enfant adoptif de ce grand pays » [1]. La religion, quant à elle, est une référence constante, instable et complexe dans son œuvre. Défendant un « christianisme rationnel » ou « rationalisme chrétien », il prend rapidement sa distance avec les institutions romaines et critique ouvertement le gouvernement temporel de la papauté. En l’espèce, Lamartine se prononce contre la solution néo-guelfe.
Attentif, donc, à ce qui touche l’Italie, d’une part, et la religion, d’autre part ; dans un contexte effervescent qui couve depuis un demi-siècle la question de l’articulation de l’Église catholique et de la modernité libérale issue de la Révolution ; à une période charnière de cette histoire, agitée par l’élection de Pie IX ; Lamartine, diplomate, honnête homme, se devait d’entrer dans le débat européen. Dans les lignes qui suivent, et afin de fixer le cadre de la critique lamartinienne du pouvoir temporel de la papauté [2], nous examinons les positions de Lamartine et de la diplomatie française face à la question nationale italienne durant les années 1846-1848.
A cette question on répond volontiers, dans la Péninsule, par la solution néo-guelfe, c’est-à-dire par un seul homme : Pie IX. Dès lors, deux problèmes se posent à l’analyste. Premièrement, qui est ce Pie IX ? Deuxièmement, que pense Lamartine du néo-guelfisme ? Quelle est, plus généralement, l’attitude de la France face à la question italienne et, surtout, quelle est l’attitude de Lamartine lui-même, d’abord dans l’opposition, ensuite au pouvoir ? Voyons cela, dans l’ordre.
A. – Le mirage Pie IX : du mythe du « pape libéral » à celui du « pape traître »
Le mythe Pie IX s’est essentiellement et d’abord construit sur les ruines du pontificat précédent : celui de Grégoire XVI, dont on ne retient guère que l’immobilisme, la rigidité et l’intransigeance. Dernier zelante, conservateur, réactionnaire, antirévolutionnaire et antimoderniste d’un « tempérament despotique » [3], dont le règne est qualifié de « pontificat malheureux » par Bonjean, il laisse un bilan difficile à son successeur : « Grégoire meurt, en juin 1846, laissant l’État de l’Église dans une situation désespérée » [4] ; « ce furent quinze ans de conjurations, d’émeutes périodiques, de répressions féroces, d’interventions étrangères, d’emprisonnements, d’exils, de condamnations, de supplices, et d’un obscurantisme » [5]. C’est également à l’issue du pontificat grégorien, à la veille de l’élection de Pie IX et au sujet de l’État pontifical que Capponi aurait dit : « Tel qu’il est, le gouvernement romain ne peut régir l’État, parce qu’il est réduit par la nécessité de sa nature à craindre toute réforme, à empêcher toute amélioration. On dirait que la justice est en lutte avec la religion » [6]. C’est précisément pour briser cette statue que Pie IX est élu.
Guizot parle de « l’abîme qui coupe le règne de Pie IX en deux époques vouées, l’une aux réformes et aux progrès, l’autre aux révolutions et aux problèmes » [7]. La ligne de partage est bien entendu l’année 1848. Conformément à cette dichotomie, deux axes apparaissent : la construction du mythe d’un « pape libéral » sur la pente ascendante de 1846 à 1848, d’abord, et, après la désillusion de 1848 qui est le point culminant et le pivot du graphique, l’élaboration du mythe inverse d’un « pape traître » sur la pente descendante postérieure, ensuite [8].
1) Le mythe du pape libéral : les premières années de pontificat (1846-1848)
Giovanni Maria Mastai Ferretti, pasteur d’Imola, acquiert rapidement une réputation de libéral en se montrant favorable à des réformes administratives et en ne s’opposant pas à la cause nationale italienne. Trois de ses frères, d’ailleurs, participent aux mouvements de 1831. Nommé cardinal en 1840, il envoie à Rome en 1845 des Pensieri relativi all’amministrazione pubblica dello Stato Pontifico, un inventaire des dysfonctionnements de l’administration pontificale, avec des suggestions pour l’améliorer. Qu’on ne s’y trompe pas, cependant : la position de Mgr Mastai Ferreti, qu’il qualifiait lui-même de « juste milieu chrétien » dans une lettre de 1833 adressée au cardinal Falconieri, est un moyen terme entre les zelanti et les libéraux, renvoyés dos à dos.
Son élection, le 16 juin 1846, semble s’opposer en tout à celle de son prédécesseur, et annoncer déjà une rupture. Il ne lui fallut que trois jours de conclave, contre cinquante pour Grégoire XVI. Le bruit court que son élection a bravé un veto autrichien (ce qui est faux), quand celle de Grégoire s’était faite au contraire avec l’appui de Metternich. Et c’est à Lambruschini lui-même, secrétaire d’État de Grégoire XVI à partir de 1836, qu’il est préféré. Enfin, c’est « pour affirmer symboliquement l’indépendance de la papauté vis-à-vis de toute forme d’interférence de la part des puissances étrangères » [9] que Mgr Mastai Ferreti, en hommage à Pie VII, prend le nom de Pie IX. Cette élection, en somme, est une formidable promesse ; et le peuple l’entend. Le nouveau pape est considéré comme « envoyé par Dieu pour conclure la grande affaire du XIXe siècle, l’alliance de la religion et de la liberté » [10]. Toute l’Italie l’encourage en scandant « Viva Pio nono ! Coragio Santo Padre ! ». « Courage, Saint-Père ! » dit aussi M. Thiers à la tribune française [11]. Lamartine lui-même est rempli d’espérance : « L’action vitale qui se réveille non révolutionnairement mais organiquement en Italie me fait espérer ne belle renaissance pour votre adorable patrie. (…) Le pape nouveau me paraît une révélation italienne. Nous le saluons ici de tous nos applaudissements » [12]. Pie IX devient le symbole du Réveil italien.
A peine élu, le pape prend quelques mesures libérales, entame quelques réformes, autant de signes qui trompent l’opinion. D’autant plus que, le plus souvent, Pie IX fait ses réformes contre la majorité des prélats romains, ce qui accentue sa singularité et son charisme. Il accorde d’abord une amnistie politique (16 juillet 1846) et nomme une commission chargée d’examiner les réformes nécessaires à l’État pontifical (juillet 1846). Quelques mois plus tard, pourtant et déjà, l’encyclique Qui pluribus condamne les principes du libéralisme (9 novembre 1846). Pie IX prévient son peuple : c’est en s’inscrivant dans la continuité et en s’opposant à la dérive libérale qu’il réformera l’Etat. On n’y prend pas garde. On préfère se féliciter de la modernisation en marche du pays, avec l’adoption au même moment d’un plan d’équipement ferroviaire (7 novembre 1846) – ce chemin de fer que Grégoire XVI appelait « chemin d’enfer », craignant qu’il n’apporte plus d’idées que de marchandises. Vient ensuite la réduction des tarifs douaniers (1er décembre 1846), qui donne lieu, le 30 août 1847, à un projet d’union douanière entre les souverains italiens, finalement signée entre le Piémont, la Toscane et le Saint-Siège (3 novembre 1847) – de quoi convaincre les néo-guelfistes qu’une confédération était en marche. Le pape s’attaque à l’accaparement des céréales (20 février 1847), assouplit la censure sur la presse (15 mars 1847) et réorganise certains tribunaux (1er, 14 et 30 janvier, 26 juin 1847). Il signe une convention commerciale avec la Sardaigne (3 juillet 1847), et forme une garde civique pour Rome et la province (5 et 30 juillet 1847).
Enfin, et c’est essentiel, il crée un conseil municipal à Rome (1er et 3 octobre 1847), un Conseil des ministres (12 juin 1847, réorganisé le 29 décembre 1847) et un conseil consultatif, Consulta di Stato (14 octobre 1847), de vingt-quatre membres, composé d’autant de laïques que d’ecclésiastiques, et accueillant également des libéraux et des réformateurs. Mais le peuple demande davantage : il veut une véritable constitution. Pie IX est réticent : il ne veut pas faire de l’État pontifical un État constitutionnel. C’est cédant à la pression populaire, quasiment contraint par elle et par les progrès réalisés en ce sens dans les autres États italiens, qu’il adopte le 14 mars 1848 le Statuto, qui transforme le Sacré Collège en Sénat, et le complète par deux Conseils, élus par le pape : l’Alto Consiglio (Haut-Conseil) et le Consiglio di Stato (Conseil d’Etat). Pour la première fois, le gouvernement pontifical, jusque là absolutiste, se dote d’institutions semi-représentatives.
Voilà donc pour les libéraux. Quant aux nationalistes, aux indépendantistes, aux patriotes, ils tombent également sous le charme de cette politique nouvelle, et insolente à l’égard de l’occupant autrichien. Metternich, d’ailleurs, ne s’y trompe pas, lui qui manifeste haut et fort sa désapprobation devant les réformes engagées [13]. Pie IX adopte le ruban tricolore vert-blanc-rouge (hérité de l’occupation française) sur la bannière pontificale, ce qui est considéré comme un acte symbolique de résistance à la menace autrichienne, et sa réaction très vive lors de l’incident de Ferrare (13 août 1847) est admirée en Italie comme en France. La popularité du pape s’accroît d’autant plus qu’il résiste à l’Autriche. Et lorsque, dans son discours du 10 février 1848, il appelle les bénédictions de Dieu sur « l’Italie », donnant ainsi une existence à ce qui n’était alors qu’une « expression géographique », selon le mot de Metternich, le peuple italien, imprudent, hâtif, et depuis trop longtemps contenu, voit aussitôt en lui le libérateur de la nation, de la patrie, de l’Italie. Un mois et demi plus tard paraît à Milan une revue patriotique, dirigée par Vincenzo De Castro, et intitulée simplement Pie IX.
« En dépit de plus d’un siècle de recul, on s’explique encore mal, de nos jours, le “miracle” de Pie IX » écrit A. C. Jemolo [14]. Ce miracle Pie IX qui éclabousse d’ailleurs jusqu’en France, puisque Guizot en fait l’un des « deux plus grands faits qui se soient accomplis de nos jours » à l’égard de la réconciliation de l’Église catholique avec la société moderne [15]. Au contraire, il nous semble que les raisons de l’euphorie collective du peuple italien pour ce début de pontificat sont claires, naturelles et connues. Le miracle de Pie IX entre 1846 et 1848 est simplement d’avoir mené une politique dont les signes extérieurs ont été radicalement interprétés par les deux groupes dont l’alliance ne constituait rien de moins que le Risorgimento lui-même : les libéraux et les patriotes. Le miracle de Pie IX entre 1846 et 1848 est d’avoir été l’apogée et le crépuscule du Risorgimento.
2) Le mythe du pape traître : Pie IX et le Quarantotto (1848-1850)
L’histoire de la période 1846-1848 est celle d’un quiproquo grandissant. Débordé par le succès du mouvement réformateur qu’il avait lui-même initié [16], face à une population interprétant toujours plus radicalement le moindre de ses gestes comme un manifeste libéral et nationaliste, Pie IX était simplement incompris. Mieux : l’illusion grandissait chaque jour, le mythe se fortifiait à chaque réforme ; le gouffre entre le pape réel et la représentation du pape dans l’opinion publique se creusait toujours davantage. Pie IX n’était plus que le reflet chimérique des fantasmes populaires. Il fallait bien, tôt ou tard, que le malentendu cesse, que le pape désenchante son peuple, au risque de le décevoir brutalement. D’autant plus que l’équivocité de sa politique, son ambiguïté, avait jusque là largement contribué au malentendu [17]. Et ce moment devait arriver quand le décalage entre les faits concédés par le souverain et les attentes de ses sujets serait visible par tous ; quand, finalement, le pape ne pourrait plus suivre son peuple.
Le Statuto de mars 1848 avait déçu. Considéré comme une demi-mesure arrivant trop tardivement, il ne correspondait déjà plus à l’attente des patriotes qui, encouragés par la révolution parisienne de février et les mouvements des autres États italiens, tournés vers l’Italie entière et non plus vers le seul État pontifical, demandaient au pape de diriger, sinon de participer, à une confédération pour accoucher, enfin, d’une nation unifiée. C’était, en somme, lui demander de participer à une guerre contre l’Autriche. Le 25 avril 1848, les ministres eux-mêmes, sous la signature d’Antonelli, présentent un mémoire au pape en faveur d’une telle participation. A cet instant précis, Pie IX ne pouvait plus suivre son peuple. Guizot le résume fort bien : « Il avait accepté la situation et la mission de pape réformateur. Il a repoussé celle de pape révolutionnaire » [18].
Ce refus s’exprime dans un discours de rupture, l’allocution consistoriale du 29 avril 1848, qui lève à jamais l’équivoque [19]. Solennellement, le pape déclare qu’il ne jouera aucun rôle dans la guerre contre l’Autriche, qu’il restera neutre. Pour les nationalistes italiens, c’est une véritable trahison. A partir de cet instant, Pie IX devient l’ennemi de la patrie (nemico della patria). On écoute Mazzini qui défend une révolution désincarnée : « Vous ne pouvez donc espérer fonder une nation qu’avec un homme ou avec un principe. Avez-vous l’homme ? (…) Faites qu’il surgisse et qu’il se révèle ; sinon, laissez-nous invoquer le principe ; n’entraînez point l’Italie à la remorque d’illusions pleines de larmes et de sang » [20].
La suite est connue. Le 15 novembre 1848, un signal est envoyé au pape : Rossi, au pouvoir depuis deux mois, est assassiné. La semaine suivante, Pie IX s’enfuit à Gaète, en territoire napolitain, sous un déguisement (24 novembre 1848). Un ministère provisoire, sous la présidence de Muzzarelli, se forme (23 décembre 1848), puis se dissout (3 janvier 1849). L’État pontifical devient le Stato romano. Le 21 janvier 1849, une Assemblée constituante est démocratiquement élue par environ 250.000 électeurs et, le 9 février 1849, la république romaine que rejoindront bientôt Mazzini et Garibaldi est proclamée par 120 des 142 députés présents. Le pouvoir temporel de la papauté est aboli.
Cette expérience brève et unique durera à peine cinq mois. Pie IX émet bientôt une protestation solennelle, qui est un appel à l’aide, auprès des puissances européennes (4 février 1849). La France l’entend – et nous verrons qu’elle l’attendait même depuis plusieurs années. Le 17 avril 1849, l’assemblée constituante française vote l’envoi d’une armée d’intervention à Civitavecchia, entre autres raisons parce que la France avait des intérêts financiers dans l’ancien État pontifical et pour précéder une éventuelle intervention de l’Autriche rivale dont la croissance pourrait être dangereuse pour la sécurité des frontières françaises elles-mêmes [21]. L’offensive du général Oudinot débute le 4 juin 1849. Un mois après exactement, les français entrent dans Rome [22], et rétablissent le pouvoir pontifical (15 juillet 1849). Le 12 avril 1850 Pie IX rentre à Rome avec l’aide de la France.
Seulement voilà : le pape est « traumatisé » [23]. S’affirme progressivement en lui la certitude qu’il existe un lien entre les malheurs de l’État pontifical et les valeurs libérales de la révolution française de 1789, autrement dit qu’il existe un lien entre l’épreuve qu’il vient de traverser et sa politique des années 1846-1848. Aussi change-t-il fondamentalement d’attitude. Méfiant, il se durcit, radicalise son discours, abandonne ses allures libérales et prend un nouveau secrétaire d’État, Antonelli. La suite de son pontificat sera dominée par deux mouvements : une défense assumée et explicite de l’intransigeance et une condamnation du libéralisme. Avec la chute de la solution néo-guelfe, c’est plus généralement l’influence de l’Église en politique qui s’amoindrit [24].
B. – Lamartine et la diplomatie française sur les affaires d’Italie : intervenir et ne pas intervenir
Lamartine soutient Pie IX contre la solution néo-guelfe. Le rejet de la solution néo-guelfe s’inscrit plus largement dans le rejet d’une solution interne au problème national italien. Et le raisonnement s’opère en deux temps. La question posée est : Qui pourrait-être l’acteur de « l’unité active, solide et indépendante de l’Italie » ?
Premièrement, il ne pourrait s’agir de l’un des États italiens, « Parce que, bien que l’Italie n’ait pas de véritables nationalités fortes, elle a encore les rivalités de ces nationalités qu’elle n’a plus ! (…) Elle a encore huit ou dix peuples dans un peuple, huit ou dix capitales dans un sol. Entre Naples, Palerme, Milan, Rome, Florence, Gênes, Venise, Turin, qui choisira ? Qui régnera ? Qui se subordonnera à l’autre ? (…) La difficulté d’une régénération de l’Italie sur le principe unitaire est là ! » [25]. C’est, en somme, le problème du pouvoir constituant, dans une extrapolation du principe juridique selon lequel on ne peut être à la fois juge et partie – partie dans les deux sens : un État italien est partisan, et (car) il n’est qu’une partie du tout qu’il s’agit de construire. Si donc l’acteur de l’unité italienne ne peut être l’une de ses parties, ce devrait être le tout lui-même : « Au moment où nous sommes, une seule chose est possible : la Confédération de toutes les puissances italiennes en un faisceau d’états indépendants pour leur régime intérieur, réunis pour leur défense et pour leur liberté commune ». Mais la difficulté reste la même, car il faudra un chef à cette confédération : « qui sera le lien du faisceau ? » [26].
Deuxièmement, donc, et pour les mêmes raisons, il ne pourrait s’agir d’un Italien. Et c’est à cet instant, dans ce contexte, que Lamartine examine la solution néo-guelfe. Pareille situation dans l’ordre de l’exposé est déjà une indication précieuse : la candidature du pape au poste de chef d’une confédération italienne, d’acteur de l’unité nationale, est rejetée à double titre. Un argument a priori et implicite, d’une part, semble dire : pas plus le pape qu’un autre italien – pour les raisons invoquées précédemment et permettant de conclure « pas plus un État italien qu’un autre ». Un argument a posteriori et explicite, d’autre part, à travers l’examen particulier de la solution néo-guelfe, permettra d’ajouter : encore moins le pape qu’un autre italien, encore moins l’État pontifical qu’un autre État italien. Lamartine, donc, rejette généralement une solution interne au problème national italien, et a fortiori, en l’espèce, une solution pontificale [27].
Lamartine défend le mouvement national italien, et critique donc les positions contre-révolutionnaires du cabinet français. Son attitude vis-à-vis de la France sur les affaires d’Italie évolue avec deux paramètres : selon, d’une part, qu’il est dans l’opposition ou au pouvoir et selon, d’autre part, la situation du mouvement italien lui-même. On peut ainsi distinguer trois phases successives. De l’élection de Pie IX, en 1846, à la révolution de février 1848, Lamartine est interventionniste : il s’oppose à Guizot et exige une intervention française pour soutenir la révolution italienne. Ensuite, durant ses trois mois au pouvoir en 1848, il met en œuvre cet interventionnisme en massant une armée au pied des Alpes et en menaçant d’intervenir militairement si le mouvement italien est menacé. Enfin, à partir du moment où, d’une part, il n’est plus au pouvoir (juin 1848) et où, d’autre part, l’insurrection républicaine à Rome a effectivement lieu (novembre 1848), Lamartine devient anti-interventionniste contre le cabinet français de Louis Napoléon Bonaparte qui souhaite intervenir à Rome pour rétablir le pouvoir temporel de la papauté. Résumons : intervenir pour soutenir la révolution avant qu’elle ait lieu, et ne pas intervenir contre elle quand elle a lieu.
1) 1846-1848 : Lamartine critique de Guizot
Guizot se méfie des agitations transalpines. Quelle est la véritable substance du mouvement italien ? Qu’est-ce qui se tient sous ? [28] « L’esprit national grandissait derrière l’esprit réformateur. L’esprit révolutionnaire grondait derrière l’esprit national » [29]. Voyons cela.
Premièrement, derrière l’action réformatrice de Pie IX, comme épiphénomène, il voit grandir le nationalisme. En un sens, il n’a pas tort. Le mouvement national préexistait à l’élection de Pie IX, mais fut littéralement catalysé par les réformes et l’attitude libérale du nouveau pontife. Lamartine lui-même parle d’un peuple fanatisé par son souverain [30]. Dans une dépêche à M. de la Rochefoucauld, citée par Lamartine à la tribune, Guizot reproche alors au gouvernement pontifical d’avoir entretenu l’espérance du peuple italien, de ne l’avoir pas désenchanté : « Nous avons plus d’une fois regretté que le Saint-Siège n’eût pas dès l’origine indiqué nettement la nature et la portée des réformes : les esprits s’égarent ainsi par la dangereuse excitation des espérances et des craintes les plus illimitées. A Florence comme à Rome, nous regardons comme essentiel que le gouvernement ne se laisse pas entraîner par de chimériques prétentions ! » [31]. Ainsi le nationalisme grandit-il à l’ombre des réformes pontificales. Mais Guizot va plus loin : qu’est-ce qui se tient sous la revendication nationale italienne elle-même ? Dans ses Mémoires, il répondra : la révolution.
Deuxièmement, donc, les idées et les théories du mouvement national italien sont-elles radicales et révolutionnaires ? Le 18 janvier 1848, le révolutionnaire Mazzini, exilé à Londres, écrit publiquement à Guizot qu’ « Il n’existe pas de parti modéré en Italie » [32]. Dix jours plus tard, au moment d’en débattre, et sans doute pour rester politiquement correct, Guizot hésite : il parle « d’idées, de théories que j’appellerai… que je n’appellerai pas si on ne veut pas, radicales ou révolutionnaires, mais qui ne conviennent pas à l’ordre, qui ne conviennent pas à l’organisation régulière et pacifique des sociétés » [33]. Ce faisant, il répond à Lamartine qui, lui, rejette avec force l’accusation : « le mouvement libéral n’est nullement un mouvement perturbateur, agitateur, radical, révolutionnaire, comme vous le voulez faire croire à votre pays et au monde pour autoriser votre connivence ou votre inertie » [34].
Guizot, en somme, revendique une « politique du juste-milieu, la politique libérale modérée » [35]. Une politique libérale ? Guizot écrit lui-même, dans une lettre à Rossi : « Nous sommes des conservateurs décidés » [36]. Et les consignes du cabinet français sur les affaires d’Italie sont explicitement conservatrices, conteste Lamartine, qui cite plusieurs documents à l’appui : « Dans une dépêche du 6 août (…) « Il faut que l’Italie adopte une politique conservatrice » dit le ministre - (…) c’est-à-dire conservatrice de l’oppression, de l’usurpation, des abus, du morcellement, de l’impuissance des États italiens » [37]. Une politique modérée ? Cette soi-disant modération, dénonce Lamartine, est une lâcheté qui ne dit pas son nom, une timidité, une traîtrise impardonnable quand l’Italie aurait précisément besoin d’un allié courageux.
Une politique du juste milieu est par définition consensuelle, conciliante avec des puissances européennes aux intérêts parfois divergents. Aussi Guizot, que l’on dit inféodé à l’Angleterre (promoteur de l’entente cordiale, c’est à Londres qu’il s’exilera après la révolution de février 1848), se montre-t-il relativement complaisant à l’égard de l’Autriche, tout en ménageant les italiens. D’une manière générale, le cabinet français ne froisse guère les dominations convenues de l’Europe du Congrès de Vienne. Lamartine à la tribune s’insurge : « il a fallu que la France, à l’inverse de sa nature, à l’inverse des siècles et de sa tradition, devint gibeline à Rome, sacerdotale à Berne, autrichienne en Piémont, russe à Cracovie, prussienne en Pologne, française nulle part, contre-révolutionnaire partout ! » [38].
En Italie, la France, donc, est timidement pro-autrichienne : elle recherche un accord avec Vienne, freinant autant qu’elle le peut le mouvement italien. La raison d’une telle complicité, insiste Lamartine, est que la France a désormais par mariage des intérêts en Espagne [39]. L’ambassadeur de France en Italie, M. de Sainte-Aulaire, aurait même déclaré : « Il n’y a point de bonne réforme en Italie que celles auxquelles l’Autriche pourra concourir » [40]. Pourquoi ? Pour une raison simple. Lamartine cite ce mot de Guizot : « Le remaniement de l’Italie serait la guerre avec l’Autriche » [41]. Pire, une telle guerre embraserait toute l’Europe : « si la France se mettait du côté du mouvement italien, vous verriez à l’instant même la coalition des quatre puissances se reformer contre nous » [42]. Voilà donc ce que Lamartine appelle de la timidité et de la traîtrise : la crainte d’une guerre. C’est pour sauvegarder la paix européenne que Guizot entend maintenir un statu quo territorial en Italie.
Au contraire, Lamartine n’hésite pas à soutenir une intervention française, au nom de la liberté et de l’unité du peuple italien. Dans son article du 28 octobre 1847, il écrivait : « Le pape a fait ce qu’il pouvait faire. C’était à nous de faire le reste. Ne nous le dissimulons pas ; l’Italie ne peut rien seule dans son état présent. (…) il faut un médiateur armé en Italie ! [43] Ce médiateur, qui peut-il être ? (…) Il n’y a donc que la France qui puisse prendre ce rôle » [44].
Mais que faire, dès lors, de la guerre européenne que brandit Guizot ? Lors de son apparition à la Chambre du 29 janvier 1848, qu’il qualifiera lui-même d’ « immense succès » [45], Lamartine lui répond par un souvenir : celui d’avoir été l’un des négociateurs de la Restauration, en 1820-1821. Autrement dit : la guerre peut être évitée par le jeu de la diplomatie. Mais cette diplomatie, doit-on ajouter, ne sera efficace que si la guerre menace. Lamartine veut faire de la France un médiateur armé. Les termes sont importants. Un médiateur armé est d’abord un médiateur, c’est-à-dire un négociateur. L’armer n’est qu’un moyen donné au moyen lui-même, car la crédibilité de l’intermédiaire français dépend essentiellement de son poids militaire. Ce que Lamartine propose, en somme, n’est pas une intervention française pour chasser l’Autriche hors des frontières de l’Italie, mais seulement la potentialité, la menace d’une telle intervention, pour que l’Autriche laisse l’Italie se réformer, s’unifier, se construire.
« Sur ma proposition, le roi et son conseil résolurent que, si le pape menacé, soit du dehors, soit au dedans, réclamait notre appui, nous le lui donnerions efficacement » [46]. Croit-on entendre Lamartine ? C’est pourtant Guizot. Guizot, lui aussi, propose son aide au pape. Mais un mot, dans l’expression, doit nous alarmer : « soit du dehors, soit au dedans ». Guizot s’explique : « Au milieu de cette fermentation de jour en jour plus générale et plus ardente, le pape, malgré sa popularité persistante, ressentait de vives alarmes. Il voyait avancer et monter vers lui, tantôt la domination étrangère, tantôt l’exigence populaire. Qui le soutiendrait contre l’un et l’autre ennemi ? Il ne pouvait ni ne voulait accepter la protection de l’Autriche. Pouvait-il compter sur celle de la France ? » [47]. Autrement dit, c’est pour lutter contre deux menaces que Guizot propose au pape l’aide de la France : d’abord, la domination étrangère, c’est-à-dire l’Autriche. Lamartine sur ce point est d’accord, mais n’est pas dupe : Guizot, qui sert plutôt d’intermédiaire complice à l’Autriche, ne se mettra jamais en travers de sa route. Reste donc seulement l’autre menace, l’autre « ennemi » : l’exigence populaire. Et c’est ici, exactement, que se découvre la véritable nature de la proposition de Guizot, et du même coup la grande différence avec celle de Lamartine. Guizot propose son aide au pape pour lutter contre le mouvement national italien qui, soi-disant, le déborde. Lamartine propose son aide au pape en tant que soi-disant chef de file de ce mouvement. Pour Guizot, le pape est une victime prise en otage par la pression populaire. Pour Lamartine, le pape est l’initiateur même de cette pression.
2) 24 février – 24 juin 1848 : trois mois au pouvoir
« A la minute même où la politique étrangère de la France a été entre les mains de la République, cette politique a complètement changé » [49]
La politique étrangère de Lamartine est nuancée et intéressante. Mettant son projet d’intervention armée à exécution, il lève une armée des Alpes et la tient en alerte sur la frontière en 1848, afin de prévenir toute tentative autrichienne ou anglaise [50]. Paradoxalement, la raison d’être de cette armée préventive est de ne pas intervenir [51]. Son action est en effet limitée par deux principes : d’une part, son but n’est pas d’envahir et d’occuper mais de libérer et, d’autre part, cette libération elle-même n’est pour l’instant que potentielle, puisque les États italiens n’ont pas encore été envahis ou contraints par les armes. A quelles conditions l’armée française interviendrait-elle ? Réponse : « si les États indépendants de l’Italie étaient envahis, si l’on imposait des limites ou des obstacles à leur transformation intérieure, si on leur contestait à main armée le droit de s’allier entre eux pour consolider une patrie italienne » [52].
Enfin, condition dernière et ultime contrainte sur laquelle Lamartine insiste particulièrement : l’armée française n’interviendra qu’à la demande du peuple italien. Cette exigence, lue comme une passivité, lui attire de nombreuses critiques, et c’est alors aux ambitions interventionnistes de certains républicains plus radicaux, tels Ledru-Rollin et Napoléon Bonaparte, qu’il doit répondre à l’assemblée. Mais cette prudence, qui paradoxalement le rapproche de la modération d’un Guizot, est aussi sa signature, et ce qui distingue sa diplomatie républicaine de celle de Napoléon, « odieuse à toutes les nationalités ; (…) avec l’Italie, qu’il avait occupée dix ans, sans avoir fait autre chose que l’accoutumer à changer de servitude, et sans y avoir implanté un seul germe vital d’indépendance » [53].
La France, donc, est prête à intervenir en Italie – mais pas à n’importe quel prix. En l’espèce, les conditions énoncées par Lamartine sont-elles réunies ? Non, car, pour commencer, la plus importante d’entre elles n’est pas remplie : l’Italie refuse l’aide la France. « L’Italie nous a-t-elle appelés ? Lisez les dépêches (…) c’est l’Italie qui a repoussé la France » [54]. C’est ce que rappelle Lamartine à la séance du 23 mai 1848, avec des documents à l’appui. Une lettre de l’ambassadeur de Sardaigne, datée du 7 avril, explique avec force que le mouvement doit rester italien, et qu’une éventuelle intervention française ne serait acceptable qu’en dernier recours : « on ne veut de l’appui militaire de la France que le jour où il aura été bien constaté par une défaite éclatante que l’Italie seule est impuissante à rejeter les Autrichiens au delà des Alpes » [55]. Les italiens, en somme, ne veulent pas troquer l’Autriche contre la France, ils ne veulent pas d’un nouvel occupant aux allures de libérateur. Pour cette raison, l’armée française massée au pied des Alpes apparaît bien plus comme une menace que comme un éventuel soutien, et l’Italie prévient qu’elle s’opposera au soi-disant libérateur français comme à l’envahisseur autrichien. Lamartine conclut et justifie ainsi sa non-intervention : « Vous voyez que, loin de nous appeler, on ne parlait de rien moins que de nous recevoir avec des armes » [56].
3) fin 1848 – 1849 : Lamartine défend la République romaine et s’oppose au rétablissement du pouvoir temporel de la papauté
Dans son intervention du 8 mars 1849, Lamartine reprend à son compte la rhétorique du « juste milieu » de Guizot. Sur ce qu’il est désormais convenu d’appeler la « question romaine », il envisage trois positions possibles : deux extrêmes et une modérée, la sienne. Le premier extrémisme est la volonté française d’intervenir militairement à Rome pour rétablir le pouvoir temporel de la papauté, volonté qu’il nomme le « point de vue purement catholique, ultra-catholique, violemment catholique » [57]. Le second extrémisme, à l’inverse, serait le « point de vue radical philosophique » [58], passif et anarchiste, qui consisterait à ne rien faire et à laisser une guerre européenne éclater. En distinguant sa propre position d’un tel point de vue, en s’y opposant même, Lamartine rassure et répond à Guizot : s’opposer à l’intervention française n’implique pas forcément embraser l’Europe. Il existe une troisième voie.
Le point de vue intermédiaire, « politique, le point de vue diplomatique, le point de vue républicain français » [59] auquel se rallie Lamartine, repose sur trois principes : « le principe de la paix générale de l’Europe (…) ; le principe de dénouer par des négociations ce qui autrement ne peut être tranché qu’avec le glaive et au prix de sang humain. Il y a autre chose, c’est l’indépendance religieuse » [60]. En l’espèce, qu’est-ce à dire ? D’abord, Lamartine s’oppose fermement à « ces mesures soudaines, violentes, téméraires, (…) qui consistent à lancer une armée pour aller enchaîner à jamais le peuple romain au trône pontifical et le déshériter, ainsi que toutes les populations du centre de l’Italie, de sa dignité de citoyens, d’hommes, de peuple, pour la satisfaction de consciences étrangères » [61]. Autrement dit, il s’oppose à tout projet d’intervention française pour rétablir le pouvoir temporel de la papauté. Ensuite, et c’est en cela que consiste le respect de l’indépendance religieuse, il ne s’oppose pas à la conservation du pouvoir spirituel du pape. Lamartine exige « par la voie des négociations d’abord et d’une entente commune ensuite, que le peuple romain conserve au pape, comme souverain spirituel reconnu nécessaire à tant de souverainetés catholiques, et à tant de populations attachées à ce dogme personnifié en lui, et lui constitue une garantie d’indépendance, de situation, de dignité, qui sont nécessaires à tous ces peuples » [62]. Il se prononce donc en faveur « de l’inviolabilité et de l’indépendance, non pas du souverain, entendez-moi bien, mais du pontife » [63].
Ainsi la finesse de la position lamartinienne sur la question romaine tient-elle en une distinction : celle des pouvoirs temporel et spirituel de la papauté – quand le projet épais et brutal d’intervention française confond les deux. La critique lamartinienne du projet d’intervention française pour rétablir le pouvoir temporel de la papauté est en somme une critique de la confusion des pouvoirs temporel et spirituel du pape. Le 30 novembre 1848 à l’assemblée constituante, E. Quinet défendait exactement la même thèse : « Autant que personne, je comprends, j’approuve la protection morale de la République donnée au chef de la catholicité, au pasteur spirituel. Mais si l’on tend à confondre le prince et le pontife, si l’on arme le prince contre une révolution populaire, je dis que, non-seulement on comprime le mouvement de l’insurrection romaine, mais que l’on étouffe le principe de la nationalité italienne tout entière » [64]. Lamartine et Quinet ont un argument de poids contre le gouvernement français : « Comprimer par la menace la révolution romaine, c’est attenter, dans son principe, à la nationalité italienne, et frapper du même coup la révolution du 24 Février. (Mouvement) » [65].
Mieux : rétablir le pouvoir temporel de la papauté, s’opposer à la révolution romaine, c’est d’abord et surtout bafouer ce grand principe du jus gentium qu’est le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. L’argument, déjà en germe en 1849, sera explicitement développé par Lamartine en 1860-1861 à propos d’une situation très comparable. En vertu du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, le peuple romain devrait être libre de modifier ou d’abolir la souveraineté temporelle des papes, sans qu’aucune puissance étrangère ne s’autorise à intervenir [66].
[1] Alphonse de Lamartine, Trois mois au pouvoir, par M. de Lamartine, Paris, Michel Lévy, 1848, p. 143, 27 mars 1848.
[2] Nous développons cette critique dans un article distinct : « Lamartine : les deux vices du gouvernement temporel de la papauté dans l’article du 28 octobre 1847 », Revue d’histoire ecclésiastique, 3-2004, p. 627-657.
[3] Silvio Negro, Seconda Roma (1850-1897), Milan, U. Hoepli, 1943, p. 197.
[4] Louis Bernard Bonjean, Du pouvoir temporel de la papauté, Paris, Imprimeurs du Sénat, 1862, p. 502.
[5] Ernesto Masi, Nell’Ottocento. Idee e figure del secolo XIX, Milan, Treves, 1918, pp. 135-136 ; cité et traduit par François Jankowiak, L’évolution des structures de la curie romaine de l’avènement de Pie IX à la fin du pontificat de Pie X (1846-1914), Thèse d’histoire du droit sous la direction de Brigitte Basdevant-Gaudemet, Université Paris-XI Orsay, 2002, p. 85.
[6] Gino Capponi, cité par Edgar Quinet, La question romaine devant l’histoire. 1848 à 1867. Actes officiels, documents diplomatiques, débats aux assemblées constituante et législative, au sénat et au corps législatif, précédé de France et Italie, Paris, Armand le Chevalier, 1868, pp. 15-16.
[7] François Guizot, Mémoires pour servir à l’histoire de mon temps, édition abrégée par Michel Richard, Paris, Robert Laffont, 1971, §46, p. 586.
[8] Maurice Vaussard, La fin du pouvoir temporel des Papes, Paris, Spes, 1965, pp. 46-47, synthétise fort bien ce double mouvement.
[9] John Stuart Woolf, « La storia politica e sociale », dans La storia d’Italia. Vol. III, Dal primo Settecento all’Unità, Turin, Einaudi, 1973, p. 369, cité et traduit par F. Jankowiak, ouv. cité, p. 103.
[10] Cité par Roger Aubert, David Knowles et Ludovicus Jacobus Rogier [dir.], Nouvelle histoire de l’Eglise, tome 5, L’Eglise dans le monde moderne (1848 à nos jours), Paris, Seuil, 1975, p. 13, n. 3.
[11] François Guizot, Mémoires…, ouv. cité, §46, p. 580.
[12] Alphonse de Lamartine, lettre à Gino Capponi, du 27 novembre 1846, dans Correspondance d’Alphonse de Lamartine (1830-1867), tome IV : 1842-1846, édité par Christian Croisille, Paris, Champion, 2001, pp. 705-706.
[13] Voir François Guizot, Mémoires pour servir à l’histoire de mon temps, Paris, Michel Lévy, volume VII, 1865, pp. 252-253, 342, 443 et 439.
[14] Arturo Carlo Jemolo, Chiesa e Stato in Italia dal Risorgimento ad oggi, Turin, Einaudi, 1955, traduction française par Robert Juffré, L’Eglise et l’Etat en Italie du Risorgimento à nos jours, Paris, Seuil, 1960, p. 21.
[15] François Guizot, discours à la chambre des députés, 29 janvier 1848, dans Histoire parlementaire de France, recueil complet des discours prononcés dans les Chambres de 1819 à 1948, tome V, Paris, Michel-Lévy frères, 1863-1864, p. 549. Voir aussi le discours du 3 août 1847, p. 498.
[16] Lamartine résume fort bien le problème dans son Histoire de la révolution de 1848, Bruxelles, Meline, Cans et Cie, 1849, tome II, p. 33.
[17] Sa politique ambiguë était diversement interprétée, comme le montre Ivan Scott, The Roman Question and the Powers, 1848-1865, The Hague, Martinus Nijhoff, 1969, p. 5, n. 3.
[18] François Guizot, Mémoires…, édition abrégée, ouv. cité, §46, p. 589. A l’époque, Guizot avait réagi violemment (voir son discours à la chambre des députés du 29 janvier 1848, ouv. cité, pp. 550-551).
[19] En privé, son refus s’exprime bien avant ce célèbre discours. Selon Guizot, il déclare à l’ambassadeur de France le 26 août 1846 : « Un pape ne doit pas se jeter dans les utopies. Croiriez-vous qu’il y a des gens qui parlent même d’une ligue italienne dont le pape serait le chef ? Comme si la chose était possible ! Comme si les grandes puissances étaient disposées à le permettre ! Ce sont là des chimères » (Mémoires, ouv. cité, volume VIII, p. 345). Il aurait aussi dit « Je ne veux pas faire ce que veut Mazzini ; je ne puis faire ce que veut Gioberti » (Gioberti-Massabi, Carteggio, p. 142, cité par Guillaume Mollat, La question romaine de Pie VI à Pie XI, Paris, Gabalda, 1932, p. 201, note 5). Mazzini, exilé à Londres, lui avait effectivement adressé le 8 septembre 1847 un manifeste qui lui demandait ni plus ni moins de prendre la tête du mouvement nationaliste : « Unifiez l’Italie, votre patrie (…). Rassemblez autour de vous les meilleurs représentants du parti national. Ne mendiez pas l’alliance des princes. Attachez-vous à conquérir celle de votre peuple (…). L’unité italienne est chose divine (…) Elle s’accomplira avec ou sans vous » (Scritti editi ed inediti di Giuseppe Mazzini, édité par G. Daelli, Bologna-Milano, 1861-1891, tome XXXVI, dans Politica, volume XII, pp. 225-233 ; cité par Guillaume Mollat, La question romaine…, ouv. cité, p. 216, note 1).
[20] Giuseppe Mazzini, République et royauté en Italie, traduction et préface de George Sand, Paris, Au bureau du nouveau monde, 1850, p. 26.
[21] Sur ce dernier point, Lamartine sera très clair en 1861 : « Empêcher l’Autriche d’empiéter sur les Etats italiens, piémontais ou autres dont les traités ont garanti l’indépendance, afin que l’Italie, destinée à être libre, ne devienne pas une monarchie autrichienne, trop pesante sur ces peuples libres, et trop pesante aussi contre nous-mêmes au midi de l’Europe » (Cours familier de littérature : un entretien par mois, Paris, F. Didot, volume 11, 1861, p. 51).
[22] Pour Paul Guichonnet, L’unité italienne, Paris, PUF, 1961, p. 61, « Cette occupation française marquait le début de la Question romaine ». Il nous semble, au contraire, que la Question romaine est posée à l’Europe dès l’avènement de la République romaine, en février 1849, voire même déjà depuis les troubles romains de novembre 1848.
[23] Serge Berstein et Pierre Milza, L’Italie. La papauté. 1870-1970, Paris, Masson et Cie, p. 131, parlent d’un « traumatisme révolutionnaire ».
[24] Voir Jacques Gadille et Jean-Marie Mayeur [dir.], Histoire du christianisme des origines à nos jours, tome XI, Libéralisme, industrialisation, expansion européenne (1830-1914), Paris, Desclée, 1995, p. 264.
[25] Alphonse de Lamartine, article du 28 octobre 1847, La France parlementaire (1834-1851), œuvres oratoires et écrits politiques, précédés d’une étude sur la vie et les œuvres de Lamartine par Louis Ulbach, Paris, 1864-1865, volume V, p. 92.
[26] ibidem.
[27] En 1860, dans une très intéressante fiction, Lamartine imaginera ce que Machiavel aurait conseillé pour l’Italie du XIXe siècle. Machiavel, le modèle absolu, l’italien par excellence, aurait indubitablement prôné une confédération d’Etats italiens et il aurait non moins certainement rejeté la solution néo-guelfe. Autrement dit, Lamartine reste fidèle à l’esprit du maître, Lamartine est le Machiavel du XIXe siècle. Voir deux beaux morceaux contre le pouvoir temporel de la papauté, en Cours familier…, ouv. cité, volume 9, 1860, pp. 413-414 et pp. 428-429.
[28] La substance aristotélicienne, υποκείμενον, est littéralement ce qui se tient sous – sous les accidents, sous la contingence.
[29] François Guizot, Mémoires…, ouv. cité, §46, p. 585.
[30] Alphonse de Lamartine, discours du 29 janvier 1848, dans La France parlementaire…, ouv. cité, volume V, p. 125.
[31] Idem, p. 131.
[32] François Guizot, Mémoires…, édition abrégée, ouv. cité, §46, p. 583.
[33] François Guizot, discours à la chambre des députés du 29 janvier 1848, ouv. cité, p. 550.
[34] Alphonse de Lamartine, discours du 29 janvier 1848, ouv. cité, p. 138.
[35] François Guizot, discours à la chambre des députés du 29 janvier 1848, ouv. cité, p. 552.
[36] François Guizot, Mémoires…, ouv. cité, §46, p. 582.
[37] Alphonse de Lamartine, discours du 29 janvier 1848, ouv. cité, p. 129.
[38] Idem, p. 148.
[39] Voir l’article du 28 octobre 1847, Idem, p. 97 et le discours du 29 janvier 1848, Idem, p. 146.
[40] Alphonse de Lamartine, discours du 29 janvier 1848, Idem, p. 132.
[41] Ibidem.
[42] François Guizot, discours à la chambre des députés du 29 janvier 1848, ouv. cité, p. 546.
[43] Voir aussi Cours familier…, ouv. cité, volume 6, 1858, p. 51.
[44] Alphonse de Lamartine, article de 28 octobre 1847, ouv. cité, pp. 95-96.
[45] Lettre de Lamartine à Valentine de Cessiat, du 18 février 1848, dans Correspondance d’Alphonse de Lamartine (1830-1867), tome V : 1847-1849, édité par Christian Croisille, Paris, Champion, 2002, p. 243. Immense succès non seulement en France mais aussi en Italie : « Voilà l’Italie qui vous répond ! Votre voix parcourt le monde et le soulève », écrit Henri de Lacretelle à Lamartine le 16 février 1848 (Idem, p. 242).
[46] François Guizot, Mémoires…, édition abrégée, §46, pp. 585-586.
[47] Idem, p. 584.
[48] Voir l’excellent Pierre Quentin-Bauchard, Lamartine et la politique étrangère de la Révolution de février (24 février – 24 juin 1848), Paris, F. Juven, 1908.
[49] Alphonse de Lamartine, discours en réponse aux interpellations sur les affaires d’Italie et de Pologne, adressées à la séance de l’Assemblée nationale par les citoyens d’Aragon, Wolowski, Vavin, Sarrans, Guichard, Napoléon Bonaparte, 23 mai 1848, dans La France parlementaire…, ouv. cité, volume V, p. 290.
[50] Idem, p. 293. Il aurait dit à Pepe qu’il était prêt « à envoyer 100.000 hommes en Italie, pour soutenir la cause de l’indépendance » (Général Pepe, Histoire des révolutions et des guerres d’Italie en 1847, 1848 et 1849, p. 22, cité par P. Quentin-Bauchart, ouv. cité, p. 242). Voir aussi la Réponse au citoyen d’Aragon priant l’Assemblée nationale d’autoriser des interpellations au sujet de la partie du discours de M. de Lamartine relative aux affaires d’Italie, commission exécutive du 10 mai 1848, Idem, p. 279.
[51] La position de Lamartine, qui consiste à créer un climat (une pression) favorisant l’unité italienne sans intervenir, sera exactement la même en 1861 : « La France (…) devait se borner à empêcher les envahissements autrichiens contre le Piémont, à prévenir les interventions étrangères dans les Etats italiens, à favoriser, sans y intervenir de la main, le système fédératif entre les nationalités italiennes » (Cours familier…, ouv. cité, volume 11, 1861, p. 49).
[52] Alphonse de Lamartine, discours du 23 mai 1848, ouv. cité, pp. 289 et 292.
[53] Alphonse de Lamartine, discours sur les relations extérieures de la République, Juillet 1848 (Lamartine répond à MM. Mauguin et Napoléon Bonaparte), dans La France parlementaire…, ouv. cité, volume V, p. 352.
[54] Alphonse de Lamartine, discours du 8 mars 1849, Idem, volume VI, p. 69.
[55] Alphonse de Lamartine, discours du 23 mai 1848, ouv. cité, p. 294.
[56] Ibidem. En juillet 1848, Lamartine défendra à nouveau son bilan face à MM. Mauguin et Napoléon Bonaparte : voir le discours sur les relations extérieures de la République, Juillet 1848, ouv. cité, p. 350.
[57] Alphonse de Lamartine, discours du 8 mars 1849, ouv. cité, pp. 74-75.
[58] Idem, pp. 75-76.
[59] Idem, p. 75.
[60] Idem, p. 76.
[61] Idem, p. 77.
[62] Ibidem.
[63] Idem, p. 78.
[64] Edgar Quinet, ouv. cité, p. 40.
[65] Idem, pp. 40-42.
[66] Voir Cours familier…, ouv. cité, volume 9, 1860, p. 449 et volume 11, 1861, pp. 60-61.


