La justice pénale internationale a-t-elle un effet pacificateur ?
Les Cahiers de la justice. Revue trimestrielle de l’Ecole Nationale de la Magistrature (Dalloz), 2013/1, p. 115-126.
PDF Abstract
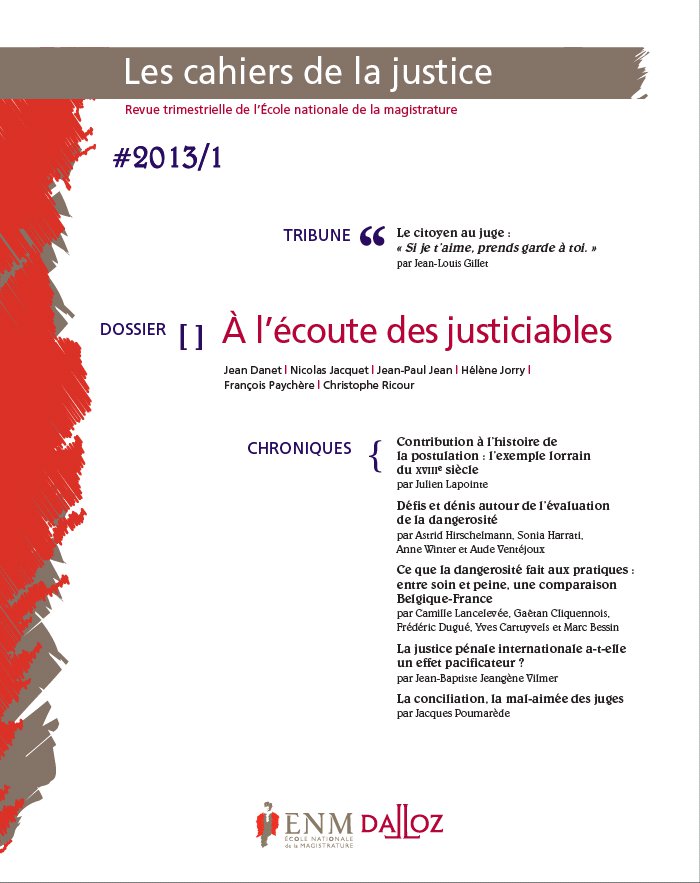
Les institutions de la justice pénale internationale, en particulier la Cour pénale internationale et les tribunaux ad hoc (TPIY et TPIR), n’ont pas seulement une fonction punitive : ils ont aussi une fonction sécuritaire, c’est-à-dire l’ambition d’avoir un effet pacificateur, de réaliser le projet kantien d’une « paix par le droit ». Mais en ont-ils les moyens ? Dans quelle mesure contribuent-ils réellement à la pacification ? Ont-ils un effet dissuasif ? Cet article montre que leur contribution est au mieux limitée et que faire preuve de romantisme judiciaire, c’est-à-dire nourrir à l’égard de la justice des attentes démesurées, a l’effet pervers de nuire à sa crédibilité, et de réduire ses chances déjà modestes d’avoir un effet pacificateur.
En 2012, la Cour pénale internationale (CPI), entrée en vigueur dix ans plus tôt, a prononcé son tout premier jugement, condamnant Thomas Lubanga à 14 ans d’emprisonnement pour l’enrôlement et la conscription d’enfants de moins de 15 ans, et les avoir fait participer activement aux hostilités dans le cadre d’un conflit armé en République démocratique du Congo (RDC) en 2002-2003 [1].
La justice a été rendue – en tout cas en ce qui concerne une affaire, il y en a d’autres – mais la paix n’est toujours pas revenue dans ce pays régulièrement présenté comme le lieu d’une « guerre oubliée » qui aurait fait plus de 6 millions de morts depuis une décennie, et qui n’est pas prête de s’éteindre comme en témoignent la multiplication des groupes armés, dont le M23 ; l’ambiguïté de la position du président Kabila, que le M23 avait soutenu lors des élections ; le rôle des pays voisins (Rwanda et Ouganda), qui soutiennent la rébellion et, surtout, les intérêts économiques en jeu, puisque le Nord-Kivu, notamment, a des richesses minières, gazières et agricoles considérables.
Dans ces conditions, on peut se demander quel impact le jugement de la CPI dans l’affaire Lubanga peut avoir sur le terrain, si seulement il en a un. La question se pose, puisque la CPI s’inscrit dans la tradition d’inspiration kantienne de « la paix par le droit », qui voit dans l’organisation juridique de la société internationale une condition du maintien de la paix [2], et qui avait déjà motivé la création des Conférences de La Haye en 1899 et 1907, de la Société des Nations en 1919 et de l’ONU en 1945. « Reconnaissant » dans son préambule que les crimes relevant de la juridiction de la Cour « menacent la paix, la sécurité et le bien-être du monde », le Statut de Rome, comme ceux des tribunaux ad hoc avant lui (TPIY et TPIR), qui d’ailleurs avaient été créés par le Conseil de sécurité dont la mission principale est le maintien de la paix et de la sécurité, présume que poursuivre les auteurs de ces crimes a un effet pacificateur. La CPI a une nature hybride : elle est à la fois une cour pénale et une cour « de sécurité » [3]. A tel point que certains se demandent si la fonction du juge pénal international est dorénavant d’« assurer la paix mondiale » [4], ou si le procureur n’a pas en réalité un rôle de diplomate [5].
Quel effet pacificateur ?
La fonction sécuritaire de la justice pénale internationale – que la CPI incarne puisqu’elle est la seule cour permanente, mais qu’on retrouve également dans d’autres institutions – repose sur la conviction que le travail de ces tribunaux a un effet pacificateur. Les uns, en premier lieu les ONG de défense des droits humains et le personnel de ces institutions judiciaires, le pensent – parce qu’ils veulent croire à leur travail. Les autres, souvent des politiques, des diplomates ou des observateurs qualifiés de « réalistes », en doutent, et le moins qu’on puisse dire des plus récents événements est qu’ils leur donnent plutôt raison. En quoi le procès de Lubanga, par exemple, a-t-il eu un effet pacificateur ou dissuasif sur la RDC ? En quoi les mandats d’arrêts de la CPI contre Kadhafi et son équipe l’ont-ils empêché de s’en prendre à sa population ou ont-ils joué un quelconque rôle dans sa chute ? Sans même remonter à l’exemple désormais classique d’Omar el-Béchir, le président soudanais sous le coup de deux mandats d’arrêts pour crimes de guerre, crimes contre l’humanité et génocide depuis 2009 et 2010, qui ne l’ont affaibli ni à l’intérieur ni à l’extérieur puisqu’il se déplace librement, y compris dans des pays qui, comme le Tchad, le Kenya ou Djibouti, sont parties au Statut de Rome et ont donc en principe l’obligation de l’arrêter, il y a des raisons d’être sceptique sur l’efficacité de la justice pénale internationale.
Comment se mesure-t-elle, cette efficacité ? Conformément à la nature hybride de la CPI, elle se déduit, d’une part, de sa fonction rétributive, c’est-à-dire sa capacité de punir (est-elle efficace dans sa poursuite des criminels ? Combien de personnes tel tribunal a-t-il inculpés, puis arrêtés ?) et, d’autre part, de sa fonction sécuritaire, c’est-à-dire sa capacité de contribuer à la paix et à la sécurité. Il est relativement facile de répondre à la première question – le TPIY, par exemple, a désormais arrêté toutes les personnes qu’il recherchait. La seconde est beaucoup plus difficile [6].
Les enquêtes empiriques – il y en a quelques-unes – ne sont pas toujours d’une grande aide car leurs résultats sont souvent contradictoires. Des mêmes données, certains concluent que le TPIY, par exemple, n’a pas contribué à la paix sociale en Bosnie et que, à certains égards, il a même eu l’effet inverse d’attiser les tensions entre les groupes suite à des inculpations ou des arrestations [7]. Mais d’autres affirment que « le TPIY et le TPIR ont contribué de façon significative à la consolidation de la paix dans les sociétés en transition », en marginalisant les leaders politiques nationalistes, en dissuadant les victimes de se venger et plus généralement en développant le rôle de la justice pénale internationale dans les esprits et les agendas politiques [8].
La justice met-elle hors-jeu les fauteurs de trouble ?
Ceux qui pensent que la justice pénale internationale a un effet pacificateur font valoir plusieurs arguments. Le premier est qu’en inculpant et en arrêtant des criminels présumés, les tribunaux mettent hors-jeu des fauteurs de trouble [9]. Si ces éléments criminels sont des forces déstabilisatrices, l’action du tribunal est donc par définition pacificatrice. « On est ici, commente Mégret, dans une fonction basique de protection sociale » [10]. C’est juste, mais cet effet est relativisé par la rareté des inculpations – le procureur ayant comme politique de ne s’en prendre qu’aux « plus gros poissons » – et la difficulté de faire exécuter les mandats d’arrêt (il aura fallu 16 ans pour arrêter Mladić, 13 ans pour Karadžić, Omar el-Béchir est toujours libre, etc.).
Le problème essentiel de la justice pénale internationale est qu’elle ne dispose pas d’une force de police indépendante et dépend donc entièrement de la coopération des Etats, en premier lieu ceux sur le territoire duquel la personne recherchée se trouve, et qui, pour des raisons politiques diverses, sont souvent réticents, voire même hostiles aux institutions judiciaires internationales.
L’idée d’une paix par le droit présume aussi trop naïvement que les personnes poursuivies sont forcément impopulaires (et donc que les poursuivre calme la population au lieu de l’agiter), alors que l’inverse est tout à fait possible : il peut s’agir d’un dirigeant démocratiquement élu qui bénéficie toujours du soutien d’une partie importante de la population, ou d’un militaire considéré comme un héros national, comme c’est toujours le cas de Gotovina en Croatie, ou Karadžić et Mladić en Serbie, qui ont des t-shirts à leur effigie dans certaines boutiques de souvenirs de Belgrade.
Croire que le travail de la justice suffira à rétablir ou maintenir la paix sous-estime également les facteurs idéologiques, religieux, raciaux, les tensions tribales ou ethniques qui motivent souvent ces exactions et que la justice ne fera pas disparaître. Ces tribunaux ont en outre le désavantage, du point de vue des populations locales, d’être extérieurs, étrangers. Certains pensent même qu’« il est difficile d’imaginer des circonstances dans lesquelles une réconciliation nationale pourrait être obtenue par une institution internationale » [11], qui ne pourra comprendre que partiellement les problèmes internes à une société donnée. Cette extranéité est l’un des arguments utilisés par certains dirigeants pour dénigrer la justice pénale internationale, et l’accuser d’être partiale, biaisée, néocolonialiste.
Une critique encore renforcée par les liens que ces institutions entretiennent avec le Conseil de sécurité – un lien filial dans le cas des tribunaux ad hoc puisqu’ils ont été créés par lui, et malgré tout étroit dans le cas de la CPI, censée être indépendante mais sur laquelle le Conseil de sécurité dispose tout de même d’un pouvoir de saisine et de suspension – qui achève de convaincre ces accusateurs que la justice est utilisée comme un instrument d’hégémonie par les Etats puissants.
Est-elle dissuasive ?
Cela n’empêche pas ceux qui croient en l’effet pacificateur des tribunaux de faire valoir leur autre argument majeur : la justice pénale internationale serait dissuasive. Cette conviction est même à l’origine de la création des institutions judiciaires. Le Conseil de sécurité a créé le TPIY parce qu’il était convaincu que « la création d’un tribunal international et l’engagement de poursuites contre les personnes présumées responsables de telles violations du droit humanitaire international contribueront à faire cesser ces violations » [12]. La Chambre de première instance confirme en considérant « que la peine a deux fonctions importantes, le châtiment et la dissuasion » [13]. Et le Statut de Rome affirme dans son préambule que l’un des buts de la CPI est de « concourir ainsi à la prévention de nouveaux crimes ».
C’est l’argument principal, de nature utilitariste, en faveur de la justice pénale internationale [14]. Et c’est un argument classique, puisque c’est simplement la théorie de la dissuasion que Beccaria défendait au XVIIIe siècle pour justifier la punition. Mais qu’en est-il dans la réalité ? La justice pénale internationale est-elle vraiment dissuasive ? Y a-t-il une « dissuasion judiciaire » ? [15]
On retrouve là encore une dichotomie entre optimistes et pessimistes. Les uns pensent qu’« il y a des preuves que les tribunaux peuvent contribuer à prévenir des atrocités » [16], quand d’autres sont plus sceptiques. « Les arguments sur un hypothétique effet dissuasif de la justice pénale internationale, explique par exemple Mégret, autrefois promus un peu imprudemment comme un des plus sûrs effets bénéfiques de l’activité des tribunaux, ont petit à petit laissé la place à un scepticisme de bon aloi » [17].
En effet, les exemples de dissuasion ne sont pas toujours convaincants. Rappeler, comme le fait Carla Del Ponte, que Mladić, un mois seulement avant Srebrenica, avait avoué à des représentants de l’ONU qu’il craignait d’être accusé de crimes de guerre [18], ou que les forces serbes engagées dans le nettoyage ethnique au Kosovo portaient des masques et se sont efforcées de dissimuler les charniers et faire disparaitre les preuves, c’est au contraire démontrer que la menace de la justice n’a pas été suffisamment forte pour empêcher la commission de ces crimes.
D’autres sont meilleurs. L’ambassadeur américain en Croatie raconte que le fait d’avoir dénoncé le traitement des prisonniers dans un camp croate comme des « crimes de guerre » et d’avoir suggéré la responsabilité d’un dirigeant local a déclenché la libération de 700 prisonniers et la nette amélioration de leurs conditions de vie [19]. Il semble également que les tribunaux dissuadent les victimes de se venger. Au Kosovo, il est vrai que le TPIY n’a pas dissuadé le nettoyage ethnique, mais on peut penser qu’il a « au moins légèrement découragé l’Armée de libération du Kosovo de se venger des Serbes » [20]. De la même manière, au Rwanda, le TPIR aurait dissuadé au moins une partie des Tutsis de se venger des Hutus. Leur statut internationalement reconnu de victimes de génocide a d’ailleurs « augmenté le coût du revanchisme anti-Hutu » [21] : car comment justifier que l’on se rende soi-même coupable des horreurs qu’on a subies ?
Le cas de l’Armée de résistance du Seigneur (ARS), en Ouganda, est intéressant, puisque la saisine de la CPI aurait eu un impact sur le comportement du Soudan, qui jusqu’alors protégeait ce mouvement rebelle et qui a finalement autorisé l’armée ougandaise à éliminer les bases de l’ARS dans le sud de son territoire, tandis que l’émission de mandats d’arrêts a incité l’ARS à s’engager plus sérieusement dans le processus de paix – contredisant les craintes de ceux qui pensaient qu’ils nuiraient aux négociations. Un ambassadeur ougandais confirme « ce que les observateurs reconnaissent : que les mandats d’arrêt contre les dirigeants de l’ARS ont contribué à les amener à cesser toutes formes d’exaction et même à négocier » [22].
En Côte d’Ivoire également, la justice a peut-être eu un effet dissuasif, lorsque, suite à la politique d’incitation à la haine raciale mise en place par le président Gbagbo en 2002-2003, visant les populations du Nord ne satisfaisant pas le concept d’« ivoirité », et une utilisation des médias de masse faisant craindre une « syndrome rwandais en Côte d’Ivoire » [23], le Conseiller spécial pour la prévention du génocide à l’ONU a évoqué l’éventualité d’une saisine de la CPI [24]. La Côte d’Ivoire n’a pas ratifié le Statut de Rome mais, conformément à l’article 12(3), le gouvernement a reconnu sa juridiction dans une déclaration ad hoc en avril 2003. L’ONG Committee to Protect Journalists observe que l’incitation médiatique à la haine raciale cesse à ce moment-là [25]. Le procureur de la CPI, Luis Moreno-Ocampo, en déduit que « la dissuasion a commencé à montrer ses effets dans le cas de la Côte d’Ivoire, où la perspective d’une poursuite judiciaire de ceux utilisant l’incitation à la haine semble avoir maintenu les principaux acteurs sous un certain contrôle » [26]. Sans en déduire une stricte relation de cause à effet, on peut raisonnablement penser que la menace de la CPI a « mis en branle une chaîne d’événements qui a contribué considérablement à prévenir l’escalade de la violence ethnique en Côte d’Ivoire » [27].
Il est en réalité difficile de montrer où la justice pénale internationale a été dissuasive, en raison d’un double problème méthodologique. D’une part, une dissuasion réussie se mesure à l’aune de ce qui ne s’est pas passé. Pour savoir si l’existence d’institutions judiciaires telles que le TPIY, le TPIR ou la CPI est dissuasive, il faudrait savoir comment se seraient comportés les individus si ces tribunaux n’existaient pas. C’est le problème de la contrefactualité, et la faiblesse principale de la théorie de la dissuasion rationnelle [28].
D’autre part, il faut se garder de croire que « l’impact préventif des tribunaux doit se mesurer mécaniquement en termes de cause et d’effet », puisque la causalité est toujours multifactorielle, le rôle des tribunaux se combine à celui d’autres mesures [29]. « En réalité, observe Mégret, les apologistes de la justice pénale internationale ont souvent péché par excès, attribuant à la justice pénale internationale de manière systématique des effets qu’elle n’a au mieux qu’occasionnellement » [30]. Il est en revanche beaucoup plus facile de montrer où la justice pénale internationale n’a pas été dissuasive : il suffit de dresser la liste de tous les massacres commis depuis qu’elle existe, et ils sont nombreux.
Les limites de la dissuasion
L’effet dissuasif des institutions judiciaires internationales est donc discutable, au mieux limité. Et cela s’explique par plusieurs facteurs. Outre le fait que, de toute façon, « les tribunaux n’ont jamais empêché le crime, et le risque de la sanction incite son auteur à être plus habile » [31], comme l’expliquait Louise Arbour lorsqu’elle était procureur du TPIY et du TPIR, l’une des faiblesses de la dissuasion est qu’elle présuppose la rationalité des acteurs : on présume que les criminels font un calcul coût / bénéfice et qu’ils concluront que la menace d’être poursuivi rend le crime potentiellement trop coûteux pour être commis. Or, il est évident qu’au moins certains d’entre eux ne sont pas rationnels. « Un homme capable d’éventrer une femme enceinte ou d’ordonner le viol d’enfants simplement parce qu’ils appartiennent à la "mauvaise" race s’arrêtera-t-il pour envisager que sa conduite puisse déclencher des poursuites ? » [32].
Quant à ceux qui le sont, et qui s’engagent dans ce calcul coût / bénéfice, une limite de la dissuasion est la rareté des condamnations. Pour qu’un système judiciaire soit dissuasif, il faut que les individus aient la conviction qu’ils ont un risque raisonnable d’être poursuivis et condamnés s’ils commettent un crime. Il y a eu 313 conflits armés entre la Seconde guerre mondiale et 2008 : seuls 17% d’entre eux ont donné lieu à des poursuites (contre 40% à des amnisties), et « moins de 1% des criminels ont été traduits en justice » [33]. Encore moins sont condamnés, et dans certains cas l’injustice est flagrante. La Cour d’appel du TPIY vient par exemple d’acquitter les généraux croates Ante Gotovina et Mladen Markac, condamnés en première instance à 24 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité, dans une décision qui a suscité l’indignation – et des opinions dissidentes – du juge italien et du vice-président du tribunal, dénonçant des « erreurs » de raisonnement et un jugement qui « contredit tout sens de justice » [34].
On ne peut nier le progrès accompli, par rapport à l’époque où il n’existait aucune institution judiciaire et où les belligérants jouissaient d’une impunité totale, mais il faut aussi le relativiser : le risque judiciaire existe désormais, il n’est plus nul, mais il reste infinitésimal. Le risque de perdre à la « loterie des poursuites des crimes de guerre » [35] est donc peu dissuasif. Avec la politisation, c’est l’un des facteurs nuisant à la crédibilité des institutions internationales. Les deux d’ailleurs sont liés puisque la faiblesse du risque judiciaire s’explique souvent par des pressions politiques (d’épargner telle personnalité, de lui proposer une immunité secrète en échange de tel service plutôt que de le poursuivre, etc.).
Les deux dissuasions
Les plus réalistes des défenseurs de l’effet dissuasif des tribunaux internationaux veulent bien reconnaître ces limites, mais ils distinguent alors deux types de dissuasions [36]. D’une part, une dissuasion spécifique et de court terme, qui découragerait telle personne de commettre tel crime à un moment donné. Celle-ci ne semble fonctionner que pour des crimes de guerre ponctuels, mais pas pour des situations de génocide ou de nettoyage ethnique, et elle se heurte aux limites que l’on vient d’identifier. D’autre part, il y a aussi une dissuasion générale, de long terme, qui ne concerne pas la commission de tel ou tel crime mais l’inhibition inconsciente à l’égard du crime [37]. On peut tout à fait reconnaître le relatif échec de la dissuasion spécifique, qui n’a empêché ni Srebrenica, ni le Kosovo, ni un certain nombre de massacres en Afrique, tout en croyant à ce que l’on appelle généralement la lente érosion de l’impunité. Cette érosion est indéniable. Le problème est sa lenteur.
Reste qu’il faut distinguer deux choses : cette construction normative, et la question de son efficacité. Le problème, en effet, n’est pas uniquement au niveau des normes, mais aussi voire surtout dans leur application, et c’est ici que la critique réaliste marque des points. La justice pénale internationale a beaucoup progressé depuis Nuremberg. Le Statut de Rome, par exemple, est actuellement ratifié par la majorité des États du monde (121 sur 193). Mais pas par certains des plus puissants, comme les États-Unis, la Chine et la Russie – et n’est-ce pas cela qui compte ?
Cette présomption de dissuasion générale se heurte en outre à plusieurs obstacles. Le premier est tout simplement que l’internalisation des normes n’empêche pas leur violation. Une enquête empirique du CICR en Bosnie a montré que les responsables des crimes de guerre avaient pleinement conscience de ce qu’ils faisaient, qu’ils reconnaissaient la légitimité des Conventions de Genève et les défendaient en temps normal. S’ils les violaient malgré tout, c’était sous la pression des « passions nationalistes » et de l’incitation à la haine, et surtout parce qu’ils avaient le sentiment que les règles ne s’appliquaient plus dès lors que l’autre camp les violait aussi [38].
On notera d’ailleurs que même les soldats les mieux formés au respect du droit international humanitaire, ceux des pays occidentaux qui sont imprégnés dès leur plus jeune âge d’une culture de défense des droits de l’homme, commettent eux aussi des crimes de guerre et des atrocités diverses – comme on a pu le constater à plusieurs reprises en Afghanistan et en Irak. C’est donc que, malgré son indéniable développement auquel les institutions judiciaires contribuent, le climat de légalité n’est pas toujours dissuasif.
Le second obstacle est lié au premier, et aux limites déjà identifiées : pour que cette dissuasion globale fonctionne, il faudrait que la justice pénale internationale soit vraiment perçue comme crédible. Il ne faudrait pas donner l’impression aux criminels potentiels que, quelle que soit la sophistication du système, ils ont une chance raisonnable de le contourner, soit parce que leur pays les en protège ou qu’un vide juridique leur permet de n’être pas soumis au droit international humanitaire, soit, dans le cas de dirigeants puissants, parce qu’ils peuvent passer un marché avec un État protecteur ou bénéficier d’une loi d’amnistie.
La culture de l’impunité est paradoxalement renforcée par l’inflation des instruments internationaux qui dénoncent l’impunité et promettent de lutter contre elle : plus on condamne ouvertement l’impunité, plus on promet d’agir, plus cela renforce la culture de l’impunité si ces promesses ne sont pas tenues [39].
Faire preuve de réalisme judiciaire
Ces obstacles expliquent que l’on ne puisse pas, aujourd’hui, accepter le romantisme judiciaire et encore moins le triomphalisme moral. La justice pénale internationale est handicapée par de nombreuses contraintes et son efficacité reste à démontrer. C’est ce que font mine de ne pas voir ceux qui, en France surtout, font preuve d’une naïveté sidérale, en écrivant par exemple que saisir la CPI du cas de la Syrie permettra rien de moins que « l’arrêt des massacres » [40].
Il faut bien sûr continuer de défendre la justice pénale internationale, et saisir la CPI lorsqu’il est possible de le faire (en l’occurrence, la seule manière de la saisir du cas syrien serait de le faire par une résolution du Conseil de sécurité, très improbable en raison du veto russe et chinois), mais il faut aussi arrêter d’avoir des attentes démesurées qu’elle ne pourra jamais combler, de croire et de faire croire que la menace de la justice mettra fin à des conflits armés et permettra de pacifier le monde. Car, ce faisant, l’effet pervers est qu’on la condamne à toujours décevoir, on nuit donc à sa crédibilité, et on réduit d’autant ses chances déjà modestes d’avoir un effet pacificateur.
[1] Le verdict a été adopté par la Chambre de première instance I le 14 mars 2012 (ICC-01/04-01/06-2842), et la condamnation a suivi le 10 juillet 2012 (ICC-01/04-01/06-2901).
[2] G. Clark et L. B. Sohn, World Peace through World Law, Cambridge, Harvard University Press, 1960.
[3] J. D. Ohlin, « Peace, Security, and Prosecutorial Discretion », in Carsten Stahn et Göran Sluiter (ed.), The Emerging Practice of the International Criminal Court, The Hague, Brill, 2009, p. 206.
[4] J.-P. Bazelaire et T. Cretin, La justice pénale internationale. Son évolution, son avenir. De Nuremberg à La Haye, Paris, PUF, 2000, p. 114.
[5] R. H. Mnookin et W. Marra, « Rethinking the Tension between Peace and Justice : The International Criminal Prosecutor as Diplomat », Harvard Negotiation Law Review, 18:1, 2012 (à paraître).
[6] P. Akhavan, « Beyond Impunity : Can International Criminal Justice Prevent Future Atrocities ? », The American Journal of International Law, 95:1, 2001, p. 8.
[7] J. Meernik, « Justice and Peace ? How the International Criminal Tribunal Affects Societal Peace in Bosnia », Journal of Peace Research, 42:3, 2005, p. 271-289.
[8] P. Akhavan, « Beyond Impunity », op. cit., p. 9.
[9] J. Meernik, « Justice and Peace ? », op. cit., p. 276.
[10] F. Mégret, « A quoi sert la justice pénale internationale ? », Annuaire français des relations internationales, 12, 2011.
[11] L. A. Barria et S. D. Roper, « How Effective are International Criminal Tribunals ? An Analysis of the ICTY and the ICTR », The International Journal of Human Rights, 9:3, 2005, p. 364.
[12] UN Doc. S/RES/827, 25 mai 1993, préambule.
[13] TPIY, affaire procureur c. Anto Furundzija, IT-95-17/1, jugement du 10 décembre 1998, §288.
[14] D. Wippman, « Atrocities, Deterrence, and the Limits of International Justice », Fordham International Law Journal, 23:2, 1999, p. 474 ; P. Akhavan, « Are International Criminal Tribunals a Disincentive to Peace ? : Reconciling Judicial Romanticism with Political Realism », Human Rights Quarterly, 31:3, 2009, p. 628.
[15] K. A. Rodman, « Darfur and the Limits of Legal Deterrence », Human Rights Quarterly, 30, 2008, p. 529-560.
[16] P. Akhavan, « « Are International Criminal Tribunals a Disincentive to Peace ? », op. cit., p. 648.
[17] F. Mégret, « A quoi sert la justice pénale internationale ? », op. cit.
[18] C. Del Ponte, La traque, les criminels de guerre et moi : autobiographie, Paris, Editions H. d’Ormesson, 2009, p. 606.
[19] Cité par G. J. Bass, Stay the Hand of Vengeance : The Politics of War Crimes Tribunals, Princeton, Princeton University Press, 2000, p. 294.
[20] P. Akhavan, « Beyond Impunity », op. cit., p. 9.
[21] Ibid., p. 24.
[22] Journal du Barreau du Québec, février 2007, p. 30. Voir aussi R. C. Johansen, « The Contribution of International Judicial Processes to Peacebuilding », in D. Philpott et G. Powers (ed.), Strategies of Peace, Oxford, Oxford University Press, 2010, p. 196.
[23] B. Gregston, « Rwanda Syndrome on the Ivory Coast », worldpress.org, 30 novembre 2004, en ligne.
[24] Juan E. Méndez, UN, Statement by the Special Adviser on the Prevention of Genocide, 15 novembre 2004, en ligne.
[25] Committee to Protect Journalists, Attacks on the Press 2004 : Ivory Coast, 14 mars 2005, en ligne.
[26] L. Moreno-Ocampo, « Building a Future on Peace and Justice : The International Criminal Court », discours à la Conférence de Nuremberg, 25-27 juin 2007, en ligne et cité par D. D. Ntanda Nsereko, « The Role of the International Criminal Tribunals in the Promotion of Peace and Justice : The Case of the International Criminal Court », Criminal Law Forum, 19, 2008, p. 391.
[27] P. Akhavan, « Are International Criminal Tribunals a Disincentive to Peace ? », op. cit., p. 640.
[28] G. J. Bass, Stay the Hand of Vengeance, op. cit., p. 403, note 22.
[29] P. Akhavan, « Are International Criminal Tribunals a Disincentive to Peace ? », op. cit., p. 636.
[30] F. Mégret, « A quoi sert la justice pénale internationale ? », op. cit.
[31] Libération, 29 janvier 1999.
[32] P. Akhavan, « Are International Criminal Tribunals a Disincentive to Peace ? », op. cit., p. 628.
[33] M. C. Bassiouni, « Crimes Against Humanity : The Case for a Specialized Convention », Washington University Global Studies Law Review, 9:4, 2010, p. 580.
[34] P. Hazan, « Les victimes serbes ignorées par la justice internationale », Le Monde, 14 décembre 2012.
[35] D. Wippman, « Atrocities, Deterrence, and the Limits of International Justice », Fordham International Law Journal, 23:2, 1999, p. 477.
[36] P. Akhavan, « Justice in The Hague, Peace in the Former Yugoslavia ? A Commentary on the United Nations War Crimes Tribunal », Human Rights Quarterly, 20:4, 1998, p. 746 ; M. Ayat, « Justice pénale internationale pour la paix et la réconciliation », International Criminal Law Review, 7, 2007, p. 419 ; N. Jain, « Between the Scylla and Charybdis of Prosecution and Reconciliation : The Khmer Rouge Trials and the Promise of International Criminal Justice », Duke Journal of Comparative and International Law, 20:2, 2010, p. 265-266.
[37] Johannes Andenaes, Punishment and Deterrence, Ann Arbor, University of Michigan Press, 1974, p. 36.
[38] ICRC Country Report on Bosnia-Herzegovina, cité par D. Wippman, « Atrocities, Deterrence, and the Limits of International Justice », op. cit., p. 477-478 et 487.
[39] P. Akhavan, « Beyond Impunity », op. cit., p. 13.
[40] M. Bettati et B. Kouchner, « Pour l’arrêt des massacres en Syrie, saisissons la Cour pénale internationale », Le Monde, 13 juin 2012. Voir ma réponse « Syrie : les limites de la justice pénale internationale », Mediapart, 26 juin 2012, en ligne.


