De la possibilité à l’existence : Kant critique de Leibniz
Dialogue. Revue canadienne de philosophie, 47:2, 2008, 211-234.
PDF Abstract
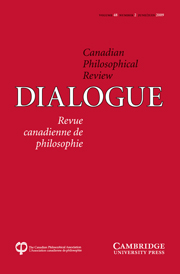
Troisième et dernier volet d’une étude consacrée à la possibilité et l’existence chez Leibniz, cet article reconstruit en trois étapes l’évolution kantienne sur ces notions fondamentales, depuis la Nova dilucidatio (1755) jusqu’à la Kritik der reinen Vernunft (1781-7), en passant par le Beweisgrund (1763), afin, d’une part, de mettre en évidence ce que Kant doit directement à Leibniz et, d’autre part, de montrer comment et pourquoi seul le tournant critique a su arracher l’un à l’autre sur le chemin de la possibilité à l’existence, à travers une double rupture, à la fois épistémologique (le rôle de l’expérience) et ontologique (l’éclipse de Dieu).
On fait volontiers de Kant l’héritier de Leibniz, par Wolff et Baumgarten. On mesure moins ce qu’il lui doit directement, plus souterrainement peut-être, concernant la genèse et l’évolution de deux notions primitives qui, chez l’un et l’autre, présentent la particularité de jouer un rôle central sans pourtant être ni clairement définies ni systématisées : la possibilité et l’existence. Respectivement point de départ et arrivée d’une ontologie leibnizienne qui peut être définie comme le plus court chemin de la possibilité à l’existence, ces deux concepts sont généralement mal connus, et leur rôle exact reste vague, tant chez le philosophe de Hanovre les définitions sont éparpillées et les relations esquissées seulement. Voilà qui exige de la part de l’interprète un travail de reconstruction, et c’est précisément cette enquête qui nous a mené jusqu’à Kant [1].
S’il semble relativement naturel de reconnaître ce que Kant doit à Leibniz pour la genèse de ces notions dans sa propre pensée, surtout dans sa période précritique, il est en revanche plus inédit d’établir ce que Leibniz lui doit pour être compris aujourd’hui, puisque certaines questions, en particulier la prédicabilité de l’existence, ne semblent pouvoir être résolues chez Leibniz qu’avec des instruments kantiens, en l’occurrence la distinction entre prédicats logique et réel. C’est donc une relation réciproque, si l’on peut dire, que la grille de lecture du couple possibilité / existence permet de mettre à jour.
Une légende tenace attribue à Kant d’avoir posé dans toute sa force le problème de l’existence, parce qu’il serait le premier à l’arracher du prédicat, et lui donner de ce fait toute l’importance qu’elle mérite. Du même coup, on oublie volontiers qu’un siècle avant lui, Leibniz a déjà largement entamé la question – et d’une manière qui semble anticiper et préfigurer clairement celle de son successeur, dans la mesure où il a une conception pré-kantienne, si l’on peut dire, de l’espace et du temps, d’abord, qui sont les conditions (transcendantales dirait Kant) de l’organisation des possibles, les « formes a priori de toute mondanité possible [2] » ; et de l’existence quant à la question de savoir si elle est ou non une perfection et, plus largement, un prédicat. Il est effectivement possible de montrer que Leibniz refuse à l’existence d’être une perfection pour lui avoir refusé d’être un prédicat, en vertu précisément de ne lui avoir reconnu qu’un caractère relationnel. Or, c’est exactement ce que fera Kant lui-même. Montrer que le caractère relationnel de l’existence se trouve déjà chez Leibniz, c’est montrer comment, contre les nombreux interprètes qui l’opposent à Kant sur ce point et sur tant d’autres, le philosophe de Hanovre anticipe déjà la solution kantienne.
Il n’est donc pas saugrenu de parler chez Leibniz d’une conception pré-kantienne, si l’on peut dire, de la possibilité et de l’existence. Reste à le confirmer par l’exploration de l’autre diagonale du chiasme : dans quelle mesure Kant a-t-il lui-même une conception leibnizienne de la possibilité et de l’existence ? La plupart des études qui abordent la question chez Kant soit séparent les deux notions pour ne travailler que sur l’une d’entre elles, soit se consacrent exclusivement à la période critique, puisqu’on y trouve les concepts les plus aboutis – mais par conséquent manquent toute leur génération et du même coup toute l’importance de l’héritage leibnizien. Le but de cet article est de répondre à ces deux lacunes, en analysant en même temps et de manière sans cesse entremêlée la possibilité et l’existence, en suivant le cheminement de Kant depuis la Nova dilucidatio (1755) jusqu’à la Kritik der reinen Vernunft (1781-7), en passant par le Beweisgrund (1763), afin de mettre en évidence son évolution sur cette question. Nous verrons comment et pourquoi seul le tournant critique a su arracher Kant de Leibniz, sur le chemin de la possibilité à l’existence.
1. Les tâtonnements, ou la Nova dilucidatio (1755)
Le premier passage obligé est la proposition VII de la deuxième section des Principiorum primorum cognitionis metaphysicae nova dilucidatio. Le raisonnement kantien, dans ce morceau précritique, a une allure particulièrement leibnizienne. Pour démontrer l’existence d’un être absolument nécessaire, le jeune Kant commence par la possibilité. Ce faisant, il suit l’itinéraire de l’ontologie leibnizienne tracé par Wolff (Ontologia, §79) et Baumgarten (Metaphysica, §7) qui, eux aussi, font de la possibilité un point de départ. L’ordre kantien, au moins dans son écriture et via Wolff et Baumgarten, reste donc fidèle à Leibniz qui affirmait que « de toutes les choses qui sont actuellement, la possibilité même ou impossibilité d’être est la première [3] ». Pareille structure est somme toute assez naturelle car, comme le rappelle R. Théis, « le possible est, en effet, par rapport au nihil, un aliquid, un quelque chose [4] ». Rien < possible < existant, ainsi semble aller l’ordre des choses. L’affaire, cependant, n’est pas si simple.
Dès 1755, en effet, Kant affirme déjà une thèse qu’il ne cessera de développer par la suite : il n’est pas de possible sans existant. En voici la preuve : « Comme la possibilité n’existe que par la non-contradiction de certaines notions réunies, et qu’en conséquence la notion de possibilité résulte d’une comparaison ; comme, dans toute comparaison, il est nécessaire qu’il y ait des choses à comparer, et que là où il n’existe absolument rien il n’y a pas de place pour la comparaison, ni pour la notion de possibilité qui en dépend, il en résulte que rien ne peut être conçu comme possible, à moins que n’existe, et même n’existe d’une manière absolument nécessaire, ce qui est réellement dans toute notion possible (puisque autrement rien ne serait tout à fait possible, c’est-à-dire rien ne serait autrement qu’impossible) [5] ». On trouve ici le genre d’un raisonnement qui, dans les textes ultérieurs, aura la précision de l’espèce. Les concepts sont encore mal dégrossis, mais l’essentiel est là. Kant utilise ce qui n’est chez Leibniz qu’un critère (logique) pour définir la possibilité : la non-contradiction. Lui aussi, bientôt, restreindra cette espèce à une possibilité seulement logique. Une chose est possible, explique Kant, si et seulement si cette chose n’est pas contradictoire, c’est-à-dire si les notions qu’elle contient ne sont pas contradictoires entre elles (consistance interne). Or, pour le savoir, il faut pouvoir les comparer. Et, pour ce faire, il faut bien qu’elles existent. Autrement dit, la possibilité a pour condition l’existence préalable des notions contenues dans la chose a priori possible. Le possible a beau être un aliquid, un quelque chose, il n’a donc pas en lui-même la réalité suffisante pour succéder immédiatement au nihil dans l’ordre des choses : entre le nihil et lui, on présuppose déjà l’existence – alors même que toute chose existante est par définition déjà possible, et là réside le paradoxe.
Kant est-il original ? Oui, car avec les mêmes prémisses que Leibniz, il parvient à la même conclusion (l’existence est condition de la possibilité) sans emprunter la même voie. Leibniz ne déduisait pas sa thèse de la seule non-contradiction du possible. Il passait par un moyen terme que Kant ignore : l’existentiabilité du possible, c’est-à-dire sa prétention à l’existence. Le possible, chez Leibniz, est en effet tout entier tendu vers l’existence, et de ce fait existe déjà d’une certaine manière ou « pour ainsi dire [6] ». L’existentiabilité leibnizienne est l’existence-pour-ainsi-dire des possibles, elle est la manière pour le possible d’exister par sa simple possibilité : « Car l’essence de la chose n’étant que ce qui fait sa possibilité en particulier, il est bien manifeste qu’exister par son essence, est exister par sa possibilité [7] ». L’existentiabilité est, en somme, et pour reprendre les mots de Heidegger, « le caractère d’existence de la possibilité [8] ».
Reprenons la Nova Dilucidatio. Kant poursuit son raisonnement et conclut : « Il existe donc un Dieu et un Dieu unique, principe absolument nécessaire de toute possibilité [9] ». Dieu condition de la possibilité. Non seulement de la possibilité, mais aussi de l’existence : « Il est donc bien clair que, si l’on supprime l’existence de Dieu, on fait disparaître non seulement l’existence, mais même la possibilité interne des choses [10] ». On croirait lire Leibniz. Souvenons-nous, en effet, que le Dieu leibnizien, « source des possibilités comme des existences [11] », était lui aussi présenté par cet exercice de pensée qui consiste à réaliser ce que l’on perd en le supprimant : « sans lui il n’y aurait rien de réel dans les possibilités, et non seulement rien d’existant, mais encore rien de possible [12] ». Kant pour l’instant suit donc Leibniz en ce qui concerne le rôle de Dieu vis-à-vis de la possibilité et de l’existence, et il le prolonge au sujet de sa nature : pour l’un comme pour l’autre, Dieu est une exception. Pour Leibniz, il était « l’Être qui doit exister parce qu’il est possible [13] », pour Kant, il devient « le seul de tous les êtres en qui l’existence soit première, ou, si l’on préfère, en qui l’existence soit identique à la possibilité [14] ».
2. Les fondations, ou le Beweisgrund (1763)
Le deuxième texte qui attire notre attention est Der einzig mögliche Beweisgrund zu einer Demonstration des Daseins Gottes (1763). On ne s’intéresse ici qu’à « l’existence en général » et non à l’existence absolument nécessaire (Dieu) qui constitue proprement l’objet de l’auteur dans cet écrit. Nous nous limiterons donc aux deux premières considérations de la première partie. Huit ans après la Nova Dilucidatio, le Beweisgrund entre dans le vif du sujet et enrichit considérablement la conception kantienne de l’existence et de la possibilité.
À mesure qu’il pénètre plus profondément dans l’épaisseur de la notion d’existence, Kant en sonde mieux la difficulté. Le voilà donc devenu particulièrement prudent. L’introduction à la première considération sur « l’existence en général » annonce les principes de la méthode que l’on suivra pour aborder cette « notion très simple et très intelligible [15] ». Partant du même constat que Leibniz – l’existence semble être une notion inanalysable – il en tire la démarche inverse : après avoir averti que « La règle de la solidité n’exige pas toujours, même dans la dissertation la plus approfondie, que tout concept présenté soit développé ou expliqué [16] », il prévient son lecteur qu’« il ne faut pas s’attendre à me voir commencer ici par une définition de l’existence en bonne et due forme [17] ». Leibniz, tout en soulignant que l’existence, notion simple et inanalysable (« Existentia ergo est notio incomposita, sive irresolubilis [18] »), ne pouvait être définie (« Existens definiri non potest [19] »), fournissait tout de même de nombreuses tentatives de définitions, conformément à sa méthode de démonstration qui exige que soient définis a priori tous les concepts utilisés, sans exception. La méthode kantienne, analytique, se distingue ici de celle de Leibniz, et plus largement de ses prédécesseurs.
2.1. L’existence est-elle un prédicat ?
La première chose à dire, à propos de l’existence, concerne sa prédicabilité. Dès 1763, le premier paragraphe de la première considération du Beweisgrund s’ouvre en effet sur cette question qui, dès lors, apparaît prioritaire ; et la réponse est claire et distincte : « I. Pour aucune chose l’existence n’est prédicat ou détermination [20] ». L’existence n’est pas un prédicat : cette affirmation, que Heidegger appellera « la thèse de Kant sur l’être » et qui est sans doute l’expression la plus célèbre de la conception kantienne de l’existence, trouve ici sa première formulation explicite. C’est également à cet endroit que l’on fait volontiers de Kant le premier à avoir posé dans toute sa force le problème de l’existence, comme en témoignait Jean Wahl en 1939 : « J’avais dit que le problème de l’existence s’était posé surtout à partir de Kant. (…) c’est à partir de Kant que le problème est posé dans toute sa force, (…) parce que Kant montre que l’existence n’est pas un prédicat [21] ».
C’est oublier un peu vite que cette thèse n’est en rien nouvelle, et que Kant formule clairement et à nouveaux frais ce que Leibniz un siècle avant lui avait déjà établi. Voyons plutôt. Pendant longtemps, à la suite de Russell, les interprètes ont soutenu que, pour Leibniz, l’existence était un prédicat. B. Mates, par exemple, en voyait la preuve dans le fait que l’existence est une perfection [22]. C’est une question délicate, que nous avons traitée ailleurs [23]. Rappelons seulement que l’existence chez Leibniz n’étant pas une quantité (statique) mais un accroissement (dynamique) de réalité, elle n’est pas une perfection à proprement parler, mais une relation comparative de perfections entre elles, c’est-à-dire un accroissement de perfection, comme l’établit un texte peu connu de 1677 [24]. On ne peut donc pas soutenir la prédicabilité de l’existence par la perfection.
Aujourd’hui, l’interprétation contraire semble gagner du terrain, on répond volontiers par la négative à la question de la prédicabilité de l’existence chez Leibniz : l’existence n’est pas un prédicat, dit-on, car elle n’est pas une perfection, mais plutôt une relation, comme nous venons de le voir. C’est juste, mais l’affaire est plus délicate. Quelques difficultés subsistent dans les textes eux-mêmes : il semble parfois faire peu de doute que l’auteur utilise l’existence comme un prédicat, ce qu’il déclare même explicitement à certains endroits. Ainsi peut-on lire, dans les Nouveaux Essais, que « lorsqu’on dit, qu’une chose existe, ou qu’elle a l’existence réelle, cette existence même est le prédicat, c’est-à-dire, elle a une notion liée avec l’idée dont il s’agit, et il y a connexion entre ces deux notions [25] ». On objectera que l’auteur ne fait ici que répondre à Locke qui, ayant défini dans son Essay la connaissance comme la perception de la convenance ou de la convenance entre deux idées (IV, I, §1), distingue entre quatre espèces de convenance ou disconvenance, dont la troisième est « Coexistence, ou connexion nécessaire » (IV, I, §3). Quoiqu’il en soit, il ne fait aucun doute que « existant » est traité comme un prédicat de premier ordre dans les fragments logiques, notamment en Recherches générales, §71, comme le note J.-B. Rauzy [26]. Il serait donc faux de dire que, chez Leibniz, l’existence n’est dans aucun cas considéré comme un prédicat.
Ce sont des outils kantiens qui vont permettre de sortir de l’aporie leibnizienne, et ce de deux manières. Premièrement, dans le Beweisgrund, Kant, qui comme Leibniz affirme que l’existence n’est pas un prédicat, constate qu’on utilise pourtant souvent le mot comme tel, et a à ce sujet une explication utile : « Cependant on se sert de l’expression existence comme d’un prédicat, et on peut le faire en toute sécurité et sans crainte d’erreur, aussi longtemps qu’en partant de là on ne se propose pas de déduire l’existence de concepts simplement possibles (…). Dans les cas où, dans le langage courant, le mot existence s’emploie comme prédicat, il s’agit bien moins d’un prédicat de la chose elle même que de l’idée qu’on en a. (…) Toute langue humaine tient, des contingences de son origine, quelques imperfections qu’on ne saurait supprimer [27] ». Ainsi donc l’existence, qui certainement n’est pas un prédicat, pour Kant comme pour Leibniz, est-elle parfois utilisée comme tel par abus de langage, et cela ne doit pas semer la confusion dans l’esprit du lecteur.
Deuxièmement, et sur le fond cette fois, il faudrait pour se tirer de l’aporie leibnizienne distinguer deux approches et dire que, pour Leibniz, l’existence est un prédicat au sens logique du terme, mais ne l’est pas au sens métaphysique [28]. Or, c’est exactement ce que dira Kant dans sa période critique, en distinguant entre prédicat logique et prédicat réel :
Je pourrais sans doute espérer avoir directement anéanti cette vaine argutie par une exacte détermination du concept de l’existence, si je n’avais éprouvé que l’illusion qui naît de la confusion d’un prédicat logique avec un prédicat réel (c’est-à-dire avec la détermination d’une chose) repousse presque tout éclaircissement. Tout peut servir à volonté de prédicat logique jusqu’au sujet qui peut se servir à lui-même de prédicat, car la logique fait abstraction de tout contenu. Mais la détermination est un prédicat qui s’ajoute au concept du sujet et l’augmente. Elle ne doit donc pas y être déjà contenue [29].
En somme, on peut certes dire de l’existence qu’elle est un prédicat logique mais, ce faisant, on ne dit rien, ou l’on ne dit qu’une tautologie, car tout peut être un prédicat logique. La question est donc : l’existence est-elle un prédicat réel ? Nous connaissons la réponse de l’auteur : « Etre n’est manifestement pas un prédicat réel, c’est-à-dire un concept de quelque chose qui puisse s’ajouter au concept d’une chose. C’est simplement la position d’une chose ou de certaines déterminations en soi. Dans l’usage logique il n’est que la copule d’un jugement. (…) le petit mot est n’est point un prédicat de plus, mais seulement ce qui pose le prédicat en relation avec le sujet [30] ». L’existence n’est pas un prédicat réel car elle n’ajoute rien à la possibilité (« Et ainsi l’effectif ne contient rien de plus que le simplement possible [31] »). Notons que, dans l’ordre de la raison pure, l’imprédicabilité de l’existence s’expliquera en des termes nouveaux : l’existence est l’une des catégories de la modalité, lesquelles, comme le précise l’éclaircissement des postulats de la pensée empirique en général, « comportent ceci de particulier qu’elles n’augmentent nullement, comme détermination de l’objet, le concept auquel elles sont jointes comme prédicats, mais qu’elles expriment seulement le rapport à la faculté de connaître [32] ».
Voilà donc une distinction kantienne qui s’applique merveilleusement bien à la situation leibnizienne, et nous permet de conclure que, chez Leibniz comme chez le Kant critique, parce que l’existence n’est pas une perfection mais une relation comparative de perfections entre elles, elle n’est pas un prédicat réel mais reste un prédicat logique. Kant et Leibniz sont en vérité plus proches l’un de l’autre sur l’existence que sur la possibilité, contrairement aux apparences [33].
Si l’existence n’est pas un prédicat, qu’est-elle donc ? Le deuxième paragraphe de la première considération du Beweisgrund complète la thèse de Kant sur l’être en affirmant : « II. L’existence est la position absolue d’une chose : elle se distingue par là de tout prédicat qui, en tant que tel, n’est jamais appliqué à une autre chose que d’une manière simplement relative [34] ». C’est encore ce qu’affirmera l’Opus Postumum : « L’existence n’est pas un certain prédicat particulier de la chose, mais sa position absolue avec tous ses prédicats [35] ». Le terme « position » signifie seulement « être », et Kant ici distingue ce que la postérité retiendra comme les deux sens du mot « être » : un sens logique de copule qui lie le prédicat à un sujet dans un jugement (c’est la position relative, respectus logicus), et un sens existentiel dans lequel « être » signifie « exister » (c’est la position absolue). On pourrait dire, en somme, que l’existence des choses est absolue tandis que leur possibilité est relative.
Concrètement, comment Kant démontre-t-il l’imprédicabilité de l’existence ? En établissant qu’elle n’ajoute rien à la possibilité : « Il ne se peut donc pas que, lorsque ces choses existent, elles contiennent un prédicat en plus, car, dans la possibilité d’une chose, compte tenu de sa détermination complète, il ne peut manquer aucun prédicat [36] ». C’est donc une question importante, à laquelle il faut consacrer un développement distinct.
2.2. L’existence ajoute-t-elle à la possibilité ?
La question de savoir si l’existence est un ajout, un complément, un quelque chose de plus par rapport à la possibilité est éminemment leibnizienne [37]. Et la réponse de Kant suit fidèlement celle de Leibniz – en ayant l’avantage sur elle, toutefois, d’être plus explicite.
Parce que l’existence n’est pas un concept statique apparu ex nihilo, mais le résultat d’un processus continu depuis la possibilité, la question se pose naturellement de savoir si on peut alors la considérer comme un degré de possibilité, un ajout, un complément. C’est même concernant l’existence la question centrale. Il faut pour répondre préciser les termes de la question. Il est évident, d’abord, que Leibniz considère l’existence comme un degré de possibilité (le plus haut, en l’occurrence) [38], qu’il se demande ce qu’il faut ajouter à la simple possibilité pour atteindre l’existence (compossibilité et maximum), et qu’il parle même d’un « complementum possibilitatis », notamment dans la définition des forces primitives : « Aristote les appelle entéléchies premières, je les appelle peut-être plus intelligiblement forces primitives, qui ne contiennent pas seulement l’acte ou le complément de la possibilité, mais encore une activité originale [39] ». Que l’existence soit, d’une manière générale, un degré de possibilité (« tout bien réfléchi, je ne vois pas qu’on puisse concevoir autre chose dans existant qu’un certain degré d’être [40] »), un ajout (« nous concevons l’existence comme actuelle, c’est-à-dire comme quelque chose qui est ajouté à la possibilité ou à l’essence [41] »), un complément, et quelque chose de plus, en somme (« l’existant est toujours un être, c.-à-d. un possible, et quelque chose de plus [42] »), voilà donc qui semble ne pas faire problème.
La véritable question ne se pose pas au niveau du genre, mais de l’espèce : l’existence ajoute à l’essence, mais quelle est la nature de sa contribution ? S’agit-il d’ajouter quelque nouveauté ? Non, par définition, car si elle est un degré de possibilité, c’est qu’il n’y a pas entre elle et la possibilité le saut de nature qu’impliquerait une telle nouveauté. Et non, de toute façon, car l’existence, on le sait, n’est qu’une exigence d’essence, en elle l’existentiabilité est contenue : « Si l’existence était autre chose qu’une prétention de l’essence, alors elle aurait elle-même une essence et quelque chose de nouveau viendrait s’ajouter aux choses, à propos de quoi on pourrait à nouveau se demander si cette essence existe ou n’existe pas et pourquoi celle-ci plutôt que celle-là [43] ». L’existence est donc à la fois l’ajout et ce à quoi l’on ajoute : en tant qu’ajout elle est en acte, et en tant que ce à quoi l’on ajoute, c’est-à-dire en tant qu’essence, elle est en puissance [44].
Près d’un siècle plus tard, Kant se pose la même question, dans le troisième et dernier paragraphe de la première considération du Beweisgrund : « III. Puis-je bien dire que dans l’existence il y a plus que dans la simple possibilité ? [45] ». Mais n’a-t-on pas déjà répondu à cela ? L’auteur vient effectivement d’écrire, dans le premier paragraphe, que l’existence n’ajoute rien à la possibilité, qui ne manque de rien en vertu de sa détermination complète, et le voilà qui revient à la charge en posant à nouveau la question. Il faut donc que cette première réponse soit incomplète, et que l’apport du deuxième paragraphe, qui distingue les positions relative et absolue, soit nécessaire pour compléter la discussion. Kant se montrera cette fois plus fin, et également plus proche encore de Leibniz, en divisant la difficulté en deux : « Pour répondre à cette question, je remarque d’abord qu’on doit, dans ce problème, distinguer deux points : "ce qui est posé" et "comment cela est posé". En ce qui concerne le premier point, il n’est posé rien de plus dans une chose réelle que dans une chose possible, car toutes les déterminations et prédicats de la chose réelle peuvent se trouver aussi dans sa simple possibilité. Quant au second point, il est certain que, par le mot existence, on pose quelque chose de plus [46] ».
Le premier point est celui auquel on avait déjà répondu. Le second introduit une nuance non négligeable : l’existence, malgré tout et en un sens, ajoute quelque chose de plus. Paradoxe : non, l’existence n’est pas un ajout ou un complément de possibilité car cette dernière ne souffre aucun manque compte tenu de sa détermination complète, et pourtant, il paraît indéniable que « dans l’existence, est posé quelque chose de plus [47] ». Cette tension est très proche des termes dans lesquels Leibniz lui-même posait le problème : « l’existant est toujours un être, c.-à-d. un possible, et quelque chose de plus [48] ». La manière de sortir de l’aporie, cependant, est différente. Leibniz poussait la discussion jusqu’à l’espèce de savoir si ce que l’existence ajoute est quelque nouveauté, ce qui lui permettait de quitter l’impasse en précisant : un ajout, oui, mais rien de nouveau, car l’existence est tout à la fois l’ajout et ce à quoi l’on ajoute. Kant, lui, et d’une manière bien moins claire nous semble-t-il, utilise le concept de position absolue de la façon suivante : « Dans ce qui existe, il n’est rien posé de plus que dans le simple possible (car il est question alors de ses prédicats), mais par "quelque chose d’existant" il est posé plus que dans le simple possible, et ce "plus" a trait à la position absolue de la chose elle-même [49] ».
Il faudra attendre le vocabulaire de la Kritik pour avoir des explications plus claires : « je ne connais pas cette addition au possible [50] » dira-t-il alors nettement, se justifiant de la manière suivante :
Par la réalité d’une chose, je pose assurément plus que la possibilité, mais non pas dans la chose ; en effet, la chose ne saurait jamais contenir dans la réalité plus qu’il n’était contenu dans sa possibilité complète. Mais comme la possibilité était simplement une position de la chose en relation à l’entendement (à son usage empirique), la réalité est en même temps une liaison de cette chose avec la perception. [51]
2.3. Kant et Leibniz par-dessus Wolff, Baumgarten et Crusius
Après tout cela, Kant dit quelques mots des « thèses des autres [52] ». Il reconnaît en effet avoir « étudié avec un esprit libre de préjugés les pensées des autres en se les appropriant par une réflexion qui les suit pas à pas [53] ». Les « autres » en question se limitent à Wolff, Baumgarten et Crusius [54]. L’absence de Leibniz est d’autant plus remarquable que, comme nous tentons de le montrer, Kant se montre souvent plus proche de Leibniz lui-même que des leibniziens plus récents.
De Wolff, d’abord, il dit peu de choses : « L’explication wolffienne de l’existence, à savoir qu’elle est un complément de la possibilité, est manifestement très vague [55] ». La définition de l’existence comme « complementum possibilitatis », qui se trouve chez Wolff au §174 de son Ontologia, semble purement leibnizienne, puisqu’elle signifie simplement que la possibilité tend vers ce qui la compléterait : l’existence. Reste que Wolff n’hésite pas à présupposer que l’existence manque d’une certaine façon à cette possibilité qu’elle complète, ce à quoi se refusent Leibniz et Kant, comme nous venons de le voir. Kant et Leibniz sont unis par-dessus Wolff.
Baumgarten, au §75 de sa Metaphysica, est plus précis, mais ne trouve pas pour autant les faveurs de Kant : « Pour Baumgarten, ce qu’il y a de plus dans l’existence que dans la simple possibilité, c’est la complète détermination interne, en tant qu’elle complète ce qui reste indéterminé par les prédicats inhérents à l’essence, ou qui en découlent [56] ». Si, pour Leibniz et Kant, il y a bien quelque chose de plus dans la position de l’existence par rapport à celle de la possibilité, ce ne peut être la complète détermination interne, car la possibilité est déjà complète, il ne lui manque rien. Kant retrouve Leibniz par-dessus Baumgarten.
Enfin, Crusius ne s’est pas trompé, lui qui « compte l’en-quelque lieu et l’en-quelque temps parmi les déterminations infaillibles de l’existence. Mais (…) il demeure que ces prédicats appartiennent aussi à des choses simplement possibles [57] ». Crusius a certes raison de dire que c’est l’espace et le temps, et non la non-contradiction, qui déterminent l’existence – mais Leibniz l’avait dit avant lui. En somme, l’absence de Leibniz est une présence paradoxale : Kant, sans le savoir peut-être, et surtout sans le nommer, en se distinguant de Wolff et de Baumgarten, et en suivant Crusius, lui rend hommage, par-dessus eux. Leibniz était beaucoup plus pré-kantien que ses successeurs, et Kant beaucoup plus leibnizien qu’eux.
2.4. Pas de possible sans existant
La deuxième considération marque une étape supplémentaire vers la preuve de l’existence d’un être absolument nécessaire en s’attachant à la démonstration de cette thèse qui émergeait déjà dans la Nova Dilucidatio : il n’y a pas de possible sans existant, la possibilité présuppose l’existence. Les instruments de 1755 étaient relativement épais. Huit ans plus tard, l’auteur se dote de définitions plus fines et entame sa démonstration avec une efficacité accrue. Le premier paragraphe établit une « Distinction nécessaire concernant le concept de possibilité [58] » qui s’avère être le nerf du raisonnement : Kant distingue l’élément matériel de la possibilité (dit aussi « réel de la possibilité »), les data, ce qui est pensé, et l’élément formel de la possibilité (dit aussi « logique de la possibilité »), l’accord (la non-contradiction) entre ces data [59] :
on doit distinguer, dans toute possibilité, d’une part, le « quelque chose » qui est pensé, et, d’autre part, l’accord de ce qui, en même temps, y est pensé selon le principe de contradiction. Un triangle ayant un angle droit est en soi-même possible. Le triangle aussi bien que l’angle droit sont les data, l’élément matériel dans ce possible ; l’accord entre l’une et l’autre de ces données, selon le principe de contradiction, constitue l’élément formel de la possibilité [60].
Ces deux éléments sont deux conditions cumulatives et sine qua non du possible : sans l’une d’elle, le possible devient impossible. La possibilité doit donc satisfaire deux conditions : celle, formelle, de la non-contradiction et celle, matérielle, du datum, du « quelque chose », qu’Yves Bouchard appelle une « contrainte d’existence [61] ». Notons que la distinction entre les éléments matériel et formel de la possibilité dans le Beweisgrund illustre l’amphibologie résultant des concepts de matière et de forme que Kant dénoncera dans la Kritik : « Dans tout être, ses éléments constitutifs sont la matière ; la manière dont ces éléments sont unis en une chose est la forme essentielle [62] ».
Le deuxième paragraphe peut alors utiliser cette distinction pour démontrer que « La possibilité interne de toutes les choses présuppose un existant [63] » : la possibilité, en vertu de son élément matériel, a besoin de data. Sans datum, sans quelque chose à penser, il n’y a pas de possibilité. « Si donc on abolit toute existence, rien n’est absolument posé, rien en général n’est donné, aucun élément matériel ne peut s’offrir à la pensée, et, par conséquent, toute possibilité fait entièrement défaut [64] » ; « en niant toute existence, on abolit aussi toute possibilité [c’est ce que l’on vient de prouver en II]. Par conséquent il est absolument impossible que rien n’existe [65] ». Cet élément matériel chez Kant, indispensable à la possibilité, n’est autre que « ce qu’il y a de réel dans la possibilité [66] » chez Leibniz, c’est-à-dire l’existentiabilité, la prétention à l’existence. Le possible kantien a pour condition l’existence de son élément matériel, de la même manière que le possible leibnizien a pour condition sa propre prétention à l’existence. Poursuivons le procès régressif un degré plus avant : l’élément matériel kantien a lui-même pour condition un « premier fondement réel » de la possibilité interne, qui « fournit les data et l’élément matériel dans ce qui est pensable [67] », et qui sera l’idéal transcendantal dans la Dialectique transcendantale, c’est-à-dire, en somme, l’idée de Dieu. La prétention à l’existence leibnizienne, quant à elle, avait pour condition l’existence effective d’un extérieur au possible, source de cet appel du dehors : Dieu. Une coincidence de plus, qui nous permet de conclure que, durant la période précritique, Kant se montre en tout point leibnizien. Sur la possibilité et l’existence comme sur le reste, la rupture viendra en 1781.
3. Le tournant critique, ou la Kritik der reinen Vernunft (1781)
3.1. La possibilité réelle
La Kritik voit l’avènement d’une nouvelle acception de la possibilité – forcément transcendantale bien que l’expression « possibilité transcendantale » n’apparaisse qu’une seule fois, pour distinguer « la possibilité logique du concept (quand il ne se contredit pas lui-même) » de « la possibilité transcendantale des choses (quand un objet correspond au concept [68] ». Mais sur son exemplaire personnel Kant corrige la formulation et remplace « transcendantale » par « réelle ». Il sera donc désormais question de la possibilité réelle, par opposition à la possibilité logique. Ce changement s’incarne dans l’irruption de l’expérience comme condition conjointe de la possibilité et de l’existence.
La possibilité et l’existence sont en effet maintenant les deux premières catégories de la modalité. Or, celles-ci « n’ont pas une signification simplement logique [69] », c’est-à-dire qu’elles ne relèvent pas de la pure pensée, mais impliquent une référence aux choses (à leur possibilité, réalité, nécessité), un enracinement empirique. De ce point de vue, la possibilité est quelque chose de plus que la simple non-contradiction, qui est une « condition logique nécessaire [70] » mais insuffisante, car « l’absence de contradiction dans un concept [est] encore loin de prouver la possibilité de l’objet* ». En note : « * Le concept est toujours possible quand il ne se contredit pas. C’est là le critérium logique de la possibilité, et par là son objet se distingue du nihil negativum. (…) Nous sommes ainsi avertis de ne pas conclure aussitôt de la possibilité (logique) des concepts la possibilité (réelle) des choses [71] ». Il faut en effet lui ajouter l’expérience car « sans l’expérience, cette possibilité est une liaison arbitraire de pensées, qui, bien que ne contenant aucune contradiction, ne peut prétendre à aucune réalité objective [72] ». La possibilité déborde la non-contradiction en ce qu’elle a nécessairement un rapport au réel.
La définition de la possibilité va donc être sensiblement enrichie. C’est maintenant l’accord avec les conditions formelles de l’expérience : « Ce qui s’accorde avec les conditions formelles de l’expérience (quant à l’intuition et aux concept) est possible [73] », « Le postulat de la possibilité des choses exige donc que leur concept s’accorde avec les conditions formelles d’une expérience en général [74] ». Le langage critique, qui trahit l’empirisme de son auteur, est nouveau, mais l’objet ne l’est pas. Kant développe ici l’élément matériel de la possibilité distingué dans le Beweisgrund, et qui en 1763 se réduisait aux data, à ce qui est pensé. A présent, l’élément matériel, comme pour mieux faire face à l’élément formel, s’exprime lui aussi en terme d’accord : l’élément formel était l’accord (non-contradiction) entre les data, l’élément matériel est maintenant l’accord avec les conditions formelles de l’expérience. Et la loi selon laquelle ces deux éléments étaient des conditions cumulatives et sine qua non de la possibilité s’applique encore : Kant souligne aussitôt l’insuffisance de la seule non-contradiction. « Que dans un tel concept il ne doive se trouver aucune contradiction, c’est assurément une condition logique nécessaire ; mais il s’en faut que cela suffise à la réalité objective du concept, c’est-à-dire à la possibilité d’un objet tel qu’il est pensé par le concept [75] ». En définissant la possibilité par l’accord avec les conditions formelles de l’expérience, Kant prend enfin et définitivement ses distances vis-à-vis de Leibniz. La Kritik der reinen Vernunft marque l’avènement de l’indépendance de la pensée kantienne.
Dorénavant, pour être possible, il ne s’agit plus seulement de ne pas être contradictoire (possibilité logique), mais aussi et surtout de satisfaire deux types de conditions : celles de la donation d’un objet en général, donc celles de l’intuition, les formes a priori de la sensibilité (espace et temps) et celles de la pensée de cet objet, c’est-à-dire les catégories elles-mêmes. La possibilité logique est celle du concept de la chose, et sans possibilité réelle elle n’est qu’une coquille vide : « La possibilité logique sans possibilité réelle est le concept vide dépourvu de contenu, c’est-à-dire relation à l’objet [76] ». La distinction se résume finalement de la manière suivante :
La chose dont même la simple pensée est impossible (c’est-à-dire dont le concept se contredit) est elle-même impossible. Mais la chose dont le concept est possible n’est pas pour autant une chose possible. On peut appeler logique la première possibilité, réelle la seconde ; la preuve de cette dernière est la preuve de la réalité objective du concept qu’on est toujours autorisé à exiger. [77]
Notons que Kant utilise parfois pour désigner la même distinction un autre vocabulaire, par exemple lorsqu’il parle de possibilités abstraite et concrète : « La possibilité in abstracto est simplement le fait de ne pas se contredire. Cette possibilité signifie seulement la recevabilité de l’idée. La possibilité in concreto est seule objective, c’est-à-dire que quelque chose serait possible dans l’omnimoda determinatio interna [78] ».
La question se pose alors de savoir en quoi cette possibilité réelle, puisqu’elle est liée à l’expérience, donc à l’existence, se distingue de la potentialité aristotélicienne, c’est-à-dire d’une actualité en puissance. Le philosophe existentialiste italien Abbagnano, qui parle alors de possibilité non plus réelle mais existentielle, clarifie cette distinction, comme le rapporte Langiulli [79] : c’est que la possibilité réelle est l’accord avec les conditions formelles de l’expérience en général, et non d’une expérience en particulier. Il ne peut donc s’agir d’une puissance qui passerait à un acte particulier.
Notons que la même question se posait également à Leibniz : fallait-il considérer l’existentiabilité comme un intermédiaire entre potentia et actus, entre le possible et l’existant ? L’objection devrait être immédiate : l’existentiabilité ne peut en aucun cas constituer un intermédiaire entre la possibilité et l’existence, puisqu’elle n’est autre que la possibilité elle-même, et rien de plus. Il en va effectivement ainsi dans le référentiel leibnizien. On notera que les interprètes qui en font un intermédiaire, tel Heidegger qui écrit « La vis, eu égard à la traditionnelle distinction de potentia et actus, y est caractérisée pour ainsi dire en tant qu’une essence intermédiaire entre l’une et l’autre [80] », le font dans le référentiel aristotélicien de « la traditionnelle distinction de potentia et actu [81] ». En somme, l’existentiabilité n’est pas un intermédiaire entre les notions leibniziennes de possibilité et d’existence, pour la bonne raison qu’elle est cette possibilité, mais peut être entendue comme un intermédiaire entre les notions aristotéliciennes de potentia et actus.
3.2. Pas d’existence sans sensation
Qu’en est-il de l’existence ? Le postulat de la réalité (Wirklichkeit, qui signifie aussi bien l’existence) des choses s’énonce de la façon suivante : « Ce qui est en cohésion avec les conditions matérielles de l’expérience (la sensation) est réel [82] », « Le postulat relatif à la connaissance de la réalité des choses exige une perception, par conséquent une sensation [83] ». Autrement dit, il n’y a pas d’existence – du moins pas d’existence connue – sans perception. Sans la perception, on en reste à la simple possibilité : « En effet, que le concept précède la perception, cela signifie la simple possibilité de la chose ; mais la perception, qui fournit au concept la matière, est le seul caractère de la réalité [84] ».
Il y a cependant un moyen de déduire l’existence d’une chose que l’on ne perçoit pas : « Mais on peut aussi, avant la perception de la chose, et donc relativement a priori, en connaître l’existence, pourvu qu’elle s’accorde avec quelques perceptions, selon les principes de leur liaison empirique (les analogies) [85] ». Kant donne alors l’exemple de la limaille de fer attirée qui implique l’existence d’une force magnétique que l’on ne perçoit pourtant pas.
Il y a donc deux manières d’arriver à l’existence d’une chose : une manière immédiate qu’est la perception directe, et une « démonstration médiate [86] », par analogie. D’une manière ou d’une autre, directement ou indirectement, l’existence implique toujours la perception. C’est ce que Kant rappelle dans ce passage très empiriste : « Là donc où s’étend la perception et ce qui en dépend suivant des lois empiriques, là s’étend aussi notre connaissance de l’existence des choses. Si nous ne commençons par l’expérience, ou si nous ne procédons pas suivant les lois de l’enchaînement empirique des phénomènes, c’est en vain que nous affichons vouloir deviner et rechercher l’existence de quelque chose [87] ».
Afin de répondre à l’objection idéaliste contre la démonstration médiate de l’existence, Kant ajoutera à cet endroit, en 1787, sa célèbre « réfutation de l’idéalisme » qu’il serait hors de propos de commenter ici, mais dont il faut seulement rappeler qu’elle établit notamment, contre l’idéalisme cartésien, que la conscience de ma propre existence n’est possible qu’en vertu de l’existence des objets extérieurs [88]. Non pas en vertu d’un raisonnement médiat, mais d’une saisie immédiate : « la conscience de ma propre existence est en même temps une conscience immédiate de l’existence d’autres choses hors de moi [89] ». De la même manière que Descartes précisait que son cogito, ergo sum n’était ni un syllogisme ni un raisonnement d’aucune sorte, mais une intuition dans laquelle le « je pense » et le « je suis » se saisissent en même temps, sans intermédiaire [90], Kant prolonge le raisonnement, mais contre lui cette fois, pour affirmer que ce « je suis » implique avec autant d’immédiateté l’existence des choses hors de moi – se passant ainsi du levier divin qui avait permis à Descartes de sortir du solipsisme dans la troisième Méditation. La réfutation de l’idéalisme se clot sur cette assertion qui est un véritable manifeste de l’empirisme : « l’expérience interne en général n’est possible que par l’expérience externe en général [91] ».
Il y a finalement deux manières de montrer que la possibilité implique l’expérience. Directement, d’une part, parce que le possible implique le réel : « il s’agit de démontrer, pour toute possibilité en général, et pour chaque possibilité en particulier, qu’elle présuppose quelque chose de réel, que ce soit une chose ou plusieurs [92] ». Un donné initial est requis, jusque dans l’impossibilité elle-même précise Kant, car nos possibilités sont « simplement des modifications de ce dont le fondement universel est donné par l’expérience [93] ». La possibilité implique donc l’expérience. Indirectement, d’autre part, en passant par ce moyen terme qu’est l’existence : si le possible implique le réel, c’est qu’il n’y a pas de possibilité sans existence. Or, il n’y a pas d’existence sans perception, comme nous venons de le voir, ce qui implique qu’il n’y a pas d’existence sans expérience, ce que Kant exprime explicitement : « notre conscience de toute existence (qu’elle se produise soit immédiatement par la perception, soit par des raisonnements qui rattachent quelque chose à la perception) appartient entièrement à l’unité de l’expérience, et (…) si une existence hors de ce champ ne peut sans doute pas être tenue pour absolument impossible, elle n’en est pas moins une supposition que rien ne nous permet de justifier [94] ».
Nous sommes apparemment loin de Leibniz. Son indépendance de pensée, dans la Kritik der reinen Vernunft, Kant la doit essentiellement à un concept original, devenu sa grille de lecture du réel, et qui n’était guère utilisé par son prédécesseur : l’expérience. A mesure qu’il définit la possibilité par l’accord avec les conditions formelles de l’expérience, et qu’il rend l’existence subordonnée à l’expérience, à mesure, donc, qu’il fait de l’expérience la condition de la possibilité comme de l’existence, Kant s’arrache d’autant du référentiel leibnizien et marque l’avènement d’une pensée propre et originale.
Reste que les deux premiers postulats de la pensée empirique en général, qui sont aussi les définitions des deux premières catégories de la modalité, la possibilité et l’existence (réalité), sont dans leur forme très proches de ce que Leibniz écrivait un siècle plus tôt, lorsqu’il posait les définitions suivantes : « L’ÊTRE est le pensable de manière distincte. / L’EXISTANT est le perceptible de manière distincte [95] ». Si l’on rappelle l’équivalence des termes (le réel est l’existant chez Kant, l’être est le possible chez Leibniz), cela revient effectivement à dire exactement la même chose : s’accorder avec les conditions formelles de l’expérience quant à l’intuition et aux concepts, c’est être pensable de manière distincte ; et s’accorder avec les conditions matérielles de l’expérience, c’est-à-dire avec la sensation, ou la perception [96], c’est être perceptible de manière distincte. Si Kant se dégage ici de Leibniz, c’est qu’il parvient finalement à le préciser. Il ne le nie pas, il le sursume, son dépassement est un Aufhebung. Mais c’est ailleurs que la rupture avec Leibniz est la plus spectaculaire. L’écart devient gouffre sur la question du rôle de Dieu.
3.3. La rupture ontologique : l’éclipse de Dieu
Le Kant précritique, celui de la Nova dilucidatio, marchait avec application dans les pas de Leibniz en faisant de Dieu la source et la condition de la possibilité comme de l’existence. La situation est fort différente, désormais, et le lecteur aura remarqué que c’est sans jamais faire appel à Dieu que Kant dans sa Kritik parvient à s’arracher du chemin leibnizien. Dans un passage qui, comme son titre le suggère, répond directement au Beweisgrund, « De l’impossibilité d’une preuve ontologique de l’existence de Dieu », en quatrième section du chapitre III du livre II de la Dialectique transcendantale, Kant s’en justifie.
Tandis que, chez Leibniz, Dieu était condition des possibles, de leur existentiabilité, du passage de certains d’entre eux à l’existence, et donc de l’existence même – c’est dire que Dieu était condition de la chaîne entière de la possibilité à l’existence comme de chacun de ses maillons –, il y a chez Kant une éclipse de Dieu sur ces questions, une absence pure, simple et revendiquée : « Le concept d’un être suprême est une Idée très utile à maints égards ; mais, précisément parce qu’il est simplement une idée, il est tout à fait incapable d’étendre à lui seul notre connaissance par rapport à ce qui existe. Il ne peut même pas nous instruire davantage relativement à la possibilité [97] ». Et c’est bel et bien Leibniz qui est visé dans cette remarque, coupable sans doute d’avoir utilisé trop facilement un Dieu pourtant inaccessible : « il s’en faut de beaucoup que l’illustre Leibniz ait fait ce dont il se flattait, c’est-à-dire qu’il soit parvenu à connaître a priori la possibilité d’un être idéal aussi élevé [98] ». C’est que, pour le Kant critique de l’idéalisme transcendantal, les propositions d’existence appartiennent à la sphère des jugements synthétiques, lesquels exigent un rapport à l’expérience qui est impossible dans le cas de Dieu. Seules les apparences sont connaissables, et Dieu n’en est pas une, donc je ne peux avoir de connaissance proprement dite de son existence [99].
Autrement dit, là où Leibniz a besoin de la preuve ontologique, là où le Kant précritique en avait également besoin, la Kritik s’en passe – ou plutôt elle se contente d’un indice comme le dit bien Lebrun : « chez Kant, l’indice se suffit à lui-même et devient la seule preuve possible, sinon rigoureuse [100] ». Dans le Beweisgrund, le « premier fondement réel » (Realgrund) est l’existant condition de l’élément matériel de la possibilité. Dans la Kritik, ce rôle semble joué par la « matière de toute possibilité », puisqu’elle doit « contenir a priori les données nécessaires à la possibilité particulière de chaque chose [101] ». Il y a néanmoins entre les deux une différence de taille : en 1763, Kant affirme l’existence nécessaire de ce premier fondement réel, tandis qu’en 1781 il n’affirme que la présupposition transcendantale de la matière de toute possibilité, en dissociant cette question de celle de l’existence, c’est-à-dire sans avoir besoin d’affirmer quoi que ce soit concernant l’existence même de ce premier fondement, comme on peut le voir dans l’idéal transcendantal. Autrement dit, Kant est plus prudent quant à l’existence d’un fondement.
Il y a une explication à cela. Dieu, qui était jusqu’alors entendu ontologiquement, l’est désormais transcendantalement, comme Kant le dit explicitement, et l’idéal de la raison pure est alors l’objet d’une théologie transcendantale [102] – ce qui donne à son absence une signification toute épistémologique. Son absence est aussi présence, pour commencer, car bien que la nécessité de son existence ne puisse être démontrée, elle exige par-dessous (comme l’upokeimenon, ce qui se tient sous) sa propre représentation, comme l’une des dénominations du subtratum transcendantal, qui est au fondement de la détermination complète des choses et qui n’est autre que l’idée d’un tout de la réalité (omnitudo realitatis), ou l’idéal transcendantal [103]. Le concept de Dieu est alors ce qui permet de conférer l’unité systématique maximale à la totalité de nos connaissances, y compris l’entendement. Et de cette manière il y a un lien entre l’élément matériel de la possibilité et Dieu : toutes les possibilités sont dérivées de cette possibilité originelle qu’est l’ens realissimum [104]. Cependant, l’idée transcendantale est au fondement de la détermination complète des choses mais à titre de concept seulement : autrement dit, il n’est pas besoin « que cette réalité soit donnée objectivement et constitue elle-même une chose [105] ».
Il semble donc se trouver deux ruptures dans la Kritik der reinen Vernunft, qui arrachent Kant à Leibniz. L’une est épistémologique, c’est l’irruption de l’expérience comme condition générale de la possibilité et de l’existence. L’autre pourrait être ontologique, c’est l’éclipse de Dieu. L’existence semblait être chez Leibniz un problème irréductiblement ontothéologique, qui ne devient plus avec Kant, du moins en apparence, qu’ontologique. L’une des manifestations de cette fracture s’incarne dans l’affirmation kantienne selon laquelle l’existence n’est plus un prédicat car, dès lors, l’existence ne peut plus être utilisée comme un attribut de Dieu dans la preuve ontologique classique, et l’ontothéologie s’en trouve fragilisée. Mais il faut nuancer cette conclusion.
D’une part, l’existence, comme nous l’avons vu, n’est déjà plus chez Leibniz un prédicat. L’ontothéologie leibnizienne est donc déjà fissurée. Kant ne fait que se glisser dans la faille, et l’élargit considérablement : le possible, l’être, le positif, le réel ne sont plus confondus avec l’entendement de Dieu. La révolution copernicienne a délogé le divin des rouages de l’existence. Dieu n’est plus la condition nécessaire du passage du possible à l’existant, car ce passage lui-même n’est plus, la chaîne est brisée. D’autre part et inversement, l’ontologie kantienne est encore théologique d’une certaine manière (transcendantalement) : l’éclipse de Dieu n’est jamais qu’une apparence, et il faudrait plutôt parler d’une présence souterraine, puisqu’à titre de concept il reste condition de la possibilité et de l’existence. La seule et véritable rupture est donc bien de nature épistémologique : Kant n’a plus besoin de trouver son socle dans une réalité objective hors et indépendamment du sujet.
Alors qu’au sujet du Beweisgrund on pouvait sans doute parler, comme le fait Bouchard, de « réalisme foncier [106] », puisque la possibilité impliquait le réel et reposait sur lui comme sur un socle inébranlable, le tournant critique et sa révolution copernicienne nous inviterait plutôt à parler maintenant d’un antiréalisme, qui se dévoile exemplairement dans la question de la chose de soi, discutée depuis Jacobi, et encore particulièrement incomprise aujourd’hui. La chose en soi, ou plus en exactement la chose considérée en soi (Ding an sich selbst betrachtet), n’est qu’un point de vue, un mode de représentation, un objet de pensée (ens rationis), un principe, une certaine manière de considérer les choses, un acte de l’entendement, qui n’existe pas hors du sujet, et qui n’est autre que le sujet lui-même se faisant objet. De la même manière, dira Kant dans sa Kritik der Urteilskraft (1790), la distinction entre possibilité et existence est une distinctio rationis qui se trouve dans la pensée et non dans les choses, ou plutôt dont on ignore si elle se trouve dans les choses. Elle n’exprime pas la manière dont les choses sont, mais l’état de notre relation avec elles [107].
Si donc le criticisme kantien s’arrache de Leibniz sur la possibilité et l’existence, c’est donc pour de sérieuses raisons épistémologiques, qui relèvent de la dialectique du sujet et de l’objet, et qui poussent Kant à fonder une théorie de la connaissance qui elle-même s’arrache de la métaphysique en la dépassant (Aufhebung).
[1] Cet article est la troisième et dernière étape d’une étude consacrée à la possibilité et l’existence chez Leibniz. Les deux premiers articles sont « Possibilité et existentiabilité chez Leibniz », Revue philosophique de Louvain, 2006, 104:1, p. 23-45 et « L’existence leibnizienne », Archives de philosophie, 2007, 70:1, p. 249-273.
[2] Y. Belaval, Etudes leibniziennes : de Leibniz à Hegel, Paris, Gallimard, 1973, p. 207.
[3] Lettre à Foucher de 1676, in Die Philosophischen Schriften von Gottfried Wilhelm Leibniz, édition de C. D. Gerhardt en 7 vol., Berlin, 1875, réed. Georg Olms Hildeshein, 1960, vol. I, p. 370 (noté GP I 370).
[4] R. Théis, introduction à Leibniz, L’unique argument possible pour une démonstration de l’existence de Dieu, Paris, Vrin, 2001, p. 24.
[5] Nova Dilucidatio, section II, proposition VII, in Œuvres philosophiques, éd. par F. Alquié, Paris, Gallimard, 1980 (ci-après : OP), t. I, p. 125.
[6] Voir De Rerum originatione radicali, GP VII 305, in Leibniz, Opuscules philosophiques choisis, éd. par P. Schrecker, Paris, Vrin, 2001, p. 179.
[7] Sans-titre, sur Descartes, GP IV 406, 1.
[8] M. Heidegger, Nietzsche, Günther Neske Verlag, 1961, t. II, p. 358.
[9] Nova Dilucidatio, section II, proposition VII, OP, t. I, p. 126.
[10] Ibid., scolie.
[11] Nouveaux Essais, II, 15, GP V 141.
[12] Monadologie, §43.
[13] Sur la démonstration cartésienne de l’existence de Dieu du P. Lamy (1701), in Leibniz, Système nouveau de la nature et de la communication des substances, et autres textes 1690-1703, éd. par C. Frémont, Paris, Flammarion, 1994, XI, p. 168.
[14] Nova Dilucidatio, section II, proposition VII, scolie, OP, t. I, p. 127.
[15] Beweisgrund, Ière partie, Ière considération, AK II 70, OP, t. I, p. 323.
[16] Ibid.
[17] Ibid., AK II 71, OP, t. I, p. 324.
[18] De iis quae per se concipiuntur, septembre 1677, GP I 271.
[19] Leibniz, Textes inédits d’après les manuscrits de la Bibliothèque provinciale de Hanovre, éd. par Gaston Grua, Paris, PUF, 1948, p. 325.
[20] Beweisgrund, Ière partie, Ière considération, I, AK II 72, OP, t. I, p. 325.
[21] J. Wahl, Discussions sur l’idée d’existence, leçons à la Sorbonne, des 9 décembre 1939, 16 décembre 1939 et 6 janvier 1940, (BNF, ref. : FOL-Z WAHL PIECE-1), p. 11.
[22] Voir B. Mates, The Philosophy of Leibniz. Metaphysics and Language, New York – Oxford, Oxford University Press, 1986, p. 101.
[23] Voir notre article « L’existence leibnizienne », Archives de philosophie, 2007, 70:1, p. 249-273.
[24] Existentia, an sit perfectio, 1677 (?), A VI-4-B 1354.
[25] Nouveaux Essais, IV, I, GP V 339, 34, souligné par nous (spn).
[26] Leibniz, Recherches générales sur l’analyse des notions et des vérités. 24 thèses métaphysiques et autres textes logiques et métaphysiques, éd. par J.-B. Rauzy, Paris, PUF, 1998, p. 315, n. 72. Voir aussi Opuscules et fragments inédits de Leibniz, extraits des manuscrits de la Bibliothèque royale de Hanovre, éd. par Louis Couturat, Paris, Alcan, 1903, pp. 271 et 375.
[27] Beweisgrund, Ière partie, Ière considération, I, AK II 73, OP, t. I, p. 326.
[28] C’est également la conclusion à laquelle arrive J. Skosnik, « Leibniz and Russell on Existence and Quantification Theory », Canadian Journal of Philosophy, 1980, 10:4, p. 719.
[29] Kritik der reinen Vernunft, AK III 400-401, A597-598/B625-626, OP, t. I, pp. 1213-1214.
[30] Ibid., A598-599/B626-627, OP, t. I, pp. 1214-1215.
[31] Ibid., A599/B627, OP, t. I, p. 1215. M. Smithurst voit en Hume le germe de la thèse kantienne selon laquelle « that ‘exists’ is not a property-ascribing word, that existence is the concept of a concept’s instantiation » (M. Smithurst, « Hume on existence and possibility », Proceedings of The Aristotelian Society, 1980-1981, vol. 81, p. 19). Pour Hume, effectivement, l’existence n’est rien, en ce sens qu’elle n’ajoute rien à l’objet dont on a l’idée : c’est une seule et même chose de concevoir un objet et de le concevoir comme existant. « the conception of the existence of an object is no addition to the simple conception of it » ; « The idea of existence, the, is the very same with the idea of what we conceive to be existent. (…) Whatever we conceive, we conceive to be existent » (A Treatise of human nature, Sely-Bigge (ed.), Oxford, Clarendon Press, 1896, respectivement pp. 94 et 66). Hume n’est pas l’unique précurseur de Kant sur ce point, et Leibniz en est bien plus proche.
[32] Kritik der reinen Vernunft, AK III 186, A219/B266, OP, t. I, p. 948.
[33] Contrairement à ce qu’affirment Mark Fisher et Eric Watkins, « Kant on the material ground of possibility », The Review of Metaphysics, 1998, 52:2, p. 377, qui comme de nombreux interprètes postulent que pour Leibniz l’existence est un prédicat. Quiconque ne fait pas cette erreur voit immédiatement la proximité flagrante entre les positions leibnizienne et kantienne sur l’existence.
[34] Beweisgrund, Ière partie, Ière considération, II, AK II 73, OP, t. I, p. 327.
[35] Opus Postumum, XXII, 549, éd. par F. Marty, Paris, PUF, 1986, p. 69. Sur la notion de position absolue, voir Wolfgang Röd, « Existenz als Absolute Position », Proceedings : The Sixth International Kant Congress, G. Funke et T. Seebohm (ed.), Washington, University Press of America and CARP, 1989, p. 67-81.
[36] Beweisgrund, Ière partie, Ière considération, I, AK II 72, OP, t. I, p. 325.
[37] Voir notre article « Possibilité et existentiabilité chez Leibniz », Revue philosophique de Louvain, 2006, 104:1, p. 23-45.
[38] De l’essence à l’existence, la différence est effectivement de degré, et non de nature, comme le rappelle E. M. Curley, par cette analogie : « The difference between what exists and what does not exist is not like the difference between a signed painting and an unsigned painting, but like the difference between a good painting and a bad one » (E. M. Curley, « The Root of Contingency », in H. G. Frankfurt, dir., Leibniz : A Collection of Critical Essays, New York, Anchor Books, 1972, p. 87).
[39] Système nouveau de la nature et de la communication des substances, GP IV 479, in Leibniz, Système nouveau de la nature, op. cit., p. 67, spn. Voir par exemple J. Wahl, op. cit., p. 5 : « Leibniz se demande ce qui s’ajoute à la possibilité pour faire l’existence et il admet l’idée d’un complementum possibilitatis » et J.-B. Rauzy : « L’existence peut être conçue comme le plus haut degré de possibilité dans la mesure où la plus grande classe de compossibles serait choisie par un esprit. Cette définition de l’existence est sans doute un écho d’un texte parisien, où Leibniz écrivait : « Est harmonique au plus haut point ce qui est le plus plaisant pour l’esprit le plus parfait » (A VI iii 476, 11 février 1676) » (in Leibniz, Recherches générales, op. cit., p. 316, n. 74).
[40] Generales Inquisitiones de Analysi Notionum et Veritatum (1686), 73, in Leibniz, Recherches générales, op. cit., p. 247, spn.
[41] Ibid., pp. 247-249, spn.
[42] Ibid., p. 247.
[43] GP VII 195, note marginale.
[44] On trouve effectivement chez Leibniz une équivalence entre existence et actualité : « Petrus est abnegans actu, seu abnegans existens », Recherches générales, op. cit., p. 247. Si l’utilisation des termes aristotéliciens est utile et éclairante, il faut se garder d’extrapoler et de conclure que le passage de la possibilité à l’existence chez Leibniz n’est autre que celui de la puissance à l’acte chez Aristote : les concepts ne se recoupent pas proprement.
[45] Beweisgrund, Ière partie, Ière considération, III, AK II 75, OP, t. I, p. 329.
[46] Ibid.
[47] Ibid., p. 330.
[48] Generales Inquisitiones, op. cit., p. 247.
[49] Beweisgrund, Ière partie, Ière considération, III, AK II 75, OP, t. I, p. 330.
[50] Kritik der reinen Vernunft, A231/B284, OP, t. I, p. 962.
[51] Ibid., A234/B287, OP, t. I, p. 965, note.
[52] Beweisgrund, Ière partie, Ière considération, III, AK II 76, OP, t. I, p. 330.
[53] Ibid.
[54] Voir notamment A. L. Gonzalez, « La noción de posibilidad en el Kant precrítico (I) », Anuario Filosofíco, 1981, 14:2, pp. 87-115, qui se propose sur ce sujet de relier Leibniz au Kant précritique par Wolff, Crusius et Baumgarten.
[55] Beweisgrund, Ière partie, Ière considération, III, AK II 76, OP, t. I, p. 330.
[56] Ibid.
[57] Ibid., p. 331.
[58] Ibid., Ière partie, IIème considération, I, AK II 77, OP, t. I, p. 332.
[59] Ibid., AK II 77-78, OP, t. I, pp. 332-333.
[60] Ibid., p. 332.
[61] Yves Bouchard, Le holisme épistémologique dans la Critique de la raison pure de Kant, thèse de doctorat en philosophie, Université de Montréal, 1997, p. 35.
[62] Kritik der reinen Vernunft, AK III 218, A266 / B322, OP, I, p. 993.
[63] Beweisgrund, Ière partie, IIème considération, II, AK II 78, OP, t. I, p. 333.
[64] Ibid.
[65] Ibid., AK II 79, p. 334. Voir aussi : « la raison a besoin de supposer donnée une réalité pour expliquer la possibilité de toutes choses (…) la possibilité générale de toute chose doit absolument se trouver dans l’ensemble de toute existence » (Qu’est-ce que s’orienter dans la pensée ?, AK III 137, note, OP, t. II, pp. 534-535).
[66] Monadologie, §43. Voir aussi le §44 : « Car il faut bien que, s’il y a une réalité dans les essences ou possibilités, ou bien dans les vérités éternelles, cette réalité soit fondée en quelque chose d’existant et d’actuel ; et par conséquent dans l’existence de l’Etre nécessaire, dans lequel l’essence renferme l’existence, ou dans lequel il suffit d’être possible pour être actuel ».
[67] Beweisgrund, IIème considération, IV, AK II 80, OP, t. I, p. 335.
[68] Kritik, A244/B302, OP, t. I, p. 976.
[69] Ibid., A219/B267, OP, t. I, p. 949.
[70] Ibid., A220/B268, OP, t. I, p. 950.
[71] Ibid., AK III 399, A596/B624, OP, t. I, p. 1213. Voir également « La possibilité d’une pensée ou d’un concept repose sur le principe de contradiction, par exemple le concept d’un être pensant incorporel (d’un esprit). La chose dont même la simple pensée est impossible (c’est-à-dire dont le concept se contredit) est elle-même impossible. Mais la chose dont le concept est possible n’est pas pour autant une chose possible. On peut appeler logique la première possibilité, réelle la seconde ; la preuve de cette dernière est la preuve de la réalité objective du concept qu’on est toujours autorisé à exiger. Mais elle ne peut jamais être produite autrement que par la présentation de l’objet correspondant au concept, car sinon il ne reste jamais qu’une pensée qui laisse toujours dans l’incertitude la question de savoir si quelque objet lui correspond ou si elle est vide, autrement dit si elle peut en somme servir à connaître, jusqu’à ce que cet objet soit montré dans un exemple » (Quels sont les progrès de la métaphysique en Allemagne depuis le temps de Leibniz et de Wolff ?, supplément n° I, section II, AK XX 7, 325-326, OP, t. III, p. 1273).
[72] Ibid., A223/B270, OP, t. I, p. 951.
[73] Ibid., AK III 185, B265, OP, t. I, p. 948.
[74] Ibid., AK III 186, A220, OP, t. I, p. 949.
[75] Ibid., AK III 187, B267-268, OP, t. I, p. 950.
[76] Kants Nachlaß, 4801, AK XVII.
[77] Progrès de la métaphysique en Allemagne, 1er supplément, 2ème section, AK XX 7, 325-326, OP, t. III, p. 1273.
[78] Kants Nachlaß, 5181, AK XVIII.
[79] Voir Nino Langiulli, Possibility, Necessity, and Existence : Abbagnano and his predecessors, Philadelphia, Temple University Press, 1992, p. 85.
[80] Heidegger, op. cit., t. II, p. 356.
[81] C’est moins clair chez M. de Gaudemar, De la puissance au sujet, Paris, Vrin, 1994, p. 48, qui parle d’ « intermédiaire entre la possibilité et l’existence en acte », même si elle fait aussitôt référence à la dynamis aristotélicienne.
[82] Kritik der reinen Vernunft, AK III 185, B266, OP, t. I, p. 948.
[83] Ibid., AK III 189, A225, OP, t. I, p. 953. Voir aussi : « Là donc où s’étend la perception et ce qui en dépend suivant des lois empiriques, là s’étend aussi notre connaissance de l’existence des choses » (AK III 190, A226/B273, OP, t. I, p. 954).
[84] Ibid., A225/B273, OP, t. I, p. 953.
[85] Ibid.
[86] Ibid., A226/B274, OP, t. I, p. 954.
[87] Ibid., A225/B273-274, OP, t. I, p. 954.
[88] Ibid., B275, OP, t. I, p. 955.
[89] Ibid., B276, OP, t. I, p. 957.
[90] Sur la logique du cogito cartésien, voir notre article « Cogito, ergo sum : induction et déduction », Archives de philosophie, 2004, 67:1, p. 51-63.
[91] Kritik der reinen Vernunft, B278-279, OP, t. I, p. 959.
[92] Beweisgrund, Ière partie, IIème considération, IV, AK II 79, OP, t. I, p. 334.
[93] Kants Nachlaß, 4021, AK XVII.
[94] Kritik der reinen Vernunft, A601/B629, OP, t. I, p. 1217.
[95] Définitions (1679-1686), in Recherches générales, op. cit., p. 110. « Ens est distincte cogitabile. Existens distincte perceptibile » (Definitiones : ens, possibile, existens, Sommer 1687 bis Ende 1696 (?), A VI-4-A 869).
[96] Kant préfère effectivement parler de perception : il insistera ensuite sur le fait que l’existence implique la perception, comme nous le verrons et tout comme Leibniz le fait.
[97] Kritik der reinen Vernunft, A601/B629 - A602/B630, OP, t. I, p. 1217.
[98] Ibid., A602/B630, OP, t. I, p. 1217. Voilà qui répond à J. Hintikka qui écrivait : « This possibility of restoring something like the ontological argument by means of the additional premise that God is possible had been exploited by Leibniz. Even though Kant presumably would have rejected Leibniz’ argument for other reasons, he could scarcely afford to admit God’s possibility » (J. Hintikka, « Kant on Existence, Predication, and the Ontological Argument », Dialectica, 1981, 35:1-2, p. 127-146 ; repris in S. Knuuttila et J. Hintikka (ed.), The Logic of Being, Historical Studies, Dordrecht, Reidel, 1986, p. 261).
[99] Sur la possibilité et l’existence de Dieu dans la Kritik, voir Jamie Ferreira, « Kant’s postulate : The possibility or the Existence of God ? », Kant-Studien, 1983, 74:1, p. 75-80.
[100] Gérard Lebrun, Kant et la fin de la métaphysique. Essai sur la ‘Critique de la faculté de juger’, Paris, Armand Colin, 1970, p. 132.
[101] Kritik, AK III 386, A573 / B601.
[102] Ibid., A580/B608.
[103] Ibid., A575-6/B603-4, OP, t. I, p. 1198-1199.
[104] Ce qui fait dire à Fisher et Watkins que « not only does Kant link the material ground of possibility and God, but he does so in a way that is fundamentally the same as he does in The Only Possible Argument » (op. cit., p. 390).
[105] Kritik, A580/B608, OP, t. I, p. 1202.
[106] op cit., p. 38.
[107] Voir Kritik der Urteilskraft, §76, AK V 402, OP, t. II, p. 1199.


