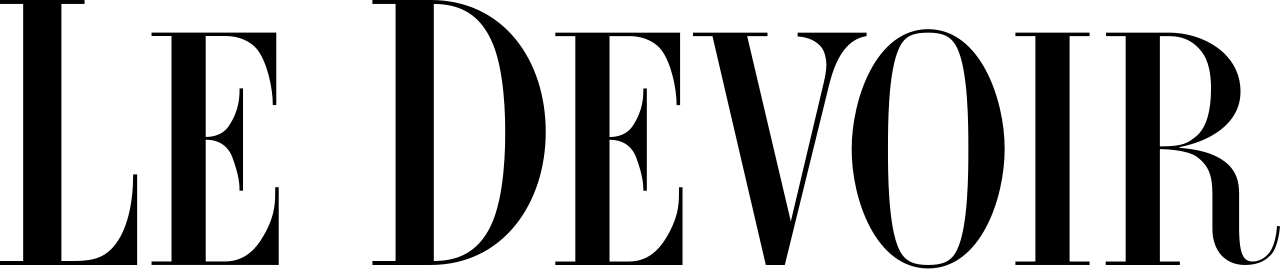
Il est de bon ton de caricaturer la pensée animaliste et de la réduire à un sentimentalisme incohérent. La récente prestation de Brigitte Bardot en a donné l’occasion à Louis-Gilles Francoeur dans son article « De l’animalisme primaire » (Le Devoir, le 23 mars 2006).
Jean-Baptiste Jeangène Vilmer - Département de philosophie de l’Université de Montréal, 30 mars 2006
Il est de bon ton de caricaturer la pensée animaliste et de la réduire à un sentimentalisme incohérent. La récente prestation de Brigitte Bardot en a donné l’occasion à Louis-Gilles Francoeur dans son article « De l’animalisme primaire » (Le Devoir, le 23 mars 2006).
Il est facile de s’en prendre à une vieille dame dont le discours n’est effectivement pas toujours très éloquent, mais en tirer des conclusions sur la « pensée animaliste » en général (comme s’il n’y en avait qu’une), c’est pratiquer l’amalgame et la désinformation, que le journaliste dénonce par ailleurs lui-même à juste titre. Si le plaidoyer de Brigitte Bardot est « primaire », le portrait simpliste que M. Francoeur dresse d’un mouvement complexe l’est tout autant.
Le journaliste, habitué des questions environnementales, se revendique d’une « pensée écologiste » qui doit être distinguée de la « pensée animaliste ». C’est tout à fait juste, et on peut préciser cette différence.
D’abord, l’éthique animale (pensée animaliste) ne s’intéresse qu’aux êtres vivants sensibles car elle fait de la souffrance son point de départ. Les plantes et les choses inanimées (les arbres, l’eau, etc.) ne sont considérées qu’en fonction de leur lien (l’environnement, l’habitat) avec l’animal, dont elles conditionnent le bien-être, tandis qu’en éthique environnementale (pensée écologiste), cet environnement fait lui-même l’objet d’une considération morale directe.
Ensuite, l’éthique animale considère généralement la mort et la souffrance comme des maux, qu’elle cherche à éviter ou au moins à minimiser. Ce n’est pas le cas de l’approche environnementale, pour laquelle la mort et la souffrance font partie intégrante de la vie et de la nature.
Enfin, la perspective de l’éthique animale est généralement individuelle (puisque ce sont des individus qui souffrent) tandis que celle de l’éthique environnementale est généralement holistique et s’attache à la protection des espèces et des écosystèmes.
À la lumière de cette distinction, on comprend mieux le point de vue de M. Francoeur. Néanmoins, certains problèmes persistent. J’en distinguerai trois.
Des arguments qui ne tiennent pas
Premièrement, dire que la chasse aux phoques est légitime du seul fait que l’espèce n’est pas en danger repose sur des prémisses discutables. Cela revient en effet à considérer les animaux non humains comme des ressources dont on peut disposer à notre guise, à condition toutefois de ne pas les épuiser, comme on le fait des végétaux et des minéraux. On parle d’ailleurs de récolte plutôt que de chasse, comme pour mieux oublier ce qui distingue un être vivant sensible d’un champ de blé. Cela revient donc à penser l’homme « maître et possesseur de la nature » dans la perspective anthropocentrique, occidentale et chrétienne qui sert à justifier l’exploitation animale depuis 2000 ans.
Deuxièmement, le fait que la chasse soit une activité « traditionnelle » n’a strictement aucune valeur argumentative. C’est un sophisme bien connu, un appel à la tradition (argumentum ad antiquitam), abondamment utilisé dans d’autres pays pour justifier le foie gras et la corrida, par exemple, et qui ne résiste pas au tribunal de la raison : au nom du respect de la tradition, nous en serions toujours aux combats de gladiateurs, à l’esclavage, à la torture, à la peine de mort, et nous ne questionnerions pas la légitimité de l’excision. Mieux vaut donc parler d’une « chasse de subsistance », qu’il faut distinguer de la « chasse commerciale ».
M. Francoeur nous dit qu’il est raciste de permettre cette chasse de subsistance pour les Inuits mais pas pour les Blancs. C’est détourner le sens du mot « subsistance ». D’un point de vue animaliste, il est acceptable que les Inuits chassent le phoque car il s’agit d’un besoin nécessaire (se nourrir), mais il n’est pas acceptable de chasser le phoque à grande échelle pour faire des manteaux de fourrure ou des cosmétiques car il s’agit d’un désir contingent (tirer profit du commerce d’objets futiles). La distinction est claire et ne repose pas sur l’origine ethnique des chasseurs mais sur leurs motivations.
Pour la même raison, les animalistes condamnent la chasse sportive précisément parce qu’elle est un loisir. Il s’agit de rappeler qu’ôter la vie à un être vivant sensible n’est justifiable que par la nécessité.
Différence de degré, non de nature
Troisièmement, le journaliste affirme que la pensée animaliste « repose sur la croyance que les animaux ont une "âme", une anima en latin, ce qui leur conférerait des droits, curieusement non contrebalancés de responsabilités, comme le veut la définition philosophique ou morale la plus élémentaire ». C’est tout simplement faux. D’abord, « la » pensée animaliste n’existe pas. L’éthique animale est un vaste domaine qui réunit des dizaines de courants.
Ensuite, la plupart de ces positions sont tirées non d’une croyance mais au contraire de la science elle-même (biologie, zoologie, éthologie) qui nous enseigne à quel point la différence entre l’homme et l’animal n’est qu’une question de degré et non de nature, comme l’a montré Darwin, et qui nous rappelle que nous partageons 99 % de notre ADN avec le chimpanzé. Cela n’a rien à voir avec une quelconque croyance, et encore moins avec l’âme. D’ailleurs, qu’est-ce que l’âme ?
La croyance, au contraire, est dans l’anthropocentrisme qui, contre les preuves scientifiques, persiste à vouloir arracher l’homme de l’animalité pour mieux autoriser l’exploitation de ses frères inférieurs. La croyance est dans ce préjugé, très chrétien d’ailleurs, selon lequel « l’animal a été créé pour être au service de l’homme ».
Enfin, de nombreux courants ne revendiquent pas des « droits » pour les animaux mais se contentent d’insister sur nos devoirs envers eux, défendant par exemple une égalité de considération, qui n’appelle aucunement l’égalité de traitement ou l’application des droits de l’homme aux animaux. C’est notamment le cas de l’utilitarisme de Peter Singer.
Par ailleurs, le fait que des droits puissent ne pas être contrebalancés de responsabilités n’a rien de curieux : n’est-ce pas le cas des enfants et des handicapés mentaux humains ? La question est alors de savoir au nom de quoi ils sont malgré tout protégés.
Si c’est en vertu de leur appartenance à l’espèce humaine, c’est du spécisme, et les animalistes le rejettent au même titre que le racisme et le sexisme. Et si c’est en vertu de leur capacité à souffrir, alors les animaux qui possèdent également cette capacité doivent aussi être protégés. Dans tous les cas, la question mérite d’être posée avec rigueur et précision.


